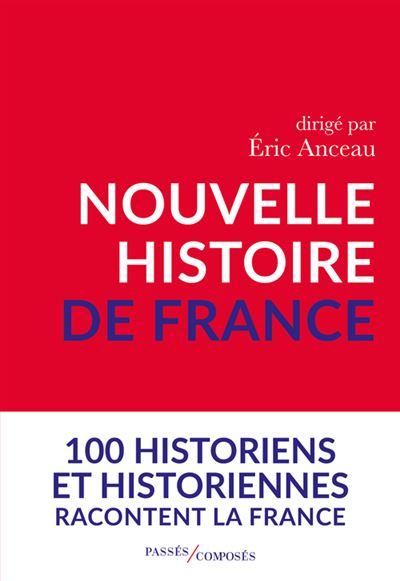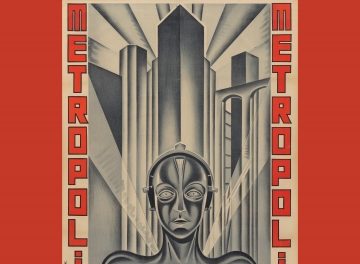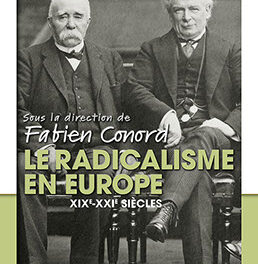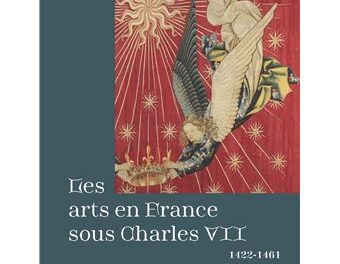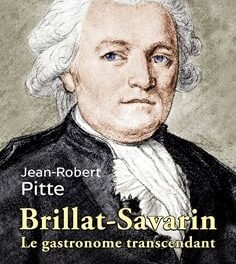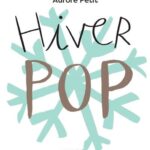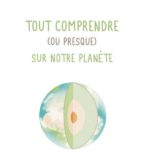Parue aux excellentes éditions Passés Composés, la Nouvelle histoire de France, dirigée par Éric Anceau, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine, s’impose comme une somme remarquable : plus de mille pages, cent auteurs, et l’ambition de revisiter quinze siècles d’histoire nationale. À une époque où la France s’interroge sur son identité, ce livre propose un récit clair, rigoureux et apaisé, mêlant approche chronologique et thématique, faits établis et découvertes récentes.
Ce monument éditorial, vendu à un prix très raisonnable (merci à l’éditeur), s’adresse autant aux passionnés d’histoire qu’aux enseignants en quête d’une synthèse solide et actualisée. On y trouve à la fois l’érudition et la pédagogie, ce qui en fait un ouvrage susceptible de nourrir autant l’esprit curieux que la pratique professionnelle. Espérons qu’Éric Anceau pardonnera au rédacteur de ce compte-rendu de ne pas suivre son plan en cent chapitres, mais en trois parties … comme tout bon professeur d’histoire qui se respecte !
Le contexte d’écriture : redonner sens à l’histoire de France
« On accommode l’histoire à peu près comme les viandes dans une cuisine », rappelle Éric Anceau en citant Pierre Bayle. C’est dire que les recettes du passé se sont souvent multipliées, parfois jusqu’à la confusion des goûts. De Ernest Lavisse à Pierre Nora, de Jules Michelet à Fernand Braudel, chaque génération d’historiens a voulu redéfinir ce que signifie « faire » une histoire de France. Or, depuis près de dix ans, aucune synthèse d’ensemble n’avait entrepris de revisiter intégralement ce grand récit collectif. Il fallait donc un nouveau livre, à la fois fidèle à la tradition historiographique française et attentif aux approches les plus récentes.
Le contexte actuel rendait cette entreprise d’autant plus nécessaire. Dans une France traversée de doutes et de tensions, la question de l’identité nationale ressurgit sans cesse. La dernière édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois posait d’ailleurs la question « La France ? », point d’interrogation compris. A cette occasion, une table ronde intitulée Écrire l’histoire de France aujourd’hui et réunissant Patrick Boucheron, Laurence de Cock, Joël Cornette, Claude Gauvard et bien sûr Éric Anceau avait justement permis de questionner la manière d’envisager le récit national. Enfin, certains faits d’actualité, comme le vol des huit bijoux dérobés au musée du Louvre, lors d’un casse spectaculaire, dimanche 19 octobre 2025, continue d’interroger la relation que les Français entretiennent avec leur passé et la manière dont le pouvoir envisage la conservation de son patrimoine, trace d’un passé commun.
Ainsi, « au milieu du tumulte du début du XXIᵉ siècle, la France s’interroge plus que jamais sur elle-même », constate aussi Éric Anceau. Les valeurs vacillent, les repères se brouillent, les interprétations s’entrechoquent. Entre nostalgie d’une grandeur perdue et volonté de réinvention, l’histoire nationale devient le miroir de toutes les passions. Dans ce contexte, Nouvelle histoire de France se veut une œuvre de clarification, un outil de réconciliation et un geste d’historien qui refuse aussi bien l’essentialisation que la déconstruction systématique.
Un collectif au service d’une structure claire, ambitieuse et novatrice
Pour revisiter ce vaste champ, Éric Anceau a réuni cent spécialistes unanimement reconnus : historiens, juristes, sociologues, économistes, géographes, philosophes ou historiens de l’art. C’est un véritable collectif de savoirs, à la croisée des disciplines, au service d’un même projet : restituer une histoire de France fondée sur les faits, nourrie des découvertes récentes, et ouverte à la complexité. Cette équipe, d’une grande hétérogénéité disciplinaire, incarne aussi la volonté de proposer une histoire dépassionnée et réconciliatrice.
Les contributeurs, de Bruno Dumézil à Jean-François Sirinelli, de Laurent Joly à Gabriel Martinez-Gros, de Paul Dietschy à Jacqueline Lalouette, en passant par Yannick Ripa, Jean-Marc Moriceau, Xavier Mauduit, Olivier Wieviorka, Thierry Lentz, Baptiste Roger-Lacan, Jean-Claude Yon, Xavier Vigna ou Marcel Gauchet, ont été choisis pour leur compétence, non pour défendre une ligne idéologique. En cela, Éric Anceau réussit un pari rare : faire dialoguer les points de vue sans les opposer, redonner au récit national sa légitimité scientifique sans le figer dans le passé. On notera également la belle place prise par les enseignants-chercheurs de l’université de Lorraine auxquels l’auteur appartient : Laurent Jalabert, Isabelle Guyot-Bachy, Jean El Gammal, Isabelle Brian, Stefano Simiz, Pascal Raggi, Jean-Noël Grandhomme ou François Audigier.
Le livre s’organise en quatre grandes parties, à la fois thématiques et chronologiques :
-
Régimes et violences, qui parcourt l’histoire politique et institutionnelle, des Francs à la Cinquième République. On y retrouve les grands jalons du récit national : les Capétiens, les Valois, la guerre de Cent Ans, les guerres de Religion, les révolutions du XVIIIe et XIXe s., la Commune, la IIIe République, les Première et Seconde guerres mondiales ou les violences urbaines de 2005 et 2023.
-
Politiques et spiritualités, où se croisent l’histoire de la construction de l’Etat, des croyances et des spiritualités. L’administration, la diplomatie, l’Etat, le pouvoir, les médias, l’aménagement du territoire, l’écologie et l’environnement, l’immigration, l’émigration, les grands courants spirituels et culturels (catholicisme, protestantisme, judaïsme, franc-maçonnerie, Lumières, …) ou le Panthéon y sont abordés avec finesse.
-
Espaces et sociétés, qui explore la France dans sa diversité : société, monde rural, littoraux, forêts, classes sociales (noblesse, bourgeoisie, ouvriers paysans, …), régions colonisées ou décolonisées (Afrique, Asie Amérique), le(s) féminisme(s), le peuple ou la nation. Ce chapitre illustre la capacité du collectif à relier les grandes tendances à l’expérience concrète des individus, offrant une histoire à la fois globale et incarnée, qui permet au lecteur de comprendre comment la société française s’est construite dans sa diversité et sa complexité.
-
Patrimoines et identités, enfin, s’attache aux éléments qui ont forgé une identité commune et aux manières de vivre et de penser « à la française » : les Gaulois, les paysages, la culture et les arts (sculpture, théâtre, musique, cinéma, les musées …), les loisirs, les sports (ex : le tour de France), le vin et la gastronomie ou les modes.
À ces grandes parties s’ajoutent 340 encadrés thématiques, véritables « éclairages » qui permettent d’approfondir un événement, un personnage, un lieu ou un texte. Chaque article se clôt par quatre ou cinq suggestions bibliographiques de référence, invitant à prolonger la réflexion. Un double index, des noms de lieux et de personnes, parachève ce travail d’une grande rigueur.
Une somme et un outil pour les enseignants
Cette Nouvelle histoire de France s’impose déjà comme une référence notamment pour les enseignants d’histoire. Pour ceux-ci, elle constitue à la fois une encyclopédie et un outil pratique : la lecture linéaire offre un panorama complet, mais chacun peut aussi y « picorer » un chapitre selon ses besoins ou l’avancée de son programme. On y retrouve les figures classiques, Clovis, Jeanne d’Arc, Louis XIV, Napoléon, Marc Bloch (et même Astérix le Gaulois), mais aussi des destins plus anonymes. On citera ici Mamadou Hady Bah, héros guinéen de la Résistance française et particulièrement vosgienne, redécouvert par Gérard Noiriel, Eugène Etienne, grand initiateur de l’expansion coloniale présenté par Julie d’Andurain ou encore Pauline Léon révolutionnaire durant la Première République que nous décrit Jean-Philippe Martin.
Le livre a également le mérite d’intégrer les nouveaux champs historiographiques : histoire des femmes et du genre, histoire environnementale, histoire connectée, histoire des minorités, la question patrimoniale, etc. Sans renier les apports des grands maîtres du passé, Éric Anceau inscrit la recherche française dans un cadre résolument contemporain.
Les enseignants y trouveront ainsi de quoi nourrir et actualiser leurs cours car derrière la somme savante se dessine une ambition profondément pédagogique : donner aux lecteurs, les moyens de comprendre ce que la France fut, ce qu’elle est, et ce qu’elle pourrait encore devenir.
En refermant ces mille pages, on se dit qu’Éric Anceau, fidèle à sa réputation d’homme rigoureux et organisé, a offert à la communauté historienne un outil à la hauteur de son objet : une France complexe, mouvante, vivante. Et s’il fallait en retenir une idée, ce serait peut-être celle-ci : l’histoire de France n’est pas un héritage figé, mais une construction en perpétuel renouvellement.