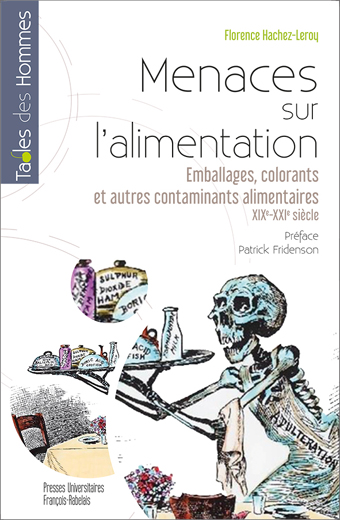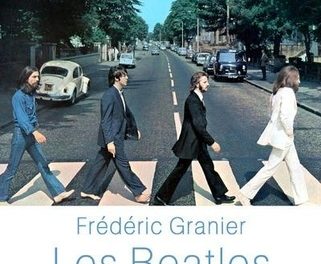Les presses universitaires François Rabelais de l’université de Tours propose depuis 2009 une collection intitulée « table des hommes » consacrée aux cultures alimentaires des sociétés humaines d’hier et d’aujourd’hui. Cette collection visionnaire se révèle fort utile pour appréhender les problématiques alimentaires dans le temps.
En août 2019, l’historienne des entreprises, des sciences et des techniques, Florence Hachez – Leroy a publié Menace sur l’alimentation. Emballages, colorants et autres contaminants alimentaires, XIXème- XXIe siècle. D’emblée, le titre ne manque pas d’attirer l’attention du lecteur historien ou non, puisqu’il fait écho aux problématiques citoyennes industrielles et environnementales actuelles.
L’étude est préfacée par Patrick Fridenson, historien spécialiste de l’histoire économique et industrielle de la France qui nous résume d’entrée la question centrale de cette étude : « comment la science et l’industrie ont-elles fait irruption sur la table des hommes ? Comment savoir s’il en résulte des risques, voire des menaces pour les personnes ? »[1]. L’ouvrage qui a pour but de faire comprendre au lecteur comment, dans l’alimentation, les sciences techniques et industrielles, devenues créatrices de risque peuvent être aussi être mobilisées afin d’analyser les problèmes et les dégâts qu’elles ont engendrés et ce, pour y mettre si possible un terme.
Depuis l’Antiquité, la conservation a fait partie de la problématique alimentaire. Les XVIIIe et XIXème siècles introduisent une rupture avec le développement des travaux scientifiques puis du monde industriel qui met rapidement au point des contenants destinés à emballer les aliments ou bien, une fois incorporés à ces derniers, à les stabiliser, les émulsifier ou encore les colorer.
En introduction à son étude, Florence Hachez – Leroy rappelle rappelle une évidence : « la nourriture tient une place essentielle dans les activités humaines, de la production à sa consommation »[2]. Mais au XIXe siècle, les progrès de la science et des techniques ont permis de renouveler les moyens de conservation. Quelques dates majeures sont rappelées : la stérilisation par la chaleur est mise au point par Appert en 1810, la dessiccation de la viande par Liebig entre autres en 1850 ou encore la congélation au début du XXe siècle. En parallèle, les additifs alimentaires qui existent depuis l’Antiquité (sel, miel, vinaigre pour les principaux) connaissent à partir du XIXe siècle une très forte expansion dans le sillage des travaux de la chimie. On estime ainsi au début du XXe siècle le nombre de substances chimiques organiques est d’environ 150 000.
La question de l’innocuité alimentaire n’est pas laissée de côté, la question de la toxicité des matériaux fait même partie de la recherche médicale dès le XVIIIe siècle. Celle-ci concerne la qualité de l’aliment conditionné, le mode de conservation choisi, la nature des additifs éventuels et le type de matériaux ainsi que le procédé mis en œuvre pour son conditionnement. Dès le milieu du XIXe siècle la question de la nocivité des additifs en particulier des colorants, est abordé. Les deux guerres mondiales entravent le processus de régulation alors qu’au même moment les additifs et les matériaux employés se multiplient. Mais les Etats ne restent pas indifférents à cette question puisque dans les années 20 et 30 les états, qui déjà au XIXème siècle se soucient de ces questions, se dotent de textes législatifs et de structures de contrôle de plus en plus efficaces. A partir des années 50 face à l’augmentation du nombre des additifs employés dans l’alimentation la nécessité se fait jour de développer les études toxicologiques et, désormais les contenants sont identifiés comme des contaminants possibles. En 1978, l’OMS estimait que plus de 5000 composés étaient utilisés comme additifs dans l’industrie agroalimentaire.
Florence Hachez – Leroy, qui se limite ici au cas de la France (tout en n’hésitant pas à établir des comparaisons avec les autres pays industrialisés), se penche ainsi successivement sur trois périodes et trois contenants :
-la première période qui s’étend des Lumières à la fin du XIXème siècle revient plus particulièrement sur l’aluminium. Cette partie (tout comme la troisième) qui aborde l’histoire des usages par le prisme des matériaux permet de comprendre les processus en œuvre à la fois dans la construction concomitante des connaissances scientifiques et techniques et leur appropriation par les usagers. En comparant les matériaux dans leurs usages alimentaires, il s’agit d’interroger les processus de construction de la connaissance scientifique et médicale et de la confiance des contemporains en multipliant dans le temps et l’espace les points de vue.
-la seconde s’étend de la fin du XIXe siècle à 1930. L’époque est marquée par une augmentation majeure des emballages et du rôle de la chimie organique tandis que l’aluminium est soumis à diverses controverses scientifiques sur fond notamment de rivalité franco-allemande,
-enfin dans une troisième partie qui s’étend de 1930 à 1990 aborde l’arrivée d’un nouveau matériau d’emballage alimentaire : la cellophane et plus globalement les matières plastiques mais aussi les additifs et les problématiques sanitaires soulevées par ces nouveaux matériaux.
* La première partie intitulée les métaux et l’innocuité alimentaire, du siècle des lumières à la première guerre mondiale, est consacrée à la découverte de nouvelles substances et au travail des chercheurs qui consiste non seulement à définir leurs caractéristiques chimiques mais aussi leur possible nocivité. Trois pays dominent alors les recherches : la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. En 1850 le regard porté sur la chimie est devenu extrêmement confiant. Mais les questions de santé ne sont pas absentes.
La première sous partie « la toxicologie des métaux » rappelle que cette dernière existe elle aussi dès l’Antiquité. Elle connait un premier tournant au XVIe siècle avec Paracelse qui démontre selon son expression que : « c’est la dose qui fait le poison » en utilisant le mercure pour traiter la syphilis. Cependant il faut attendre le début du XIXe siècle et surtout les travaux d’Orfila pour que de nouveaux progrès soient réalisés et que la toxicologie moderne se développe. En France la chimie a la particularité d’être étroitement liée à la pharmacie puisque par exemple Marcelin Berthelot a d’abord reçu une formation de pharmacien avant de se tourner vers la Chimie. Entre 1801 et 1880 on estime ainsi qu’environ 12 000 composants nouveaux ont été synthétisés dont certains, très toxiques.
L’aluminium est, dans cette sous-partie, recontextualisé. En 1817, le baron Thénard classe l’aluminium apparent parmi 48 corps pondérables simples identifiés alors dans son Traité de chimie élémentaire, le terme étant retenu avant tout pour désigner le métal associé à l’alumine. Mais les divers traités de chimie élémentaire qui le site n’évoque aucun usage pour ce métal. À l’inverse, le zinc et le nickel font l’objet d’analyse concernant les usages possibles et les risques en découlant, ce qui montre les préoccupations des scientifiques en matière d’hygiène publique. La question de l’innocuité des métaux est un thème de recherche qui domine au début du XIXe siècle en particulier pour déterminer la toxicologie de certains métaux utilisés dans les boissons. Leur ambivalence est soulignée puisqu’il est noté que, par exemple, le cuivre peut certes empoisonner mais il peut aussi guérir. L’auteur revient également sur le cas de l’alun connu depuis l’Antiquité elle revient également sur le manganèse, le fer ainsi que le cuivre, des travaux importants lui ayant été consacrés au XVIIIe siècle par le Docteur Devergie. A l’époque, l’ouvrage de référence reste le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales d’Amédée Dechambre dont l’édition de 1880 offre une synthèse rigoureuse de l’avancée des connaissances dans le domaine mais qui témoigne des relations fort existantes entre la communauté scientifique en générale et le législateur dont il s’agit à la fois d’influencer et de relayer les décisions. L’article de 76 pages consacré au cuivre est divisé en cinq paragraphes dont deux relatifs à la toxicologie et à l’hygiène. La question de la toxicité de ce métal pour l’homme est abordée. Ainsi la coloration par le sulfate de cuivre est dénoncée pour divers aliments dont les bonbons, les cornichons et les légumes verts angoissent notamment or, justement, l’interdiction de la coloration des légumes verts en boîte est interdite en France la première fois en 1853. De leur côté, bonbons et sucreries font l’objet d’une ordonnance en 1862 qui interdit l’introduction à l’intérieur d’objets de métal d’alliage métallique de nature à former des composés nuisibles à la santé.
La deuxième sous-partie « l’aluminium ou le surgissement d’un nouveau matériau en 1854 » se concentre sur ce nouveau matériau. La découverte de l’aluminium s’inscrit dans un processus long de recherches et de découvertes, qui va de la connaissance et de l’usage de l’alumine durant l’Antiquité jusqu’au début de la recherche scientifique proprement dite qui débute en 1792 avec les travaux effectuées par Lavoisier jusqu’à sa découverte par Henri Sainte-Claire Deville en 1854, année fondamentale puisqu’il est alors qualifiable de « matériau nouveau » qui permet de fabriquer des objets usuels, dont le premier fut justement la confection d’un plat de cuisson la même année. Or, ce choix montre bien que l’un des usages privilégiés du nouveau métal concerne la cuisine et donc le contact avec les aliments. L’auteur revient, sans alourdir les explications, sur le processus de découverte en présentant les différents apports des différents scientifiques ayant travaillé dessus : le médecin allemand Marggraf, de Morveau, Lavoisier bien sûr, et Humphry Davis qui l’identifie en 1804. L’accent est également mis sur le travail de Théodore de Saussure dont le travail sur la compréhension des végétaux a été fondamental dans ce cadre-là : la recherche sur l’aluminium fait partie intégrante du champ de la recherche botanique dans la première moitié du XIXe siècle.
Avec le procédé de production mis au point par Henri Sainte-Claire Deville, la matérialité de l’aluminium est acquise ainsi que la réalité de son existence et de sa présence sur Terre et par conséquent les recherches pour connaître la place de l’aluminium dans le monde végétal connaissent une véritable accélération à partir de 1855. La médecine et la pharmacopée ne tarde pas bien sûr à s’en emparer comment témoigne une nouvelle fois le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. L’article consacré à l’aluminium comporte 10 pages et celui sur l’alun 22 pages. Ils reviennent sur les usages thérapeutiques du métal et mentionne, outre l’usage de l’alumine dans les traitements contre les diarrhées et de la dysenterie, que son emploi avait été tenté dans l’appareillage dentaire mais que ce fut un échec en raison de l’altération rapide du métal dû au chlorure alcalin contenu dans la salive.
L’aluminium entre progressivement dans le Codex seu Pharmacopea outil de référence à l’usage des médecins et pharmaciens dont la première version remonte à 1638. À partir de 1818 cet ouvrage est le support de normalisation et de régulation à l’échelle nationale. Publié en français à partir de 1837, il fait l’objet d’une refonte sous le Second Empire assurée par la Société de pharmacie. L’aluminium ne figure pas encore en tant que tel contrairement au zinc et au cuivre, il faut attendre l’édition 1908.
Enfin, dans une troisième sous-partie, l’auteur revient sur « le doute en tant que moteur de la connaissance » du métal. En effet, déterminer la nature de l’aluminium, ses caractéristiques et qualités, les formes de sa matérialité a été l’objet des diverses études scientifiques en Europe. Le but affiché consiste aussi à construire progressivement une connaissance plus juste. Ces études ont été relayées notamment par l’éphémère bulletin universel des sciences et de l’industrie, publié par le baron de Ferrussac qui avait pour but la mise à disposition de la connaissance au public le plus large possible. La réussite de Sainte-Claire Deville a fait quant à elle, l’objet d’une diffusion bien organisée sur laquelle revient Florence Hachez – Leroy : une première communication est faite à la séance de l’Académie des sciences de Paris le 6 février 1854 tandis que quelques mois plus tard, le 14 août, le résultat de ces travaux et des échantillons d’aluminium produites par ses soins ont été présentés tandis que des échantillons du métal avaient été envoyés à un certain nombre de scientifiques renommés dont Liebig chercheur certes renommé en tant que chimiste mais aussi pour ses compétences dans le champ de l’alimentation. La diffusion de ces travaux est également assurée aux États-Unis. En dehors de la mise au point fondamentale du procédé de production, la question de l’innocuité de l’aluminium est abordée dès la présentation du métal qui s’attache notamment en démontrer l’inaltérabilité et son innocuité absolue. Les descriptions qu’il formule font explicitement allusion aux usages alimentaires possibles et ce n’est pas un hasard puisque la recherche de nouveaux matériaux sains est sensée à l’époque résoudre les problèmes d’hygiène publique, préoccupation majeure des sociétés du XIXe siècle. Or la question de l’usage de l’aluminium de l’alimentation est sujette à controverse dès 1854. Ainsi en 1858 Louis Figuier vulgarisateur scientifique sur lequel l’auteur revient à plusieurs reprises, relaie un certain nombre de doutes malgré son admiration première. Certes le métal est noble, mais son éclat est décevant et il est tout aussi partagé quant aux emplois dans les ustensiles de ménage : l’aluminium est très cher mais il demeure vulnérable aux matières alcalines ce qui a pour effet de diminuer son poids et donc sa valeur. Il relativise donc sa portée et son importance. Malgré tout, des essais sont réalisés le domaine alimentaire tandis que dans l’orfèvrerie religieuse où la symbolique des matériaux est prédominante, l’usage de l’aluminium est accepté à partir de 1866 par le Pie IX. Des applications de l’aluminium dans la vaisselle sont tentées mais finalement elles sont peu convaincantes en raison de la trop grande légèreté pour l’orfèvrerie. D’autre part, l’intérêt de la bourgeoisie pour ce métal diminue au fil du temps. La raison est double : la baisse du prix du métal et son développement dans les produits courants accessibles aux classes sociales les moins riches.
Enfin, la troisième sous-partie revient plus directement sur le rôle des pouvoirs publics et l’arsenal législatif à travers le cas français. Si la question a déjà été étudiée par Pierre-Antoine Dessaux dans sa globalité, Florence Hachez-Leroy s’intéresse plus particulièrement aux nouveaux matériaux qui font leur apparition. Les boissons ont été les premières visées par le délit de falsification par les lois du 19 et 22 juillet 1791 et le code pénal de 1810 qui instaurent un « droit alimentaire coordonné et global » applicable à l’ensemble du territoire. Les années 1820 sont un premier tournant. Mais l’Etat est finalement poussé à légiférer et intervenir. La loi de 1851 est la première dans le domaine des fraudes et de falsification, elle pose les bases législatives à partir desquels les tribunaux peuvent statuer selon les cas et ainsi développer une jurisprudence. La troisième étape décisive est franchie avec la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des inventaires et des produits agricoles. Florence Hachez-Leroy revient plus spécifiquement sur la question des emballages et des contenants dont la mention n’est pas explicite dans la loi à l’inverse des denrées. Pourtant ils ne sont pas oubliés. Trois périodes se distinguent : la première (1830-1890) au cours de laquelle le comité est saisi de nombreux problèmes et y apporte des réponses dominées par le principe de précaution. La deuxième (1890-1910) est marquée par des assouplissements progressifs des mesures suite aux pétitions des fabricants et au progrès scientifique et technique. Enfin à partir de 1918 une troisième période s’ouvre avec la parution du décret encadrant très précisément l’usage des emballages et des contenants mais aussi de la composition des encres d’imprimerie et des colorants pour l’alimentation.
L’auteur revient aussi sur la couleur dans les emballages des aliments à partir du XIXe siècle, sujet encore peu étudié. Les premières mesures d’interdiction datent de 1839 sont reprises et complétées en juin 1856. Elles interdisent l’emploi de certaines substances toxiques dans la coloration des papiers utilisés pour vendre les confiseries et autres pâtisseries de même que pour la coloration de ces produits (oxyde de cuivre, plomb, blanc de zinc …) les papiers blancs eux aussi sont suspects car la blancheur peut être obtenue moyennant des traitements toxiques. La pression de certains industriels est évoquée et des réponses parfois négatives sont apportés. Ainsi en 1880 Charles-Adolphe Burosse présente un rapport à la demande du ministre de l’agriculture et du commerce à la suite d’un courrier d’un chimiste manufacturier de Paris, Métra, qui prétend avoir développé les usages d’un produit dérivé de la houille, l’aniline, colorant qu’il estime être inoffensif. La réponse de Burosse aboutit à l’établissement d’une nouvelle liste de colorants interdits ou autorisés. Certains au nom poétique (mauvéine, safraline …) et rassurant, sont interdits au nom du principe de précaution. Finalement l’ensemble des travaux aboutit à la publication d’une circulaire ministérielle le 5 mai 1881 dans laquelle est fixée la nomenclature des substances interdites pour la coloration des aliments et de leurs papiers d’emballage. Mais l’affaire revient devant le comité consultatif d’hygiène publique en 1889, à la suite de plusieurs lettres de protestation adressée au Ministère de l’intérieur, lettres qui dénoncent les poursuites contre les commerçants utilisateurs de papier d’emballage coloré avec des colorants jugés dangereux. Ceci considère alors la loi comme étant abusive dans la mesure où aucun accident n’est à déplorer. Le rapport final, tout en maintenant le principe de précaution et en reconnaissant aussi le caractère nocif des colorants, en particulier ceux tirés de la houille, assouplit certaines interdictions. Ainsi en 1886, une recommandation de tolérance est demandée par le comité pour l’usage des colorants dérivés de l’aniline dans les confiseries au motif que les quantités utilisées, infimes, ne peuvent pas provoquer d’empoisonnement. L’auteur évoque alors ici un problème abordé plusieurs fois par la suite mais peut-être pas de manière suffisante, à savoir la pression des industriels sur les autorités afin d’obtenir gain de cause. Un autre cas est évoqué : la pratique de l’utilisation de vieux papier pour l’emballage des denrées alimentaires. En 1897 le Comité consultatif d’hygiène publique émet un jugement final très nuancé. Enfin les récipients culinaires font l’objet également d’attention de la part des textes législatifs puisqu’une première ordonnance est promulguée le 16 juin 1839. Mais il faut attendre à nouveau aussi la période du Second Empire pour voir le problème resurgir avec une volonté de contrôler plus rigoureusement la nature et l’usage des matériaux pour les contenants métalliques. L’ordonnance du préfet de police datée du 28 février 1853, particulièrement rigoureuse et précise, fait l’effet d’une bombe dans les milieux concernés (marchands de vin, bouchers et tous fabricants de produits alimentaires ainsi que les revendeurs…) car ils sont obligés de revoir l’essentiel de leurs pratiques dans la mesure où elle proscrit nombre d’usages. Ainsi le cuivre est rigoureusement interdit pour le lait la bière et le vinaigre par exemple.
Naturellement l’auteur revient sur les boîtes de conserves, symbole de l’industrialisation de l’alimentation dont le développement est aussi lié, ne l’oublions pas, à l’histoire militaire et à la volonté de l’armée française de trouver un moyen de conserver des aliments dans le temps et dans des conditions de stockage et de transport difficiles. Si l’auteur choisit de ne pas s’étendre sur le travail de Nicolas Appert dans ce domaine ni sur la manière dont les consommateurs l’ont adopté au cours du XIXe siècle, elle revient par contre sur la question technique du soudage au plomb et l’ajout de sel de cuivre (pour le reverdissage des légumes en conserve) qui fait l’objet d’une réglementation précise. Enfin, cette première partie se termine sur deux points. Le premier concerne la promulgation des décrets des 15 avril et 28 juin 1912 concernant l’usage des colorants et l’interdiction d’utiliser un certain nombre d’additifs, ce qui est l’occasion de souligner que le secteur des sucreries et confiseries et du chocolat ont droit à des dérogations spécifiques, leur métallisation étant autorisée. L’auteur rappelle ici brièvement le poids et le rôle d’Eugène Roux directeur du service de répression des fraudes du Ministère de l’agriculture créé en 1907. Le second point concerne l’attention internationale, ainsi que le poids et le rôle de la France, active dans les travaux du Congrès de la société universelle de la croix blanche qui se déroule en septembre 1908 à Genève et dont l’objectif a été de définir l’aliment commercialement pur. Il est suivi en octobre 1909 à Paris par le Congrès international consacré à la répression des fraudes qui se donne pour objectif d’établir la liste des opérations utiles à la préparation des aliments.
Cette première partie se termine par une analyse certainement trop brève des sources utilisées et utilisables pour aborder par exemple la question de la contamination par les emballages alimentaires et additifs puisque comme le note Florence Hachez-Leroy il manque ici, à côté des médecins des chimistes et du législateur, la figure de l’usager.
*La deuxième partie est consacrée aux « batailles pour la régulation alimentaire en Occident de la fin du XIXe siècle aux années 1930 ».
Si le XIXe siècle peut être considéré comme une phase de définition des additifs en fonction des usages, il faut préciser que la régulation des additifs alimentaires par les Etats s’opère de manière différenciée. Mais un point commun est discernable : les grandes lois sur l’alimentation sont votées en Europe comme aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale. Un second existe et fait l’objet d’une étude approfondie de Florence Hachez-Leroy dans cette partie : l’aluminium est au centre de plusieurs polémiques qui éclatent en Occident à peu près au même moment.
La première sous-partie est intitulée : « quelle régulation alimentaire ? ». Cette première partie est consacrée d’abord à l’additif alimentaire en tant qu’objet urgent à réguler, car devenu nécessaire à l’alimentation dans la mesure où les conservateurs ont permis de réels progrès et ont contribué à la disparition des disettes, tandis que les colorants relèvent du confort esthétique. Au XIXe siècle « la recherche de nouveaux conservateurs et antioxydants à relever d’une volonté commune des militaires, des pouvoirs publics et des médecins hygiénistes d’améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et de les préserver plus longtemps afin de lutter contre les disettes »[3]. Cinq additifs sont mentionnés ici : les nitrites dont l’usage est actuellement remis en question, les colorants chimiques, les arômes qui ont permis le développement de nouveaux produits de consommation (sodas, crèmes glacées…), les modificateurs de textures comme les émulsifiants qui agissent sur la consistance de l’aliment en le modifiant ou en le stabilisant, et enfin les enzymes indispensables dans la fabrication des boissons alcoolisées, du pain et du fromage. L’emploi des additifs alimentaires a débuté à la fin du XIXe siècle et, dès le départ, les congrès internationaux et les comités d’hygiène y consacrent une part de leurs réflexions. Mais les progrès qu’ils ont introduit dans la conservation les ont rendus très rapidement incontournables pour l’alimentation du XXe siècle. Dans ce chapitre l’auteur revient successivement sur la régulation de ses additifs en Europe (Angleterre, Allemagne) puis aux États-Unis. Le processus de régulation aux États-Unis a connu une étape fondamentale en 1906 grâces à deux lois promulguées sous le mandat du président Roosevelt : le Meat Inspection Act et le Federal Food and Drugs Act. Ils font suite à une prise de conscience qui a débuté dans les années 1870 sur la côte est du pays et plus particulièrement dans les zones urbanisées où la population devient très vite sensible aux pratiques douteuses et aux altérations des denrées. Florence Hachez-Leroy mentionne dans ce cadre l’importance d’un roman The jungle publié en 1905 par l’écrivain engagé Upton Sinclair qui a eu pour effet de déclencher chez les consommateurs une vague de défiance voire de panique vis-à-vis de l’industrie de la viande.
La deuxième sous-partie, intitulée « le métal bon marché en proie à la suspicion » revient sur l’aluminium qui connaît une nouvelle étape dans sa fabrication grâce aux nouveaux procédés établis par deux français, Paul Heroult et Charles Martin Hall, ce qui permet ainsi de le banaliser. Dès lors la production mondiale s’envole d’autant qu’elle trouve des applications concrètes dans le domaine militaire non seulement pour la fabrication des matériels de tir des explosifs mais aussi des diverses formes d’emballage dont les boîtes de conserve. La France devient le premier producteur mondial d’aluminium. C’est dans ce contexte qu’éclate une polémique au début des années 1890. En 1891, les chimistes allemands Anton Lubbert et Roscher publient un article dans lequel ils déconseillent l’usage de l’aluminium en particulier pour les gourdes des soldats. Les réactions, qui s’inscrivent dans le contexte de la rivalité franco-allemande, ne se font pas tarder. En France, l’armée répond ainsi par l’intermédiaire du docteur Joseph Balland.
L’auteur détaille ainsi dans les troisième et quatrième sous-chapitres suivants les diverses polémiques en exposant les arguments techniques et scientifiques de chacun des camps qui ont existé : en France entre Alfred Ditte et Henri Moissan, prix Nobel de chimie en 1906, mais aussi aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne comme celle qui oppose le biochimiste et dentiste William J. Gies, dont les travaux réalisés à l’Université de Columbia aboutissent et concluent que l’usage des composés d’aluminium dans l’alimentation, et le docteur Ernest Ellsworth Smith qui publie en 1928 Aluminum Compounds in Food qui est à la fois une synthèse des travaux réalisés depuis le XIXe siècle en Occident mais aussi un plaidoyer en faveur de l’usage des composés d’aluminium dans les levures chimiques et dans les additifs. Dans le même temps, cette dernière étude est très fortement critiquée par Harvey Wiley qui publie dans la revue Science la même année, un article où il rappelle que l’origine du débat reste le procès intenté par les fabricants de levure à la contre un autre fabricant de levure et il dénonce l’instrumentalisation des travaux scientifiques au profit des intérêts économiques des industriels. Il est noté également que cette bataille autour de la levure chimique à l’alun a également été lancée par un mouvement associatif opposé à la médecine officielle (dont la vaccination, et la pasteurisation) et qui n’hésite pas à présenter des témoignages de personnes présentées comme des victimes de l’aluminium mais que, bien sûr aucun médecin ou expert en toxicologie examinée. Déjà, dès les années 20 ainsi que la polémique sur l’aluminium rejoint le vaste monde des théories du complot. Mais cet aspect n’est pas développé dans le présent ouvrage.
Le lecteur pourrait sans doute estimer que Florence Hachez-Leroy n’insiste pas assez sur les conflits d’intérêts pouvant exister entre la demande des industriels, des états et des armées qui n’hésitent pas à commander des analyses, orientées, et les scientifiques qui s’y soumettent bien volontiers de comme ce fut le cas d’Henri Moissan. Ce serait oublier le caractère complexe de la démonstration qui a été produite dans une autre étude exemplaire, incontournable et magistrale, consacrée à l’industrie du tabac et signée Robert Proctor que Florence Hachez-Leroy mentionne par ailleurs[4]. Ceux qui ont d’ailleurs eu la chance de lire cette volumineuse étude comprendront aisément que le thème doit être traité à part.
La cinquième sous-partie revient sur la « quiétude française ». Ce dernier chapitre expose la spécificité française concernant l’aluminium depuis 1859 et les travaux de Sainte-Claire Deville. Celui-ci est considéré comme étant inoffensif malgré quelques épisodes et quelques brèves polémiques à la fin du XIXe siècle. Au contraire, le métal fait l’objet d’un très large consensus scientifique comme le montre notamment les travaux d’Auguste Trillat, chimiste entrée à l’institut Pasteur 1901 qui en devient en 1915 le chef du service de recherche appliquée à l’hygiène et conseiller du Ministère de la guerre et de la marine dans le domaine des nuages artificiels et de la protection des métaux légers contre la corrosion. Mais comme le note l’auteur, ses recherches effectuées dans le cadre militaire en particulier pour la production d’agents pathogènes à des fins de destruction massive sont restées secrètes. Le personnage est, lui aussi, représentatif des rapports complexes qu’entretiennent science et guerre. L’auteur d’ailleurs souligne bien dans la partie qui lui est consacrée, que peu de travaux abordent la question des relations de l’institut Pasteur avec les entreprises industrielles à l’exception des entreprises pharmaceutiques et qu’un champ de recherche reste encore ouvert. Cependant l’auteur affirme que la renommée de l’institut aurait calmé toute tentative critique et les polémiques concernant l’aluminium en France.
*La troisième grande partie, intitulé « la régulation des apprentis sorciers : emballages, additifs et contaminants alimentaires, de la fin des années 30 à la fin des années 1990 » se concentre plutôt dans un premier temps sur un autre matériau devenu incontournable : la cellophane.
La première sous-partie est très logiquement consacrée à « l’arrivée des plastiques dans l’emballage alimentaire ». Ce chapitre qui compte (seulement) 24 pages, débute avec la découverte du celluloïde (nitrate de cellulose) par John Wesley Hyatt en 1868 aux États-Unis. Jusqu’en 1939, 18 sortes de plastique sont introduites sur le marché. D’abord dépendant de l’Allemagne les États-Unis finissent par s’affranchir et construire leur propre centre de formation de recherche et de développement dans le domaine de la chimie et des plastiques. L’arrivée de la feuille cellophane, inventée en France et développée aux États-Unis par la société Du Pont, introduit une rupture : la cellophane est présentée alors comme étant le matériau permettant de conserver sainement les produits à l’abri des sources de contamination. Mise au point par l’ingénieur en textile d’origine suisse Jacques Edwin Brandeberger qui passe un contrat avec Du Pont, sa fabrication débute en 1908. Dès le départ, le problème de l’innocuité de la cellophane est posé et des recherches intensives sont menées. Elles aboutissent à la mise au point de la cellophane étanche en 1927, produit qui ne cesse d’être amélioré au fil du temps et des divers inconvénients rencontrés. Dans les années 30, Du Pont doit cependant faire face à la réaction de ses concurrents et en tête de liste des producteurs de papier et d’aluminium. Les réactions ne se font pas attendre puisque dans le même temps, parallèlement aux améliorations techniques Du Pont met de très gros moyens dans les campagnes de publicité en faveur de la cellophane en tant qu’emballage. Concernant la toxicologie, la société n’est pas en reste puisqu’en 1934, elle développe son propre laboratoire de recherche spécialisé dans les questions de santé au travail. Cette création est liée à l’apparition de cas de cancer de la vessie entre 1929 et 1932 chez des employés en poste dans une des usines productrices de colorants de la compagnie. L’innovation est majeure puisqu’il s’agit alors non seulement de protéger la santé des employés mais aussi celle des consommateurs. Ainsi l’entreprise anticipe sur la législation américaine.
La sous-partie intitulée « la perception du risque alimentaire et sanitaire dans les années 1970 » repose d’abord sur une observation globale : l’après Seconde Guerre mondiale est marquée par la place grandissante des associations de consommateurs dans le paysage économique. Connaître l’opinion publique, quantifier les avis, est désormais rendu possible par l’invention du sondage dans les années 1930. Or, les enquêtes d’opinion réalisées par le syndicat des producteurs des plastiques américains en 1972 et 1975 offrent un terrain de réflexion fécond pour comprendre à la fois le positionnement d’une industrie face aux risques industriels, ainsi que sur les stratégies mises en place par les entreprises pour anticiper, gérer ou résoudre les crises qui en résultent. Parmi les acteurs mobilisés par le projet, le cabinet de conseil en relations publiques, l’agence Hill and Knowlton est sollicitée car réputée pour avoir aidé efficacement l’industrie du tabac américaine à sortir de la crise de confiance profonde dans laquelle elle avait été plongée dans les années 1950[5]. L’auteur détaille ainsi les sondages réalisés dans les années 70, enquête qui met donc en évidence l’existence d’une conscience environnementale chez les consommateurs, conscience liée à l’usage des plastiques dans l’emballage et le conditionnement. On constate que certains thèmes, comme la nocivité des matériaux dans les usages quotidiens, sont peu présents parmi les préoccupations du public qui n’y voit aucun risque sanitaire. En revanche, le problème du traitement des ordures ménagères et de comportement individuel est vu comme étant très important. L’industrie plastique est bien identifiée par l’opinion publique comme source de problèmes pour la pollution de l’air, le traitement des ordures ménagères et la pollution de l’environnement. Mais quelles sont les solutions préconisées par les sondés ? Si le bannissement complet du plastique est rejeté en revanche, l’opinion approuve plutôt l’idée d’une limitation de son usage. L’auteur revient ensuite dans le cadre réglementaire français de l’après-guerre et sur la révision du décret de 1912 en mars 1958. Globalement, la confiance reste de mise. Puis l’auteur revient ensuite aux États-Unis et au tournant des années 1970 et l’affaire des dialysés de Denver et les soupçons pesant sur l’aluminium et à sa responsabilité sur la maladie d’Alzheimer. Enfin, l’étude se termine sur les années 90 et le fait que l’aluminium est devenu désormais une question de santé publique mondiale ainsi que sur le travail de l’OMS et de diverses associations et entreprises internationales sur la question.
Cette étude de Florence Hachez-Leroy est passionnante à lire en dépit de certaines grosses boulettes et oublis historiques. Il est difficile de croire par exemple que la Guerre Froide et la compétition scientifique que se sont livrés les Etats-Unis et l’URSS n’ait pas influencé la technologie de ces nouveaux contenants, mais il s’agit certainement d’un choix délibéré de l’auteur qui aurait préféré se concentrer sur d’autres aspects et qui ne pouvait simplement pas tout aborder. Le lecteur peut également avoir du mal à suivre les aller et retours entre les lieux et les matériaux et se retrouver frustré de ne pas avoir assez de développements sur les conséquences sociales et culturelles de l’arrivée de ces nouveaux matériaux. Mais, n’en doutons pas, d’autres études ne manqueront pas de voir le jour sur ses aspects …
***
[1] Page 9.
[2] Page 17.
[3] Page 98.
[4] Robert Proctor Golden holocaust. La conspiration des industriels du tabac, Paris, 2014, Editions des Equateurs, 698 pages.
[5] Cette crise avait été provoquée par la publication d’une étude publiée par le journaliste Roy Norr intitulé « Cancer by the Carton ». A la suite du travail du Cabinet l’industrie du tabac cessa d’utiliser les arguments médicaux pour vendre leur poison.