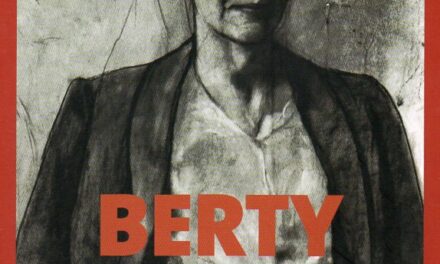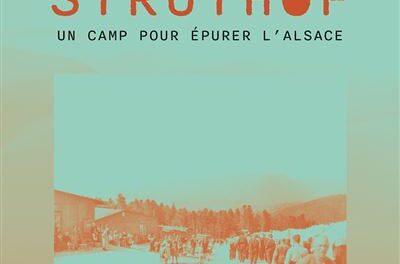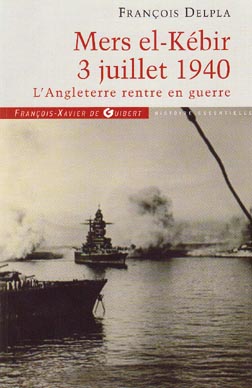
Le récit de la bataille navale
Ce récit ouvre le livre dans un très court premier chapitre. Signé avec l’Allemagne le 22 juin 1940 puis avec l’Italie deux jours plus tard, l’armistice dont la France a accepté les conditions est entré en vigueur le 25 juin. L’article 8 de la convention d’armistice impose à la marine française de regagner ses ports d’origine qui se trouvent en zone occupée. Le gouvernement anglais que dirige Winston Churchill et qui entend continuer la guerre ne peut accepter qu’Hitler ait ainsi la possibilité de s’en emparer. Il l’a fait savoir au gouvernement qui siège encore à Bordeaux et qui se prépare à s’installer à Vichy.
Le 3 juillet 1940 peu avant 18 h, une flotte de guerre britannique tire au canon sur les plus belles unités de la marine française stationnées dans la rade de Mers el-Kébir, près d’Oran, en Algérie. Le cuirassé « Bretagne » est coulé avec son équipage, le cuirassé « Provence » et le croiseur de bataille « Dunkerque » sont endommagés ainsi que le contre-torpilleur Mogador. Environ 1275 marins français sont morts : les Anglais viennent d’exécuter l’opération « Catapult » décidée par Winston Churchill.
Un ultimatum avait été signifié par l’amiral anglais Sommerville à son collègue français Gensoul en début de matinée. Gensoul avait à choisir entre plusieurs possibilités : les navires devaient appareiller pour rejoindre l’escadre britannique, à destination soit d’un port anglais soit des Antilles, ou être coulés, soit par eux-mêmes, soit par les Anglais. L’amiral Sommerville repoussa l’heure limite de l’ultimatum et s’efforça tout au long de la journée d’éviter le pire. Jusqu’au dernier moment Gensoul ne crut pas que Sommerville mettrait sa menace à exécution. Devant l’intransigeance française et la menace de voir arriver un renfort de la marine française, Sommerville exécuta la décision irrévocable de Churchill.
Sept chapitres sont ensuite consacrés à la genèse de cet événement ; sept autres étudient les causes immédiates et le processus de prise de décision. Le chapitre 16 raconte le déroulement de la journée et les tractations entre les amiraux ; le chapitre suivant en présente les conséquences sur le cours de la guerre. Le dernier chapitre est une approche historiographique et mémorielle du drame de Mers el-Kébir.
Hitler compte sur les défaitistes
Alors qu’il écrase la France, Hitler souhaite et croit possible une paix avec l’Angleterre ; il a connaissance de dissensions au sein du gouvernement britannique au sein duquel existe une tendance encore favorable à un politique d’« appeasement ». Il pense pouvoir contraindre la France et l’Angleterre à la paix ; il lui faut pour cela les diviser profondément afin de les amener à signer deux traités différents, séparés par plusieurs semaines. La flotte française sera un des éléments de ce grand jeu stratégique. Ainsi pourrait s’expliquer l’arrêt des Panzer le 24 mai 1940, à 20 km de Dunkerque « comme s’il voulait laisser un délai de réflexion au cabinet britannique » : il escompte qu’une rapide victoire sur le front de l’Ouest poussera Londres à se retirer du conflit, surtout si il réaffirme son désintéressement colonial.
Hitler mise sur les partisans de la paix au sein du gouvernement britannique ; il sait que des munichois y subsistent : Halifax, ministre des Affaires étrangères, reste effectivement partisan de la négociation avec l’Allemagne et d’une paix de compromis. Churchill fut résolument antimunichois et a constamment dénoncé le danger nazi depuis 1932. Pendant plusieurs semaines sa ligne politique de résistance à toute paix de compromis est contestée au sein du gouvernement et son maintien au pouvoir menacé. François Delpla a étudié cette question dans de précédents ouvrages.
Paul Reynaud n’est pas un Churchill français, comme il aurait aimé le faire croire. « Le président du Conseil français n’est nullement l’adversaire de l’armistice mais, clairement et fermement, celui d’un armistice séparé. » L’auteur s’efforce de démontrer « les efforts très concrets de Paul Reynaud pour solidariser les deux pays non pas dans la lutte, mais dans la capitulation ». « Paul Reynaud, s’il avait le défaitisme plus discret que Pétain et Weygand, ne voyait la solution de la France (…) que dans un arrêt prochain et général de la guerre, et aspirait à l’ouverture d’une négociation d’ensemble, dans laquelle les puissances anglo-saxonnes aideraient à modérer les gains allemands. »
Pétain pour sa part fait preuve d’un défaitisme profond depuis le début de la guerre ; il y a d’ailleurs longtemps qu’il pense que la France a bien mérité sa défaite par sa décadence.
Il n’y a que Churchill pour s’opposer aux défaitistes des deux côtés de la Manche.
L’article 8 de la convention d’armistice est-il acceptable ?
Entre le 12 et le 16 juin les membres du gouvernement français se rallient à l’armistice, y compris Darlan qui n’y met qu’une condition : que cet armistice soit « honorable ». Tous sont convaincus que la signature de l’armistice par la France sera suivie de près de celle de l’Angleterre.
L’article 8 de la convention d’armistice présentée aux Français dans le wagon de Rethondes stipule que les navires français doivent être stationnés dans leurs ports d’attache en temps de paix, tous situés en zone occupée sauf Toulon. Hitler veut éviter que la flotte française ne rejoigne l’Angleterre ; il connaît la complémentarité des deux flottes en matière de destroyers et il estime que ce serait une catastrophe pour l’Allemagne. En laissant la flotte à Vichy, il permet à Pétain de croire et de dire qu’il sauve quelque chose ; en réclamant son retour dans des ports occupés, il s’assure de la docilité de Pétain et il inquiète les Anglais.
A Briare le 12 juin 1940, Churchill (qui a été ministre de la Marine) a adjuré Darlan de ne pas livrer la flotte française. Darlan aurait répondu que ce serait « contraire aux traditions maritimes et à l’honneur ». Quand les conditions d’armistice sont connues à Bordeaux dans la nuit du 21 au 22 juin, plusieurs ministres du gouvernement sont indignés et envisagent de refuser l’armistice. Darlan en fait partie ; puis très vite il change d’avis et estime que les conditions « n’ont rien de contraire à l’honneur » : « Il lui a fallu moins d’une journée pour virer de bord, les effets démobilisateurs de la demande d’armistice s’avérant infiniment plus puissants que les appels de la conscience ».
L’ambassadeur anglais Campbell réagit dès qu’il a connaissance de ces conditions et souligne la « folie qui consisterait à faire la moindre confiance en la parole allemande si souvent violée » à propos de l’engagement allemand de ne pas s’emparer de la flotte revenue dans ses ports d’attache français. En effet, la Kriegsmarine serait en mesure de s’en emparer. A la réunion de cabinet du 22 juin, Churchill affirme que « dans une matière aussi vitale pour la sécurité de l’Empire britannique, nous ne pouvons pas nous permettre de nous fier à la parole de l’amiral Darlan (…) Il faudra peut-être bombarder les navires (…) Jamais, en aucune circonstance, il ne faudra permettre à ces navires de s’échapper ».
François Delpla fait une analyse systématique des télégrammes adressés par Darlan aux commandants de la flotte entre le 22 juin et le 3 juillet. Il y découvre que pour Darlan l’armistice est une nécessité non seulement militaire, mais morale et sociale et que l’anglophobie affleure à chaque paragraphe. Darlan a été anglophile mais il est devenu anglophobe : c’est un des acquis nouveau de cette étude de montrer qu’il l’est devenu bien avant Mers el-Kébir et non à la suite de Mers el-Kébir. Il l’est devenu quand il a compris qu’il s’était trompé sur l’Angleterre, qu’elle ne demanderait pas l’armistice, que Churchill resterait son dirigeant et qu’il maintiendrait sa volonté de continuer la guerre. Darlan devient alors un ferme défenseur de l’armistice qu’il trouve de plus en plus compatible avec l’honneur, de plus en plus favorable à l’avenir de la France… et à celui des officiers de marine. Et François Delpla de conclure « Darlan a sombré, avant Mers el-Kébir, dans une anglophobie quasiment pathologique, qui ne saurait être sans répercussion sur le comportement de son féal Gensoul » quand il recevra l’ultimatum de Sommerville.
La détermination de Churchill
Churchill annonça sans détour aux Français que s’ils persistaient à vouloir appliquer l’article 8, l’intention de son gouvernement était de s’y opposer par la force. Il imposa son point de vue à son gouvernement et deux plans furent préparés : l’un de débarquement anglo-gaulliste en Afrique du Nord (opération « Susan »), l’autre de neutralisation de la flotte française dans la rade de Mers el-Kébir (opération « Catapult »). Le projet de débarquement fut vite abandonné, tandis que l’autre était confirmé le 27 juin. De longues discussions permirent de préciser les conditions qui seraient proposées dans l’ultimatum posé à l’amiral Gensoul. Churchill dut user de toute son autorité pour imposer qu’en dernier recours la flotte puisse être détruite par les canons anglais.
Il fit expédier à Sommerville dans la nuit du 2 au 3 juillet le message personnel suivant : « Vous êtes chargé d’une des missions les plus désagréables et les plus difficiles qu’un amiral britannique ait jamais eu à remplir, mais nous avons la plus entière confiance en vous et comptons que vous l’exécuterez rigoureusement » Il espère que la négociation entre les amiraux conduira à éviter un bain de sang.
Mers el-Kébir : « une onde de choc planétaire »
En coulant la flotte française Churchill voulait « faire au monde (…) la démonstration de son inflexibilité antinazie ». Il y est parvenu. Il obtient le soutien unanime de la Chambre des Communes et Halifax celui de la Chambre des Lords. Roosevelt qui avait sans doute été averti de l’opération, est désormais convaincu que l’Angleterre va tenir et qu’il va devoir la soutenir.
De Gaulle a été tenu à l’écart de l’opération. Dès le 8 juillet il l’approuve publiquement : « Le gouvernement qui fut à Bordeaux avait consenti à livrer nos navires à la discrétion de l’ennemi. Par principe et par nécessité, l’ennemi les aurait un jour employés, soit contre l’Angleterre, soit contre notre Empire. Eh bien je dis sans ambages qu’il vaut mieux qu’ils aient été détruits ».
A Vichy, tous les responsables envisagent l’instauration de l’état de guerre avec l’Angleterre. « Si cette guerre n’a pas eu lieu » affirme l’auteur, « c’est parce que l’Axe n’en veut pas ».
Hitler est « profondément choqué ». Il doit constater qu’il n’y a plus de partisan de la négociation avec l’Allemagne au sein du gouvernement anglais, lui qui spéculait depuis des mois sur l’isolement des tendances bellicistes au sein du parti conservateur. Il en résulte un brusque changement de ses plans stratégiques. Puisque l’Angleterre continue la guerre, il envisage d’entreprendre plus tôt la guerre contre l’URSS ; le virage est annoncé dès le 13 juillet 1940. Dans cette perspective, il convient de décourager les velléités guerrières de Vichy contre l’Angleterre. Il en résulte aussi l’abandon du projet de déportation des juifs d’Europe vers Madagascar qui s’inscrivait dans le cadre d’une paix signée avec l’Angleterre et d’un partage colonial. La conquête prochaine de l’URSS ouvre une « solution » terrestre à la « question juive ».
Staline s’oriente vers une coopération plus étroite avec l’Allemagne nazie. La perspective, avant le 3 juillet, d’une paix anglo-franco-allemande, était pour l’URSS des plus redoutables. Cette hypothèse étant éliminée, « la logique du pacte germano-sovétique reprend le dessus. Staline se remet à spéculer que Hitler ne risquera pas une guerre sur deux fronts ».
Au terme de cette étude détaillée, l’auteur estime avoir démontré que la décision de Churchill a été « le fruit d’un calcul rationnel face à deux défis d’ampleur inouïe : empêcher an dernier moment un triomphe de Hitler, et décider les Etats-Unis à soutenir ses adversaires ».