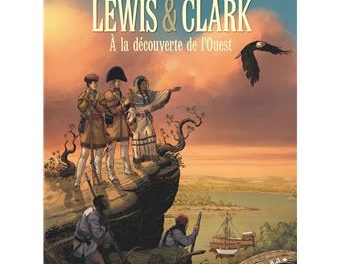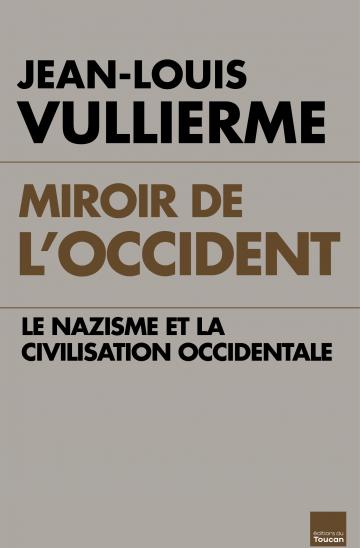
Normalien agrégé de philosophie, docteur en droit et docteur en sciences politiques, spécialiste des approches cognitives en sciences sociales, Jean-Louis Vullierme, qui a enseigné à la Sorbonne, nous propose, avec Miroir de l’Occident, une analyse et une explication du nazisme : « J’appartiens à une famille en partie détruite par le nazisme et ayant lutté contre lui. C’eût été un motif suffisant de m’y interesser davantage que d’autres, mais il n’est pas le principal. Il m’a toujours paru décisif de comprendre ce qui constitue l’événement le plus destructeur de l’histoire moderne, d’en identifier les racines pour chercher à les extirper. Je jugeai également que la mémoire des morts exigeait à tout le moins que l’on sût pourquoi ils avaient tant souffert. Or la compréhension ne m’était pas immédiatement accessible. » (p. 9).
« Un intentionnalisme réaliste »
L’auteur présente une interprétation qu’il qualifie d’ « intentionnalisme réaliste » (p. 354) : « Il m’est apparu, en effet, qu’il est vain d’enquêter sur le sens d’un processus historique sans s’interroger en premier lieu sur l’intentionnalité de ses acteurs les plus centraux. L’exploration des causes ne saurait évidemment s’y arrêter, puisque les intentions ont plusieurs sources, et puisqu’elles ne sauraient être mises en œuvre hors d’un contexte matériel qui leur soit favorable. Pourtant, c’est bel et bien l’intentionnalité qui donne son sens humain aux choses et il n’est nullement permis de l’écarter si l’on tient à comprendre. » (p. 13). Il s’appuie donc, en les prenant au sérieux (« La lecture des textes écrits par les nazis eux-mêmes oblige à l’effort particulièrement désagréable de prendre au sérieux leurs propos, de leur prêter intelligence, aptitude au raisonnement articulé, et d’admettre que leur mode d’expression n’était pas uniquement le mensonge » p. 15) sur le Journal de Goebbels, les écrits et déclarations publiques (discours, proclamations, directives) et privées (propos de table, lettres, testaments, propos rapportés par des proches) d’Hitler, certains discours d’Himmler (en particulier celui prononcé à Posen/Poznan le 4 octobre 1943 devant les dignitaires SS), des écrits de Rauschning et Speer. L’ouvrage repose aussi sur une abondante bibliographie de 13 pages, mêlant entre autres des articles et ouvrages sur le nazisme (français et anglais ou américains), des textes de philosophes (Hegel, Fichte, Heidegger, Lévinas, Hobbes, Rousseau, Montesquieu par exemple), des auteurs longuement analysés dans certains chapitres (Henry Ford, Madison Grant par exemple), et sur un imposant appareil critique (un peu plus de 120 pages de notes, certaines très longues, un véritable livre dans le livre, avec sur certains chapitres un décalage d’une note par rapport au corps du texte…).
Après un prologue et une introduction sur le procès de Nuremberg (lu comme le procès où les vainqueurs ont tout mis en place pour échapper à l’accusation de « génocide »), dans une première partie intitulée « L’idéologie de l’extermination », sept chapitres sont consacrés à l’analyse du nazisme et de ses sources : des commentaires sur « l’antisémitisme industriel » socioéconomique et l’antijudaïsme socioreligieux qui l’avait précédé à partir de l’époque de Charlemagne ; un long chapitre (le plus long du livre) sur le modèle américain (d’antisémitisme industriel, de suprématisme racial et d’eugénisme, de conquête territoriale et de soutien passif) ; l’examen de la « révolution nationaliste » née de la Révolution française, puis du colonialisme (extra-européen avec l’exemple des Hereros, intra-européen avec la domination de l’Irlande par la Grande-Bretagne) ; l’étude de « l’action historique » (chapitre consacré à l’historicisme, au positivisme juridique et au terrorisme d’État, au militarisme, au populisme, au messianisme charismatique et au bureaucratisme) et enfin celle de « l’Antagonisme ». La seconde partie, intitulée « Sortir de l’idéologie de l’extermination », propose en deux chapitres des « thérapies cognitives » pour en sortir, et un examen des résurgences de l’Antagonisme (avec en particulier le conflit israélo-palestinien).
L’« Antagonisme », reflet d’un « désordre cognitif »
La thèse de l’auteur est assez simple à résumer : les sources du national-socialisme résident toutes dans la civilisation occidentale, et l’originalité du nazisme est d’avoir été le seul mouvement à les avoir toutes rassemblées. Ces sources sont nombreuses : « suprématisme racial, eugénisme, nationalisme, antisémitisme, propagandisme, militarisme, bureaucratisme, autoritarisme, antiparlementarisme, positivisme juridique, messianisme politique, colonialisme, terorrisme d’État, populaisme, jeunisme, historicisme, esclavagisme » (p. 22), sans oublier deux autres éléments désignés par un néologisme : anempathisme (« éducation à n’accorder aucun sentiment à la souffrance d’autrui » p. 22 ) et acivilisme (« absence de toute protection spéciale accordée aux populations civiles dans les opérations militaires ou policières » p. 22). Le trait commun à chacune de ces sources du nazisme réside dans ce que Jean-Louis Vullierme appelle l’« Antagonisme » : « Ce qui caractérise spécifiquement l’idée antagoniste est de se construire, non en vue d’une finalité propre et en un contraste naturel avec des idées concurrentes, mais en opposition proactive à des groupes humains ui représentent pour elle une altérité qu’elle vise à combattre » (p . 283). L’Antagonisme « structure » chacune des sources du nazisme dans « l’opposition à des hommes ». : il prévoit la destruction de l’adversaire, quel qu’il soit (la nation ennemie, la race inférieure, les invalides et les malades, les administrés, les classes sociales jugées déviantes, la minorité des voix dans une démocratie…), et est le reflet d’un « désordre cognitif ».
C’est pourquoi on peut remédier à ce qui a produit le nazisme – et qui selon l’auteur continue à ronger l’Occident – en agissant sur soi, c’est-à-dire sur ses cognitions, afin d’éradiquer tout élément (racisme, populisme, colonialisme…) ayant contribué à son succès. Une charte thérapeutique est proposée sous la forme de huit commandements (dont l’auteur reconnaît la naïveté) adressés au lecteur, à l’image des Dix Commandements de Moïse : par exemple « Tu ne feras pas l’Homme à ta propre image », « combattras les actions adverses et non pas leurs auteurs, et ne désigneras aucun groupe comme étant ton adversaire, dont tu ne peux individualiser les membres », « Tu agiras sur toi-même pour agir sur la société (…) » ou « Tu t’efforceras d’élargir la communauté humaine ».
Un livre certes érudit mais…
Incontestablement l’analyse développée par Jean-Louis Vullierme, qui prend ses exemples et ses arguments de l’Antiquité au XXe siècle, de l’Europe à l’Amérique et aux empires coloniaux européens, est érudite. Mais on peut lui faire des critiques de méthode et des critiques de fond.
Les critiques de méthode d’abord. On aurait aimé que les citations de Hitler ou d’autres dignitaires nazis majeurs soient mieux contextualisées : elles le sont parfois (par exemple tout le passage sur le discours d’Himmler à Posen en 1943 sur l’extermination des Juifs), mais on a souvent l’impression que Jean-Louis Vullierme décrit une doctrine immobile, figée et « intemporelle », et non une pensée en mouvement, sauf à penser que le Hitler des années 1920 est le même que celui des années 1930 ou de la guerre, ou qu’il tient les mêmes propos au Club de l’Industrie de Düsseldorf en 1932, aux cadres du Parti en 1933 ou au Reichstag en 1939 (avec copie transmise au gouvernement des États-Unis)… S’il y a beaucoup d’histoire dans la description des sources occidentales du nazisme, on aurait pu en attendre plus sur le nazisme lui-même. Ce qui nous conduit à nous interroger sur certains manques dans la bibliographie utilisée : par exemple pourquoi ne pas avoir utilisée de biographie d’Hitler (Kershaw par exemple, retenu uniquement pour son historiographie du nazisme), de Goebbels ou Himmler (Longerich par exemple), ou encore Christian Ingrao, Croire et Détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, 2010 qui aurait pu apporter de précieux éclairages sur le rôle de la Première Guerre mondiale et la nazification des esprits dans le monde universitaire avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir ? Utiliser Johann Chapoutot, Le national-socialisme et l’Antiquité, 2008 ou les travaux de Léon Poliakov sur l’histoire de l’antisémitisme ou le mythe aryne aurait pu apporter (ou non) de l’eau au moulin de Jean-Louis Vullierme… qui fait par ailleurs des choix très pertinents pour nourrir certains chapitres (ainsi celui sur le modèle américain repose largement sur les ouvrages, cités dans la bibliographie, de Stefan Kühl et Max Wallace).
Dernier reproche sur l’utilisation de la bibliographie : le manque de distance. Par exemple le chapitre 2 intitulé « Un modèle américain » repose essentiellement sur les ouvrages de Stefan Kühl (The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, Oxford University Press, New York, 1994), Max Wallace (The American Axis. Henry Ford, Charles Lindbergh, and the Rise of the Third Reich, St. Martin’s Press, New York, 2004), Carroll P. Kakel III. (The American West and the Nazi East : A Comparative and Interpretative Perspective, Palgrave Macmillan, 2011) et Edwin Black (War against the Weak. Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, New York – Londres, 2003), qui sont utilisés par Jean-Louis Vullierme pour définir un « modèle américain » du nazisme pour l’antisémitisme industriel, le suprématisme racial et l’eugénisme, la conquête de l’Est slave (avec dans le chapitre un passage sur le Parti unique modelé sur le PCUS stalinien qui me semble hors sujet dans le chapitre et qui élargit singulièrement l’aire de la « civilisation occidentale »), sans indiquer que ces thèses sont très discutées (particulièrement Kakel et encore plus Black pour ses raccourcis et approximations). Là encore un regret donc, que l’auteur ne se fasse pas l’écho de ces discussions historiques (particulièrement sur le partage entre inspiration réelle et autojustification des dirigeants nazis lorsqu’ils se référaient aux États-Unis) et qu’il n’utilise pas l’abondante bibliographie disponible sur les racines du pangermanisme allemand (entre autres et par exemple les travaux en français de Michel Korinman) et sur la conquête de l’Est slave (pas une nouveauté dans le monde germanique, déjà au Moyen Âge les chevaliers Teutoniques…).
Autre manque bibliographie, à mon sens, qui renvoie à un manque du livre : des ouvrages et une discussion sur les concepts de « civilisation » et de « civilisation occidentale ». Cela nous amène à la thèse de fond, le nazisme produit de la civilisation occidentale dont il précipite différents éléments. Cette thèse n’est pas nouvelle, elle a une histoire, qu’on aurait aimé voir rappelée, de Hannah Arendt à Max Horkheimer, Theodor Adorno et Zygmunt Bauman. Enzo Traverso s’opposant à Furet, Nolte et Goldhage, a développé cette même thèse dans La Violence nazie. Une généalogie européenne, Paris, La Fabrique Éditions, 2002, ouvrage qui, étonnamment, ne figure pas dans la bibliographie (mais figurent, du même : Le totalitarisme – Le XXe siècle en débat (textes choisis), Seuil, 2001 et L’histoire comme champ de bataille – Interpréter les violences du XXe siècle, La Découverte, 2012). Cette thèse est discutable et discutée, notamment parce l’on pourrait tout aussi bien définir le nazisme comme une idéologie anti-occidentale, l’Occident étant défini par l’humanisme, les Lumières, le libéralisme politique (mis dans le livre sur un pied d’égalité avec le communisme et le nazisme, comme des historicismes). On pourrait aussi objecter que les différentes sources du nazisme énumérées au début du livre peuvent se retrouver dans l’histoire d’autres parties du monde. Et pourquoi se priver de l’examen détaillé de concepts très employés, dans les analyses du nazisme, comme le totalitarisme, la modernité (« ils ont chacun pour effet de conduire à des réductions » p. 355), la « religion séculière » ou de la notion de violence (« qui renvoie à une réalité anthropologique universelle mais peu déterminée. (…) La culture occidentale, qui s’autorise d’extrêmes violences, ne les préconise que rarement, même s’il existe en elle un culte esthétique de la violence militaire qui a trouvé dans le fascisme son apogée. » note 10 p. 480-481) alors que le concept d’Antagonisme semble aussi universel et pas plus opérant ?
Enfin Jean-Louis Vullierme échoue à expliquer pourquoi le nazisme apparut en Allemagne et pas ailleurs en Occident, ou plutôt il ne se pose cette question fondamentale que dans les pages 289-290 et 354-355 de son essai, pour y répondre de façon trop lapidaire à mon sens : « La relative unité idéologique occidentale dominante s’est exprimée sous des modalités différentes dans les pays considérés qui ont, chacun à leur manière, poursuivi leur propre Sonderweg (chemin particulier), mais dont aucun n’était possible isolément. La voie propre à chaque région a été conditionnée par cette matrice commune, tout en se dotant naturellement de caractères locaux compatibles avec elle. En d’autres termes, le nazisme est un phénomène allemand profondément enraciné dans la civilisation occidentale, et les actes qui le caractérisent avaient alors acquis une probabilité élevée de s’y produire. » (p. 354-355).
Sur la partie thérapeutique de l’essai, qui sort du champ de l’analyse historique, le lecteur se fera son opinion. Pour le reste, Jean-Louis Vullierme nous propose une interprétation « à charge » et une grille de lecture qui peinent à convaincre.
Laurent Gayme
Copyright Clionautes/Cliothèque