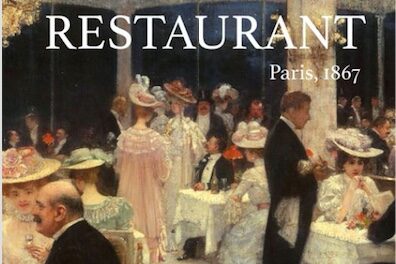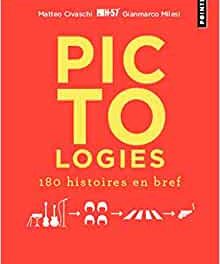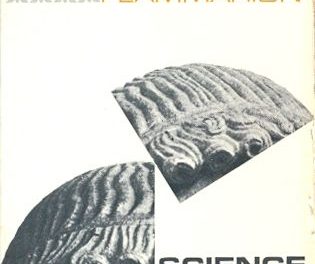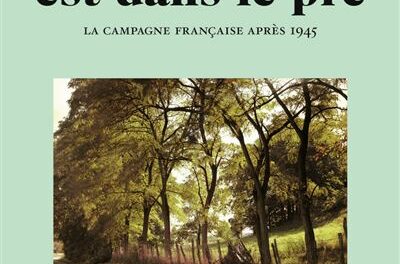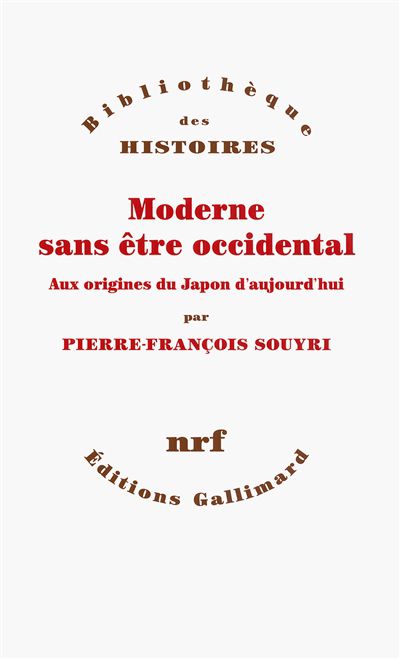
En effet, on est souvent fasciné vu de France par ce Japon qui semble marier la modernité technologique la plus avancée avec un respect et un poids important des traditions. Pierre-François Souyri décortique ce paradoxe dans un ouvrage d’une qualité intellectuelle très stimulante. Le choix a été fait dans ce compte-rendu de citer assez longuement l’auteur, tant ses formules synthétisent de façon efficace un sujet qui pourrait sembler complexe.
« Nous ne sommes pas les dépositaires uniques de la modernité »
Dans l’introduction, l’auteur livre d’abord quelques principes de méthode. C’est une pierre de plus à l’édifice qui invite depuis maintenant plusieurs années, et sous la plume de grands auteurs, à désenclaver l’histoire, à la rendre plus globale. Pierre-François Souyri souligne d’ailleurs que « les Européens admirent … l’histoire des autres quand ils en avaient une » si elle est « intemporelle, immobile, invariante ou cyclique, dans tous les cas antihistorique ». Etudier le Japon implique peut-être encore une difficulté supplémentaire car le pays a produit à son propos une puissante historiographie. On ne peut donc pas faire comme si on abordait un espace vierge. Dans tous les cas, il faut cesser d’associer de façon systématique et unique, Occident et modernité et c’est ce à quoi s’emploie Pierre-François Souyri dans cet essai dense et très argumenté. Comme il le dit dès le début de son ouvrage, « des formes spécifiques de la modernité sont nées au Japon avec leurs dimensions propres hybrides et hétérogènes…. Il évoque les travaux de S. N Eisenstadt et la possibilité de « modernités multiples ».
La tentation de l’Occident
Au milieu du XIXème siècle, le Japon commence à changer, mais l’auteur tient à préciser que les changements ont commencé avant 1868, date souvent vue comme « la » rupture. Il faut donc se défaire d’un simplisme qui définirait le shogunat comme immobile. En effet, cette période a aussi développé des contacts avec l’Occident, enclenchant ainsi en quelque sorte la modernisation. « Voyager à l’étranger, traduire des langues occidentales vers le japonais, débattre tels sont les trois grandes pratiques nouvelles autour desquelles s’est affirmé le mouvement des Lumières à la japonaise ». L’auteur rapporte aussi la difficulté de traduire certains mots ou notions. Il ne faut jamais oublier de retracer le « cheminement cahotique », le débat politique qui agita le pays entre deux conceptions de la modernisation du pays : « ceux qui prônaient le développement des prérogatives de l’Etat » et il fallait donc importer « les technologies de l’Occident sans pour autant s’embarrasser de ses idées » et puis ceux qui « pensaient que la marche en avant du pays ne pouvait faire l’économie d’une extension des prérogatives du peuple ». « Mais les deux courants apparurent de façon simultanée et pas toujours contradictoire ». Dans cette dernière formule, on perçoit toute la difficulté de penser autrement la modernité japonaise, qui ne peut se résumer à un affrontement binaire et simpliste entre des Anciens et des Modernes. Le Japon se trouve donc confronté à un ensemble de débats qui nous font penser à l’Occident de l’époque : quelle place pour la représentation politique, quel système scolaire et quel développement économique notamment ? L’exemple des femmes permet de se rendre compte des débats qui agitent alors le pays. Avouons au passage qu’il s’agit sans doute pour beaucoup d’un pan peu connu de l’histoire japonaise et l’auteur nous le fait revivre de façon très vivante. En effet, il propose des portraits de combattantes de l’époque comme Kishida Toshiko. Elle prit la parole en public pour exprimer ses idées politiques. Dans un discours, elle utilisa la formule des « filles en boite » pour désigner la condition subalterne des femmes.
Un peuple, une nation, une culture
Le Japon s’est donc construit progressivement sa modernité. Pendant vingt ans, « le débat qui mobilisa les énergies …portait principalement sur l’élargissement des droits du peuple compris comme l’accession des classes moyennes …..à des formes de partage du pouvoir ». En 1889, les choses sont définies avec la mise en place d’une Constitution autoritaire. A partir de ce moment-là, ce furent d’autres débats qui se posèrent dans le pays et notamment la question de l’identité. Celle-ci oscille entre trois éléments : l’Occident et son influence, la Chine et le Japon « dont il fallait redéfinir l’essence entre les deux pôles précédents ». Le Japon a donc élaboré son modèle qui ne doit pas être vu comme un retour en arrière. Dans ce chapitre aussi Pierre-François Souyri examine des trajectoires pour bien faire comprendre cette voie japonaise. Tokutomi Sohô développa sa réflexion autour du thème de la démocratie, du productivisme et du pacifisme. « L’éveil du nationalisme ne peut être considéré comme le résultat d’une exportation d’une idée européenne et ne se réduisait pas à en être un succédané ». « Face à la pensée des Lumières qui dans les années 1870, prônait l’adoption des valeurs occidentales et rejetait la tradition asiatique, ou à celle des droits du peuple qui, vers 1880, considérait la possibilité d’une cohabitation entre valeurs occidentales et certaines valeurs asiatiques…., le mouvement nipponiste pense, vers 1890, que la modernisation implique une occidentalisation oppressante, et cherche une issue dans une modernité différente. »
Nation, nationalisme, asiatisme
Le Japon se trouve donc face à un choix cornélien car, pour être indépendant, il faut s’occidentaliser, c’est-à-dire prendre ce qui permet de se développer, et en même temps si on s’occidentalise, on perd une forme d’indépendance. On comprend mieux dès lors le choix fait par le pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il choisit l’alliance avec les Etats-Unis. L’Orient devint donc aussi au Japon un objet de fantasme et Pierre-François Souyri évoque notamment la figure d’Okakura Tenshin, intellectuel japonais qui souligna combien la culture japonaise était liée à la culture asiatique. Pour lui « le Japon était en train de trahir l’Asie à vouloir se comporter comme les Occidentaux ». Cet asiatisme fut pourtant parfois récupéré par les tenants d’un impérialisme nippon. Il est frappant de voir ici combien ce qu’on considère parfois comme immémorial est en fait le résultat d’une création récente. Le souverain au Japon joua donc un rôle crucial car il devait à la fois incarner « la marche en avant du pays tout en l’ancrant dans une histoire immémoriale » avec par exemple la création de cérémonies : « on inventa alors une tradition » : tout est dit dans cette formule. Cet exemple japonais fait penser d’une certaine manière aux travaux d’Anne-Marie Thiesse qui dans « La création des identités nationales » insistait déjà pour l’Europe sur le fait que les identités nationales ne sont pas des faits de nature, mais des constructions. Pierre-François Souyri revient sur quelques concepts difficilement compréhensibles ou traduisibles pour nous Européens. A ce titre, on peut citer le kokutai qui désigne « la particularité nationale que constitue la dynastie impériale qui dirige le pays depuis toujours et pour l’éternité ». A quoi donc finalement ressemble l’Etat japonais ? C’est « une forme de syncrétisme dans lequel la pensée confucéenne la plus conformiste s’allie avec les préceptes nationaux de la pensée autochtoniste, se mélange avec des formes de darwinisme social et de nationalisme moderne ». Cependant, il ne faut pas oublier que cette modernisation ne fut pas qu’un long fleuve tranquille.
Devant l’injustice
Des critiques contre la modernisation à la japonaise commencèrent à se faire entendre et s’en prirent à certaines caractéristiques de ce développement. Parmi les cibles, il y eut le productivisme ou encore l’impérialisme. Dans le premier cas, il faut citer la trajectoire et les combats de Tanaka Shôzo. Une fois de plus l’auteur donne à voir des figures souvent méconnues en Europe. Il retrace l’épisode des mines de cuivre d’Ashio qui résume beaucoup d’aspects des débats d’alors. Exploitées dès le XVI ème siècle, ces mines étaient peu productives. L’introduction de techniques modernes occidentales a relancé l’exploitation. Le Japon exportait 80 % de sa production, il devint le deuxième producteur mondial et à elles seules les mines d’Ashio représentaient 30 % de la production japonaise. Elles furent donc le lieu d’une « triple bataille stratégique pour l’exportation du cuivre sur le marché mondial, l’amélioration des conditions de travail …des mineurs, et pour la justice sociale et défense des droits minimums des paysans qui vivent dans une région dévastée par les ravages que subit l’environnement ». Pour Shôzo, l’industrialisation ne « créé pas les conditions de l’amélioration de l’existence du peuple mais…suscite désespoir et misère ». Pierre-François Souyri compare même ce cas à l’affaire Dreyfus du Japon par rapport aux questions qu’il pose. On peut faire plusieurs lectures de son combat : doit-on voir en lui un homme de l’ancien régime qui se bat contre la nouveauté, un représentant du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple, un militant environnementaliste ? La réponse est sans doute un peu de tout cela car les formes de pensée s’entremêlent. Tanaka incarnait « le cheminement des idées dans le Japon en marche vers la modernité ». Parmi les autres oubliées, les femmes qui en 1902 représentaient plus de 50 % de la force de travail dans l’industrie et même 80 % dans le textile. « La modernisation japonaise avance, avec ses spécificités idéologiques, ses références particulières, selon un rapport qui n’est ni « décalé » ni en « retard » par rapport à l’Occident. »
Au total, le livre de Pierre-François Souyri est un véritable tour de force : décloisonnant l’histoire, il aide à comprendre cette spécificité japonaise, appelons-la ainsi. C’est un livre exigeant car la plupart des faits cités sont peu ou pas connus du lecteur non spécialiste, mais en incarnant à chaque fois son raisonnement par des exemples, l’auteur ne se livre pas à une analyse uniquement conceptuelle. Un livre majeur indubitablement.