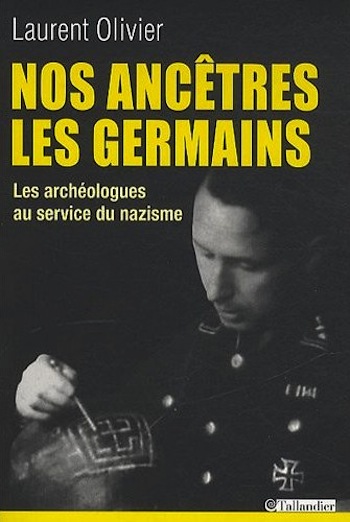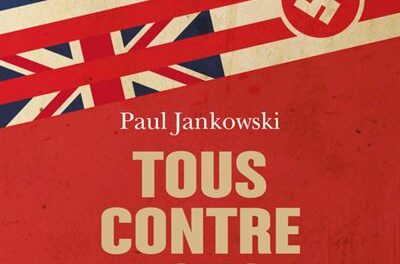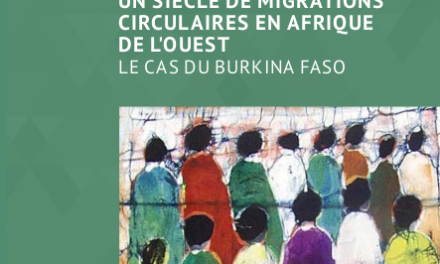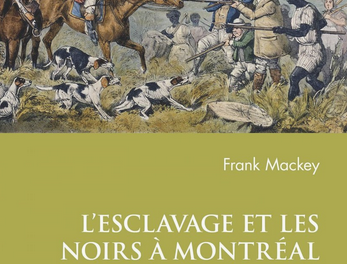En temps ordinaire, les archéologues grattent le sol à la recherche des traces du passé. Adepte de la mise en abyme, Laurent Olivier, conservateur en chef du patrimoine au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, gratte en outre les plaies de sa confrérie et y débusque les traces d’un passé peu avouable. Tel est l’objet de cette synthèse détonante, qui constitue une plongée historique et historiographique tout à la fois engagée, vivifiante et salutaire, quoiqu’à certains égards irritante, dans les couches stratigraphiques de sa discipline.
S’en dégage le tableau, effarant par son ampleur, de la mainmise idéologique opérée par le nazisme sur l’archéologie. Niche écologique choyée par le régime hitlérien, elle était considérée comme une «science raciale» destinée à légitimer le projet national-socialiste et sa lecture militante de l’Europe et de son passé. La corporation des spécialistes se met avec ardeur à son service, et en tire d’importants avantages professionnels et scientifiques. Théâtre d’une lutte d’influence entre les fidèles d’Alfred Rosenberg et la phalange SS de Himmler, cette archéologie militante privilégie trois périodes d’étude, la préhistoire, la protohistoire et le haut Moyen Âge, en dédaignant ouvertement l’archéologie classique. L’enjeu est autant géopolitique qu’idéologique : les traces et interprétations d’un peuplement germaniques antérieur doivent justifier revendications pangermanistes, colonisation raciale et conquêtes territoriales. De gros moyens sont consacrés à cette arrogante nazification du passé.
La France est une des terres de conquête de cette entreprise. Les archéologues nazis y programment des fouilles ambitieuses et encouragent les séparatistes régionaux à cultiver leurs parentés aryennes présumées. La croix gammée étend son ombre odieuse sur les alignements de menhirs de Carnac. Ici et là, certains chercheurs locaux éblouis ou opportunistes s’enrôlent de façon plus ou moins caractérisée au service de la croisade germanique victorieuse. De son côté, le régime de Vichy patronne une «archéologie de la défaite» qui valorise le passé gaulois et romain, entre idéologie organique et posture d’obstruction passive à l’égard de la germanisation rétroactive opérée par l’occupant.
Après-guerre, la forte politisation de l’archéologie est largement mésestimée et lui permet de passer au filtre d’une dénazification indulgente. La continuité des hommes, des pratiques, des thèmes de recherche et même des interprétations à peine reformulées (l’archéologie aryenne maquillée en «archéologie européenne» demeure une archéologie identitaire) est forte. L’héritage est d’autant plus équivoque que l’archéologie nazie a combiné approche interdisciplinaire, modernité scientifique et volonté militante. Authentique archéologie d’avant-garde, elle a acclimaté des méthodes et des procédures qui sont la matrice de l’archéologie d’après-guerre. De son côté, le régime de Vichy a enfanté le cadre juridique et fonctionnel de l’archéologie française actuelle.
Étayé par une bibliographie copieuse, cet essai passionnant et passionné a le grand mérite de proposer une synthèse claire et facile à lire, qui porte à la connaissance des lecteurs français les acquis de l’historiographie allemande sur un thème longtemps occulté, en les élargissant au versant français du sujet. L’intérêt de ce livre est puissant et indéniable. Mais certains de ses aspects n’emportent cependant pas une entière adhésion. Détail formel non dénué d’importance, le mérite réel de la présence d’un index, outil précieux quand il est fiable, est amenuisé par l’omission dans ce répertoire de certains personnages pourtant parfois évoqués avec insistance, tels Hans Möbius, Gerhard von Tevenar ou Leo Weisgerber.
Sur le fond, tous les arguments présentés ne sont pas de la même vigueur. La dénonciation de la dimension française de la nazification archéologique est moins consistante sur le fond que dans la forme. C’est ainsi que l’importance accordée au pro-nazi bourguignon Johannès Thomasset semble amplifier l’épaisseur de ce malfaisant esseulé, sans position institutionnelle et déjà retiré de l’archéologie active. Par ailleurs, la thèse du «grand refoulement» de l’héritage sournois du nazisme formulée par Laurent Olivier repose sur un postulat de table rase qui paraît aventureux. Car, sous sa plume, le procès rétrospectif de l’archéologie raciale s’élargit à un soupçon global véhiculant une malédiction générique. Les considérables acquis antérieurs de la discipline auraient-ils donc été intégralement balayés sans retour par la contamination nazie ? Le lecteur non initié, ébahi par la virulence du ton adopté par ce professeur de vertu revendiquant assez pompeusement une «pensée de la résistance», peut sans doute y entrevoir les attendus d’un moins noble règlement de comptes entre écoles archéologiques, où le Jean Moulin par procuration se place explicitement dans l’allégeance des conceptions américaines des années 1960-1970. Cet enjeu, dont l’appréciation ne peut que laisser perplexe hors du cercle des spécialistes, brouille ponctuellement les lignes de force d’un ouvrage par ailleurs appréciable. En dévoilant avec éclat le croisement, d’autant plus vertigineux qu’il pouvait sembler anodin, entre l’histoire de l’archéologie et le nazisme, Laurent Olivier met le doigt sur les risques d’enrôlement et de manipulation du passé même le plus lointain. Le cas d’école est spectaculaire, et sa leçon salutaire.