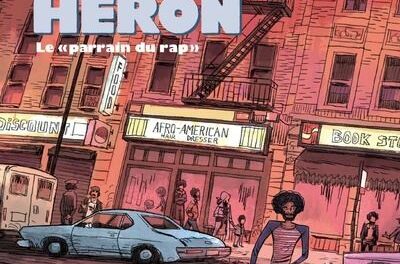La revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique,
Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
Cette revue a été publiée successivement par plusieurs éditeurs : Gallimard (n° 0) en 2003, Armand Colin (n° 1 à 6, H-S n° 1 et 2) de 2004 à 2006, Pepper / L’Harmattan (n° 7 à 20, H-S n° 3 à 9) de 2007 à 2013, Classiques Garnier (n° 21 et 22, H-S n° 10) en 2014 et, enfin, les PUR (depuis le n° 23 et le H-S n° 11) à partir de 2016.
La revue Parlement[s]. Revues d’histoire politique – Hors-série n° 18 a pour thème : Objets politiques. Ce dix-huitième dossier Hors-série a été coordonné par Catherine Brice (Professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) et Emmanuel Fureix (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC). Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la [Recherche] (avec 7 contribution de 7 chercheurs, jeunes ou confirmées) et la seconde à des [Sources] (au nombre de 5) commentées par 5 enseignants-chercheurs : Marie-Karine Schaub (Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC), Olivier Christin (Professeur à l’Université de Neuchâtel, directeur d’études à l’EPHE -Paris), Emmanuel Fureix, Catherine Brice, Manuel Charpy (Chargé de recherche au CNRS, InVisu), Nicolas Offenstadt (Maître de conférences HDR à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC) et Bibia Pavard (Université Panthéon-Assas, Carism, Institut universitaire de France) ainsi qu’ Arriana Arisi Rota (Professeure d’histoire contemporaine, département des Sciences politiques et sociales, Université de Pavie, Italie), Enrico Francia (Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Padoue), Fanny Gallot (Maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC), Pierre-Emmanuel Guigo (Maître de conférences en histoire, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) et Emmanuel Fureix. De plus, dans ce numéro, nous trouvons à nouveau une partie consacrée à des [Lectures] (au nombre de 4) critiquées par 3 historiens (Catherine Brice, Laurent Bourquin et Déborah Dubald).
En introduction (p. 9-18), Catherine Brice (Professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) et Emmanuel Fureix (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC) présentent ce hors-série en se proposant de réfléchir, dans une perspective historique, aux modalités d’incorporation de la politique dans des objets. Certains objets permettent de saisir finement la matérialité de ce qui fait le cœur de la politique au sens large : non seulement la souveraineté, la prise de parole, la représentation, la protestation voire l’émancipation, mais aussi la domination sociale ou sexuelle et le contrôle biopolitique des individus. Ces objets politiques peuvent devenir, en situation, agissants. Ils s’insinuent dans les relations sociales les plus ordinaires comme dans des événements qui viennent briser le cours de l’histoire, et sont eux-mêmes doués d’une vie et d’une « agentivité » sociales. De l’époque moderne à aujourd’hui, articles de recherche et commentaires de sources traitent d’une large gamme d’objets sur des espaces variés, de la RDA au Congo, de la France à l’Italie.
[RECHERCHE]
R 1- Le cadeau diplomatique à l’époque moderne : au croisement des relations internationales et de l’histoire matérielle : (p. 19-32)
Marie-Karine Schaub (Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Le cadeau diplomatique à l’époque moderne est l’objet d’une attention particulière de la part des acteurs de la diplomatie d’alors comme des historiens qui se penchent désormais sur ce sujet aujourd’hui. Alimenté par les apports du renouveau de l’histoire diplomatique, de l’histoire matérielle et visuelle ainsi que de l’histoire connectée, cet article propose un état historiographique de cette question et permettra de montrer que ces objets sont désormais étudiés comme d’excellents observatoires des échanges diplomatiques et de la communication politique à l’époque moderne.
R 2- Mœurs anciennes, hommes nouveaux : les couronnes civiques : (p. 34-47)
Olivier Christin (Professeur à l’Université de Neuchâtel, directeur d’études à l’EPHE – Paris)
L’iconographie d’une plaque de giberne de la Garde Nationale, conservée dans les collections du Musée de l’armée à Paris, illustre la place rapidement prise dans la langue révolutionnaire et dans sa mise en image par la couronne civique empruntée à l’histoire de la République romaine. Associant vertu, citoyenneté, dévouement à la cause de la Nation et de la liberté, elle dessine quelques-uns des contours nouveaux de l’engagement politique.
R 3- La souveraineté incarnée : des bustes de monarques dans la tourmente (France, 1814-1870) : (p. 48-64)
Emmanuel Fureix (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Les bustes de monarques sont envisagés ici comme des objets permettant d’observer les relations des individus à la souveraineté incarnée dans un siècle postrévolutionnaire. La dissémination de ces bustes vise à occuper le vide laissé par le pouvoir après la Révolution française, à conjurer les souverainetés alternatives et à incarner l’extension de l’État administratif. L’article étudie la vie sociale, les pratiques et les gestes associés à ces bustes, allant de leur exposition et acclamation à leur destruction, ainsi que les regards qui leur sont portés et leur relation à l’espace public, semi-public et privé. L’accent est mis sur l’agentivité prêtée à ces bustes par les acteurs, une agentivité réversible dans des conjonctures fluides, révolutions et restaurations. La destruction ou la profanation des bustes affirme visuellement la vacance de la souveraineté et son transfert à un « peuple » aux contours incertains.
R 4- Économie politique d’un objet en révolution : les barricades romaines de 1849 : (p. 65-80)
Catherine Brice (Professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Objet éminemment politique, la barricade s’avère, dans le contexte romain de 1849, être en fait inscrite dans une logique politique de mobilisation, plus que d’insurrection. Elle constitue également un marqueur de la conviction républicaine des Romains et en particulier du peuple civil de Rome – hommes, femmes et enfants – aux côtés des militaires ; elle joue également un rôle d’amortisseur social dans cette capitale profondément bouleversée, instituant une microéconomie de guerre.
R 5- Objets contradictoires. Rumeurs et objets importés à Léopoldville et alentours au milieu du XXe siècle : (p. 82-105)
Manuel Charpy (Chargé de recherche au CNRS, InVisu)
Cet article cherche à comprendre la manière dont la rumeur peut être mobilisée en situation coloniale. Entre les années 1940 et l’indépendance, une rumeur protéiforme est identifiée par les renseignements généraux belges à Léopoldville-Kinshasa et alentours qui voudrait que des Blancs, aidés d’auxiliaires noirs, et circulant en automobile, hypnotisent des Congolais avec une torche électrique puis les piquent avec une seringue et les engraissent avant de les envoyer en Angleterre ou en Amérique d’où ils reviennent sous forme de conserves de corned-beef. La rumeur se fixe ainsi sur une série d’objets importés, censés apporter le « progrès ». Par la rumeur, les populations expriment des peurs dont notamment celle du travail forcé et de l’enrôlement obligatoire, contredisent le regard colonial, notamment sur le cannibalisme, et retournent les objets de l’exercice du pouvoir contre le pouvoir colonial et ses formes locales.
R 6- Les objets de la RDA. Une politique du quotidien : (p. 106-132)
Nicolas Offenstadt (Maître de conférences HDR à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC)
Les objets politiques ne sont pas simplement ceux explicitement désignés comme tels. Dans le contexte de la Guerre froide, de la concurrence entre les deux Allemagne, du projet socialiste, les objets de tous les jours sont aussi des enjeux politiques : c’est en particulier le cas en RDA, tant pour fonder une « consommation socialiste », voire une civilisation nouvelle, que dans la prétention à rivaliser avec l’économie de la RFA et face aux insuffisances d’approvisionnement. Cet article inscrit la vie des objets de l’Allemagne de l’Est, depuis les questions de fabrication jusqu’à leur rejet en 1989-1990, dans cet ample contexte.
R 7- « Ceci n’est pas un cintre ». Une histoire de la politisation des objets de l’avortement : (p. 133-155)
Bibia Pavard (Université Panthéon-Assas, Carism, Institut universitaire de France)
Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, le cintre est aujourd’hui brandi par les féministes pour évoquer les affres de l’avortement clandestin. Ce symbole politique n’est pas neuf, il était déjà présent dans les années 1970 pour revendiquer l’avortement libre. Prenant acte de cette généalogie, l’article retrace trois entreprises distinctes de politisation des objets de l’avortement en France métropolitaine : la promotion néo-malthusienne de la maternité consciente par la diffusion de la connaissance des objets médicaux au début du XXe siècle, la promotion du planning familial dans les années 1950 et 1960 par le dévoilement public des objets de l’avortement clandestin et la promotion de l’avortement libre et gratuits dans les années 1970 par la prise en main de nouveaux objets.
[SOURCES]
S 1- Le fauteuil des derniers moments : de l’artisan chinois à Vincenzo Vela, histoire d’une « relique » napoléonienne : (p. 158-165) avec une traduction par Guillaume Lagrée
Arriana Arisi Rota (Professeure d’histoire contemporaine, département des Sciences politiques et sociales, Université de Pavie, Italie)
Dans l’article d’Arianna Arisi Rota, il est question d’imaginaire napoléonien. Il s’agit ici non pas d’objets fabriqués en série et circulant clandestinement, mais d’un objet singulier, unicum qui fait office de relique mémorielle : le fauteuil de malade utilisé par Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène, fabriqué en 1818, avec des bras pour porter une chandelle et une tablette mobile. L’autrice propose une lecture quasi biographique de cet objet et de son iconisation. Après la mort de Napoléon, le fauteuil a été vendu aux enchères et a changé de propriétaires à plusieurs reprises. En 1866, l’artiste italien Vincenzo Vela a réalisé une sculpture de Napoléon assis sur ce fauteuil, devenue une véritable icône politico-mémorielle. Des reproductions en bronze de cette sculpture ont été largement diffusées et sont recherchées par les nostalgiques de Napoléon. Le fauteuil est ainsi devenu un symbole du déclin physique de Napoléon, mais aussi de son charisme politique.
Ce fauteuil est lié au déclin de sa santé, qui finit par conditionner ses jours et ses nuits à Longwood. Ce fut le médecin Barry O’Meara qui révéla dans son journal, à la date du 23 octobre 1816, la requête que lui avait faite Napoléon lui-même pour un fauteuil de malade qui puisse évidemment lui permettre de travailler dans une position confortable, comme alternative à son bien aimé lit de camp et au sofa. Le médecin transmit la requête au gouverneur Hudson Lowe, lequel consentit à en faire fabriquer un, puisqu’un tel objet n’existait pas sur l’île. Presque deux années ont été nécessaire pour que le fauteuil fût finalement réalisé et attribué, le 19 mai 1818, même si la lenteur à satisfaire les requêtes de l’illustre prisonnier faisait partie de la stratégie d’usure typique du nouveau gouverneur. Le fabricant fut probablement un artisan chinois de la communauté de Cantonais présente à Sainte-Hélène. Construit en acajou, le fauteuil était conçu pour les jours d’indisposition. Absent du Mémorial de Las Cases, qui quitta l’île en décembre 1816, le fauteuil de malade et son usage effectif par Napoléon n’ont pas laissé d’autre trace discursive que des témoignages contemporains et mémoriaux se limitant à faire référence à l’ex-empereur assis dans le fauteuil, sans spécifications ultérieures.
S 2- 12 000 Napoléons aux portes. Une enquête de police dans la France de 1823 : (p. 167-176) avec une traduction par Guillaume Lagrée
Enrico Francia (Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Padoue)
Après la mort de Napoléon, commencèrent à apparaître dans les provinces françaises des objets de nouvelle facture. Aux images impériales et dynastiques s’ajoutaient celles qui représentaient le Napoléon anti-Bourbons des Cent-Jours, le prisonnier de Sainte-Hélène puis l’Empereur mort, martyr, endormi dans l’attente de la résurrection ; ou encore Napoléon anticlérical ou carbonaro. Leur nature se diversifiait aussi : n’étaient plus seulement présents dans les marchés et boutiques les traditionnels bustes, statuettes et estampes mais aussi de nombreux objets d’usage commun sur lesquels avaient été reproduites des images de Bonaparte, du duc de Reichstadt ou des épisodes saillants de l’épopée napoléonienne. Un ensemble impressionnant de produits et d’images étaient fabriqués en France et aussi dans de nombreuses autres régions européennes. À l’exemple des 12 000 Napoléon révélés par l’enquête de police de 1823 qui ressemblaient à une figurine de quelques centimètres, qui avait à la base un timbre et qui pouvait aussi être portée au cou comme un collier. Napoléon est représenté dans une attitude pensive avec les bras croisés, une pose déjà présente dans diverses estampes de la période impériale et aussi des Cent-Jours, mais qui connaît une consécration définitive surtout dans les années de l’exil et immédiatement après sa mort.
Enrico Francia évoque ici les 12 000 bustes de Napoléon recherchés en 1823 par la police française, inquiète de voir l’image de l’Empereur honni se répandre dans le pays. Cet épisode témoigne de la vivacité d’un marché des objets napoléoniens, marché transnational nécessitant des relais dans les douanes et chez les intermédiaires pour échapper à la surveillance. Les autorités étaient préoccupées par le potentiel de ces objets à raviver des sentiments de rébellion et de nostalgie pour l’Empire.
S 3- Appropriations politiques des objets du travail reproductif de 1945 aux années 1980 : (p. 177-184)
Fanny Gallot (Maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil)
L’enjeu de cette contribution est de souligner les appropriations politiques variées des objets du travail reproductif car, si les objets ont un genre, ils se trouvent investis de causes distinctes. De 1945 aux années 1960, des organisations catholiques féminines et communistes s’appuient sur les objets pour favoriser l’implication des femmes, notamment de classes populaires. Puis, considérés comme des symboles de l’assignation au domestique, ils sont vilipendés par les féministes dans les années 1968, tandis qu’ils peuvent être mis en avant par les travailleuses professionnelles qui les utilisent ou les produisent, à l’image de la photographie qui rend visible une manifestation de gardien·nes d’immeubles et de concierges portant des balais devant l’hôtel de ville de Paris, le 22 mai 1987, pour revendiquer la sauvegarde de leur emploi et qui font ainsi valoir l’utilité de leur travail [document 1].
Investis par des organisations, des mouvements sociaux et des actrices variées, les objets du travail reproductif participent à la mise en question d’un ordre du genre auquel s’articulent des enjeux de classe. Si les organisations catholiques et communistes ont recours à ces objets pour impliquer les femmes de classes populaires sans remettre fondamentalement en cause l’inégale répartition des tâches dans la famille au moins jusque dans les années 1970, des discours féministes tentent d’articuler les deux dimensions. Enfin, arborant des balais ou des appareils électroménagers, les travailleuses professionnelles mobilisées pour leurs emplois n’hésitent pas à « troubler » l’image agonistique des manifestations.
S 4- Le général et son micro : (p. 186-197)
Pierre-Emmanuel Guigo (Maître de conférences en histoire, Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Avec son képi, le micro semble en effet l’objet le plus associé à la figure du fondateur de la Ve République, au point d’être qualifié par le régime de Vichy d’abord, puis de façon plus large, de « général micro ». De simple instrument de diffusion et d’enregistrement sonore, apparu à la fin du XIXe siècle, et particulièrement utile dans une société médiatisée, le microphone ou transducteur électroacoustique – synthétisé en micro – est devenu au fil du temps un objet symbolique du pouvoir et de sa contestation. Dans cet article, l’auteur cherche à voir comment cette association entre de Gaulle et son micro se forme et se transforme dans le temps au point de faire désormais partie de l’imaginaire politique commun.
S 5- La casserole comme objet politique : du charivari à la casserolade (XIXe XXIe siècle) : (p. 198-207)
Emmanuel Fureix (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Face à un rituel nouveau et dissonant, le recours à une généalogie – qu’elle soit infamante ou glorieuse – devient une arme politique autant que rhétorique. Pour les uns, la casserolade trouverait ses origines dans des rassemblements « populistes » d’extrême droite – des foules poujadistes ou partisanes de l’Algérie française aux adversaires du socialiste chilien Salvador Allende au début des années 1970. Pour les autres, les concerts de casseroles seraient au contraire des rites de résistance aux dérives autocratiques ou aux trahisons des élites lors des crises financières : en Argentine en 2001, en Islande en 2008 (la « révolution des casseroles », qui aboutit à la démission du premier ministre en janvier 2009), en Espagne en 2011 autour des « Indignés », au Québec en 2012 autour du mouvement étudiant, etc. En ce sens, les casserolades françaises de ces dernières années ne seraient que le dernier avatar d’un rituel largement mondialisé et adapté à la crise de la représentation démocratique et politique. Mais l’on peut aussi remonter bien en amont cette généalogie, si l’on songe à la diffusion dès le XIXe siècle des charivaris politiques, concerts assourdissants visant à l’humiliation des adversaires politiques.
La casserolade d’aujourd’hui, comme le charivari du XIXe siècle, vient, en complément de la représentation électorale, exercer un contrôle civique sur des représentants jugés défaillants. Face au blocage de la délibération parlementaire, face à la surdité des pouvoirs, face à l’impuissance des manifestations classiques, la casserolade fabrique du neuf avec de l’ancien. Elle fait ainsi figure de symptôme : elle rend davantage visible – ou audible – une crise de la représentation démocratique tant de fois diagnostiquée. Le fait qu’elle emprunte à un répertoire d’action propre à des sociétés pré-démocratiques n’est de ce point de vue pas le meilleur des signes quant à la bonne santé de la démocratie de 2023. De tout cela, la casserole est sans doute le nom, d’autant plus que s’y est accroché (dans la seule langue française) un autre signifié, absent au XIXe siècle : la casserole judiciaire, synonyme d’une affaire impossible à oublier…
[LECTURES]
L 1- Christopher Fletcher (ed.), Everyday Political Objects. From the Middle Ages to the Contemporary World, London-New York, Routledge, 2021, 300 p. par Catherine Brice (Professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) (p. 213-217)
Dans ce volume dirigé par Christopher Fletcher, la coordination de pas moins de 15 chapitres couvrant une très longue période, du Moyen Âge au XXe siècle, constitue un véritable tour de force. Présenter des objets du quotidien qui assument une valeur politique entraîne, inévitablement, quelque chose d’une liste à la Prévert. On découvre tour à tour les bagues et les cors de chasse médiévaux, des théières, tabatières et éventails, des chaussures de bois et des Wellington boots, casseroles et objets séditieux de tous types, mais aussi le phonographe, ou le Browning, un javelot ou le « diafilm » roumain des années 1950-1989. Qu’est-ce que ces objets ont en commun ? Ce sont des objets « de tous les jours » qui ont un rôle politique. Toutefois, les qualités politiques acquises par ces objets en apparence banals suivent des chemins qui peuvent être extrêmement différents. La politisation peut être assez directe lorsque ces objets sont utilisés dans un contexte de sédition et d’opposition, comme ceux étudiés par Emmanuel Fureix dans la France de la Restauration, ou encore dans les charivaris des années 1880 en pays minier (Adrien Quièvre). Dans ces cas, ce sont bien les conditions d’utilisation qui confèrent à ces casseroles, poêles et autres objets un caractère politique – et une certaine efficacité.
On le voit, ce livre collectif est d’une très grande richesse. Il met en évidence les parcours sinueux de la « politisation » des objets quotidiens : politisation par l’usage, par le contenu, par l’apparence ; mais aussi les transformations inscrites dans le temps de cette politisation. Un objet peut être rechargé puis déchargé de sa valeur politique en fonction de son utilité ou de ses usages, du contexte et aussi des caractéristiques de l’espace public selon les époques et les lieux. Devant ce foisonnement parfois déroutant – tout objet est-il, in fine, politique ? – il est sûr qu’une typologie des objets eux-mêmes, mais surtout des modalités de leur politisation est nécessaire. Et il semble bien que le champ de la recherche soit prêt pour cette opération essentielle, afin de donner à l’étude des objets politiques davantage de clarté et d’efficacité.
L 2- Yves Carlier et Hélène Delalex (dir.), Louis XV : passions d’un roi, Paris-Versailles, In Fine Éditions d’Art-Château de Versailles, 2022, 496 p. par Laurent Bourquin – Le Mans Université (p. 217-219)
Ce catalogue, dirigé par deux conservateurs du patrimoine au château de Versailles, a été publié à l’occasion d’une grande exposition qui s’est tenue du 18 octobre 2022 au 19 février 2023. Il rassemble les contributions de plus de soixante-dix auteurs, qui présentent et mettent en perspective une très riche iconographie représentative des goûts de Louis XV, de sa famille et de sa cour. Il ne s’agissait pas de dresser un panorama des arts au XVIIIe siècle comme l’avait déjà réalisé une grande rétrospective, restée célèbre, à l’hôtel de la Monnaie en 1974. L’ambition de la présente exposition était différente, car elle visait à rassembler des objets ayant meublé Versailles et qui, de ce fait, avaient un statut particulier, parce que soit ils avaient été choisis par Louis XV, soit faisaient partie de son environnement quotidien, soit témoignaient de ses goûts et de ses préoccupations intellectuelles. Le catalogue présente des centaines d’objets – peintures, sculptures, estampes, mobilier, orfèvrerie, livres, manuscrits… – et propose une série de mises au point thématiques structurées en trois parties. « L’homme privé » se consacre à la personnalité du monarque (son enfance, son rapport à la religion), à son entourage (sa famille, ses maîtresses) et aux grands événements de sa vie (son sacre, l’attentat de Damiens…). « Goûts et passions d’un roi » développe son intérêt pour les sciences, la bibliophilie, le théâtre, la chasse… La troisième partie, enfin, questionne la posture du souverain face à l’art de son époque et la façon dont il a pu encourager diverses productions – en particulier à travers son mécénat personnel et les manufactures royales. L’ensemble est d’une qualité irréprochable : les reproductions photographiques sont très respectueuses des couleurs, et les textes d’un grand intérêt. En outre, les équipes de Versailles ont pu faire venir du monde entier des pièces souvent exceptionnelles, dont la confrontation permet de comprendre pourquoi ces objets sont, à des degrés divers, des objets politiques.
L 3- Silvia Cavicchioli, I cimeli della patria. Politica della memoria del lungo Ottocento, Rome, Carocci, 2022, 279 p. par Catherine Brice (Professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) (p. 219-222)
C’est un ouvrage passionnant et neuf que nous propose Silvia Cavicchioli, professeure à l’Université de Turin et responsable scientifique du Musée du Risorgimento de la capitale piémontaise. C’est d’ailleurs de l’intérêt croisé pour l’histoire de la mémoire de la période du Risorgimento, et de la proximité avec les objets conservés dans ces musées historiques – bien étudiés par Massimo Baioni –, que l’on peut lire la naissance de ce livre.
En l’intitulant « les reliques de la patrie », l’auteur s’inscrit dans un filon qui avait été lancé par Lucy Riall en 2010, puis repris par – entre autres – Pierre-Marie Delpu : celui d’une lecture de la lutte italienne pour la liberté et l’indépendance comme une religion politique, avec ses martyrs laïcs et ses reliques, lecture correspondant en partie à la perception qu’en avaient les protagonistes et amplifiée par la mémorialistique post-unitaire. Et elle croise aussi l’histoire matérielle, celle des objets qui « restituent des vérités dramatiques », suscitant recueillement et mobilisation, une approche récemment développée en Italie par Carlotta Sorba, Enrico Francia ou Gian Luca Fruci. Le grand intérêt de l’ouvrage réside d’abord dans la prise en compte de ces reliques sur une période longue, confluant dans la grande exposition patriotique de Turin en 1884 ; et surtout de s’intéresser de manière très concrète à la façon dont ces objets ont été recueillis, identifiés, avant d’être exposés. Ce que Silvia Cavicchioli appelle le « nation-building par le bas ». Reliques patriotiques de la lutte politique et reliques militaires des guerres menées pour l’indépendance constituent les deux grands corpus étudiés, depuis la botte de Garibaldi trouée par un projectile, la tunique de la Garde nationale, jusqu’aux armes et munitions, sans oublier les corps et restes humains recueillis et exposés – à l’instar des martyrs catholiques.
Il s’agit là d’un ouvrage important, original par l’attention portée à la constitution de ces collections d’objets, au rôle des amateurs, des proches, des intermédiaires. Si l’on voulait être chagrin, on aimerait sans doute en savoir davantage sur les usages matériels de ces collections, de ces musées : comment les visitait-on ? En groupe, en famille, seul ? Quels « rituels » étaient attendus ? Quels parcours incitaient à suivre un ordre, et lequel ? Et devant ces reliques, est-ce que l’on se recueillait ? Enfin, Silvia Cavicchioli insiste avec raison sur la circulation de leurs images, de leurs histoires : comment fonctionnaient alors ces « reliques diffuses » ? On aimerait bien sûr que le livre soit traduit car, au-delà d’un exemple national, il y a là un bel exercice de méthode, de rigueur et un questionnement tout à fait exemplaire.
L 4- Mark Thurner et Juan Pimentel (dir.), New World Objects of Knowledge. A Cabinet of Curiosities, Londres, University of London, 2021, 278 p. par Déborah Dubald – Sage, Université de Strasbourg (p. 222-225)
Faire d’un livre un cabinet de curiosité, un « petit musée » qui n’existerait qu’entre deux couvertures (p. 1), telle est l’ambition de l’ouvrage collectif dirigé par Juan Pimentel et Mark Thurner. À partir d’une quarantaine de courtes notices, le collectif d’auteurs et autrices réinterroge les histoires, les vies et les postérités d’objets provenant du « Nouveau Monde », l’Amérique Latine, sur une période s’étirant de « l’Âge d’Or » espagnol jusqu’à l’époque contemporaine.
En dépit de ce regard inégalement critique sur la colonialité des objets, il faut souligner que l’ouvrage est une contribution importante, en accès ouvert et richement illustrée, à l’histoire matérielle des savoirs, en réaffirmant l’enchevêtrement des objets dits artistiques ou scientifiques dans des enjeux politiques pensés par le prisme de la production et de la circulation des savoirs. Le classement art/nature pose certes un problème, mais il mène aussi à une proposition originale permettant la relecture d’objets de collection contemporains par le prisme d’un regard moderne. Il ouvre la voie à des chemins de traverse pour s’affranchir des catégorisations savantes fixées au XIXe siècle.
Ainsi, saisis dans un temps long soulignant la pluralité de leurs temporalités, les objets présentés montrent la nature du travail historien sur le temps des matérialités. L’exemple du caoutchouc (Bertol Domingues & Carreón, p. 51-56) ou de la teinture noire (Masters, p. 67-75) met en exergue des savoirs botaniques matérialisés dans des techniques de culture, de représentations naturalistes et d’appropriation de savoirs locaux. Le megatherium (Pimentel, p. 231-236) révèle la concurrence européenne, par le truchement des musées nationaux de sciences, dans la construction des puissances nationales.
Cet ouvrage témoigne d’une histoire matérielle des savoirs qui reste en chantier. Il permet de faire émerger certaines de ses apories et difficultés, notamment dans l’écriture d’une « histoire à parts égales » (Bertrand, 2011) des objets. Toutefois, en dépit de ces faiblesses, ce petit musée de papier est un nécessaire plaidoyer pour une histoire politique des objets.
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)