
Survenu à l’orée de l’indépendance algérienne, dans un climat mêlant angoisse et rancœur alors que l’OAS, dont Oran était un des bastions, vient à peine de déposer les armes après des semaines de nihilisme jusqu’auboutiste, le drame frappe une communauté pied-noire en détresse, sous les yeux d’une armée française passive. Le 5 juillet 1962, une fusillade aux causes indéterminées exaspère la foule des Algériens venus fêter l’indépendance dans le centre de la ville. La situation dégénère en une émeute sanglante qui dure plusieurs heures. Cette explosion de vengeance collective, qui purge des années de guerre coloniale, prend pour cible la population européenne de la ville, dont les morts et les disparus se comptent par centaines. Ni la réaction des nouvelles autorités algériennes, ni celle du commandant des forces françaises à Oran, l’attentiste général Katz, ne sont à la mesure des circonstances.
Cet épisode tragique, qui accélère et amplifie fortement la fuite massive des pieds-noirs vers la métropole, demeure un sujet sensible et controversé. Drame fondateur de la mémoire d’exode des pieds-noirs, le massacre d’Oran a en revanche été escamoté par les Algériens et est resté méconnu ou indifférent du côté français. Manipulé avec circonspection par les historiens, il a malgré tout donné lieu à d’amples spéculations historiographiques. Le champ des interprétations est d’autant plus large que le périmètre des certitudes est incertain. Côté algérien, le manque de pièces d’archives fiables est criant. Inaccessibles ou inexistantes, elles ne permettent pas de consolider ou d’invalider les éclairages partiels permis par l’ouverture récente des archives françaises. L’essentiel des sources disponibles s’est donc longtemps réduit à la presse de l’époque et à des témoignages chargés d’affect, de rumeurs invérifiables, de réquisitoires sans nuances et de plaidoyers divergents. Dans ce vide de l’histoire, la parole partisane des factions protagonistes a donc pu imposer la tonalité, soit passionnelle soit absolutoire, du discours des mémoires. Luttant pour obtenir la reconnaissance de ce qu’elle considère comme un crime occulté, celle des pieds-noirs est la plus radicale dans ses affirmations.
C’est donc dans un véritable champ de mines que le professeur Pervillé, l’un des plus éminents spécialistes universitaires actuels de la Guerre d’Algérie, a choisi de s’engager à son tour. Pour ce faire, il aborde le drame d’Oran sous l’angle de la réflexion historiographique. Suivre le fil conducteur des progrès de la recherche lui permet d’enjamber habilement l’hémiplégie des sources, qui assure la prédominance des arguments mémoriels. La synthèse qui s’en dégage est nourrie par de longs extraits analysés des travaux publiés sur la tragédie d’Oran. A travers l’évolution de l’historiographie, les faits se précisent, se corrigent, et des enjeux de fond se dégagent. Le débat historique se polarise ainsi sur trois questions centrales : la bataille des circonstances, la bataille des bilans, et la bataille des responsabilités. Sur tous ces points, Guy Pervillé dessine l’état des lieux avec beaucoup de rigueur et de pédagogie. Malgré la persistance de bien des imprécisions, la première semble la moins embrumée et écarte assez nettement toute implication de l’OAS. Après avoir fluctué entre outrance et minimisation, le bilan humain paraît à présent à peu près établi, dans son ampleur (700 victimes) comme dans l’atrocité de ses modalités. Le chantier le plus opaque demeure celui des responsabilités, qui pointent une pluralité de facteurs : culpabilité morale de l’OAS, passivité personnelle du général Katz, procès de complicité ou d’abstention par raison d’État fait au pouvoir gaulliste, « terrorisme silencieux » de l’ALN, impuissance des responsables algériens de transition, éventualité d’un complot interne au FLN. Seule sans doute l’ouverture des archives algériennes, si elles existent, permettrait désormais de faire avancer le dossier.
Pour qui le drame d’Oran ne constitue pas un repère identitaire, le travail du professeur Pervillé constitue en tout cas une belle leçon de méthode et de pondération historique, confortée par un appareil critique exemplaire, des cartes des lieux et un index. Par-delà la manière dont s’est construite la représentation des faits et la façon dont a évolué leur interprétation, le plus singulier est de constater combien ce massacre a peu marqué l’histoire de la Guerre d’Algérie. Un effacement qui entretient la mémoire meurtrie des pieds-noirs. Car l’amnésie est pire qu’un oubli : elle résonne comme un déni de souffrance presque aussi terrible que le traumatisme fondateur. Au fond, c’est sans doute cela que d’être broyé par le sens de l’Histoire : être voué à l’indifférence.
© Guillaume Lévêque

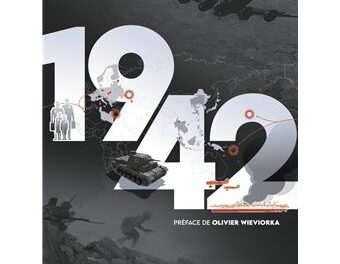


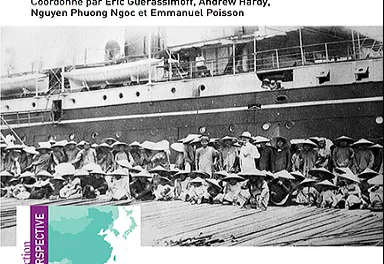









Trackbacks / Pingbacks