
Jacques Semelin est professeur à Sciences-Po (Paris) et directeur de recherche au CNRS. C’est un universitaire spécialiste de la résistance civile (notion qu’il a contribué à définir http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3648 ), de la violence de masse et du génocide. Sa thèse publiée en 1989, « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe (1939-1943) » est un ouvrage de référence qui vient d’être réédité, ainsi que Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Seuil, 2005.
Par la méthode utilisée, par la réflexion méthodologique et historiographique menée, par le tableau nouveau de la société française proposé (« une société plurielle et changeante, où la délation coexiste avec l’entraide, où l’antisémitisme n’empêche pas la solidarité des petits gestes »), par la quantité des témoignages cités qui composent une fresque vivante, par la simplicité et la clarté d’une expression qui laisse affleurer émotion et sensibilité, par les appels lancés aux enseignants et aux rédacteurs des programmes et de leurs compléments à tenir compte des résultats de ce travail dans l’image qui est donnée aux jeunes générations de la France sous l’Occupation, ce livre fera date.
« Une méthodologie souple, mais non dénuée de rigueur » : l’utilisation des témoignages au service d’une fresque de la persécution
Un corpus de témoignages. Les sources de cette étude sont principalement constituées par un important corpus de témoignages d’individus juifs ayant échappé à la déportation. Six journaux intimes écrits entre 1940 et 1944 ont été privilégiés comme source historique principale. L’auteur a d’autre part constitué un corpus de référence de témoignages écrits ou oraux, produits après-guerre entre, 1953 et 2012. Sur les quelque 200 témoignages consultés, il en a retenu 17, les plus précis, les plus chronologiquement cohérents et les plus complets, émanant de dix juifs français et de sept juifs étrangers, parmi eux Annie Kriegel, née Becker, et son frère, Jean-Jacques Becker, Saul Friedländer, Stanley Hoffman et Léon Poliakov. Parallèlement il a conduit une série de 30 entretiens, en particulier avec des Français juifs non déportés, qui n’avaient en général jamais fait le récit de leur vie durant cette période à un historien. À ce corpus de base ont été ajouté une soixantaine de témoignages complémentaires, pour illustrer des points particuliers de l’étude. « À chaque fois qu’un nouveau témoignage est introduit dans un chapitre, il fait l’objet d’un encadré. Cette présentation formelle offre l’avantage de donner à ce nouveau texte le statut de souvenir, différent de l’analyse historique proprement dite. La succession de ces encadrés permet aussi de refléter la multiplicité des trajectoires individuelles. Par là même, l’ouvrage tend à brosser une fresque de la persécution, à travers une grande variété des itinéraires de vie et de survie. »
L’apport des sources orales à l’analyse historique. Les trajectoires de ces témoins sont insérées dans leur contexte historique et politique. L’auteur s’appuie sur différents types d’archives, françaises et allemandes. Il utilise également les études historiques, pour la plupart récentes et précises, qui concernent son sujet, et qui prouvent que l’expression de « point quasi aveugle de l’historiographie de la Shoah » est un peu exagéré. L’auteur est conscient que la place majeure des témoignages dans les sources pourrait être interprétée comme un point faible de sa méthode, dans la mesure où la critique du témoignage est particulièrement vive, en ce qui concerne l’histoire de la résistance par exemple. Aussi s’efforce-t-il de réfléchir constamment à sa démarche et à sa méthode, de répondre par avance aux critiques qu’elles pourraient susciter, d’insister sur le fait que les témoignages doivent être recoupés et vérifiés, restant confiant de faire avec rigueur une oeuvre quelque peu pionnière. « Certes, on s’engage alors sur les chemins incertains de la mémoire, plus exactement de leurs mémoires. Prendre en compte la parole désintéressée semble pourtant une étape essentielle et, pour tout dire, indispensable à cette recherche. Le chercheur doit certes garder à l’esprit que la mémoire est lacunaire, voire fausse, et qu’elle se modifie avec le temps et la demande sociale. Cette prise en compte des sources orales représente pourtant un apport certain à l’analyse historique, à condition de les recouper avec des sources écrites. »
L’ouvrage est composé de 58 chapitres pour la plupart assez courts, regroupés en cinq parties et une conclusion d’une cinquantaine de pages. Les témoignages y prennent une part importante et en rendent la lecture extrêmement vivante. Les notes de bas de page sont toujours très sobres et précises. Le texte est complété par deux index, indispensables outils, une bibliographie et une table des cartes. C’est un ouvrage historique sérieux et rigoureux, c’est aussi un ouvrage vivant et concret, d’une lecture aisée et agréable, destiné à la fois aux spécialistes et à un large public.
La dispersion spontanée des juifs français et étrangers dans la France rurale
Les 10 chapitres de la première partie développent une première explication du taux élevé de survie des populations juives en France : leur dispersion géographique spontanée sur l’ensemble du territoire. Leurs déplacements successifs ont été facilités par l’importance du réseau ferroviaire qui atteignait des localités reculées et se prolongeait par des liaisons régulières en autocar vers les bourgs et les villages. Cette étude de la dispersion révèle « une extraordinaire diversité des situations ».
L’attraction de la zone « libre ». C’est la zone dite « libre », parce que non occupée par les Allemands jusqu’en novembre 1942, qui attire le plus, pour trois raisons : elle symbolise ce qui reste de la souveraineté française après la victoire allemande, on croit que l’on y vit mieux et surtout que l’on y mange mieux, enfin, la montée de la persécution antisémite y est moins précoce et moins brutale. Des pôles de regroupement se constituent surtout dans le Sud-Est et le Sud-Ouest. « Le coin de France où ils sont arrivés, ils l’ont rarement choisi d’avance : ils ont cheminé au gré des événements, des circonstances et des contacts espérés dans telle ou telle région. » Les départs vers la zone « libre » se sont accélérés à partir des grandes rafles de 1942 et du port obligatoire de l’étoile jaune en zone occupée.
L’attraction de la zone d’occupation italienne. Quand les Italiens occupèrent huit départements du Sud-Est, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, la rumeur se répandit vite que la zone italienne constituait un refuge pour les juifs. Les Italiens prirent effectivement diverses mesures de protection que les historiens interprètent aujourd’hui, non comme l’expression d’une politique humanitaire, mais comme une volonté politique du gouvernement italien de démontrer sa souveraineté de décision, y compris vis-à-vis de son allié allemand.
Gagner la Suisse et l’Espagne. Un certain nombre de juifs ont cherché à quitter la France et l’Europe, mais il fallait en avoir les moyens, et deux villes ont alors servi de plaque tournante, Lisbonne et Marseille. D’autres ont cherché à atteindre la Suisse ou l’Espagne. Malgré la sévérité initiale de leur politique de refoulement des étrangers, les autorités helvétiques se décidèrent fin août 1942 à faire preuve d’un certain assouplissement. La Suisse ne cessa pas sa politique de refoulement, mais le taux des refus devint plus faible que le taux d’accueil. Des études récentes contredisent donc l’image d’une Suisse totalement xénophobe. Anglais et Américains exercèrent une pression sur Madrid pour laisser le passage ouvert aux combattants qui voulaient rejoindre les forces alliées, et cette politique bénéficia dans les faits aux réfugiés juifs qui, en général, ne furent pas refoulés
Les plus nombreux sont restés chez eux. D’autres ont fait le choix de rester, souvent au nom de leur attachement à la France. Certains sont restés dans leur lieu d’habitation ou à proximité. Les personnes et familles qui résidaient déjà avant-guerre dans ce qui allait devenir la zone « libre » sont parmi celles qui ont le moins bougé. Leurs réseaux amicaux ou professionnels d’avant-guerre constituèrent leurs meilleures ressources pour faire face à la discrimination. La population numériquement la plus importante restée chez elle ou près de chez elles est celle de Paris et de sa banlieue, qui concentrait le plus grand nombre de Français israélites et d’immigrés juifs. On peut s’en étonner, mais des données incontestables attestent que, en dépit des délations et des rafles, quelques dizaines de milliers de juifs vivaient toujours à Paris à l’été 1944, soit parce qu’ils n’avaient pas pu faire autrement, soit parce qu’ils se croyaient suffisamment protégés par leur nationalité française. Parmi ceux qui restent à Paris, la catégorie la plus importante est celle des pauvres. D’autres encore firent le choix de revenir à Paris dans les derniers mois de l’occupation, tout en restant dans l’illégalité, dans la mesure où ils avaient besoin d’un permis spécial pour changer de département.
Face à la persécution : se débrouiller pour survivre
Les 11 chapitres de cette seconde partie ont pour objectif de « voir comment les uns et les autres se sont débrouillés pour éviter au jour le jour une issue tragique » et de « mettre au jour une autre mémoire de la période, pas seulement celle de la stigmatisation et de la déportation des juifs, mais aussi celle de leur survie au quotidien ». L’auteur veut donner la parole à « ceux qui n’ont pas été déportés mais qui auraient pu l’être » et qu’on ne sait d’ailleurs pas comment nommer, le vaste ensemble des juifs non déportés. « Il s’agit de mieux faire apparaître leurs conditions de vie et de survie en France, ainsi que leur mode individuel d’adaptation et de résistance à la persécution ».
Obéir à la loi, même celle de Vichy. Ce sont les juifs étrangers qui ont été le plus durement frappés par les politiques antisémites de l’occupant et de Vichy : 87 à 88 % des juifs français ont échappé à la déportation, contre seulement 56 à 60 % de juifs étrangers. Quand les Allemands imposèrent, par une ordonnance du 27 septembre 1940, aux juifs de France de se déclarer comme « juif », une très large majorité obéit à la loi : il s’agit du comportement humain le plus largement répandu, mais de surcroît, les Français israélites conservaient leur confiance en la France et étaient pour la plupart maréchalistes. Plusieurs rabbins protestèrent, tout en invitant les juifs à respecter la loi. Habitués à déférer à des opérations de contrôle, les étrangers allèrent massivement se déclarer pour être en règle avec la nouvelle loi. Quelques-uns cherchèrent à contourner la loi, par une conversion par exemple. Les institutions judiciaires participèrent à l’application des lois de Vichy, avec une grande docilité, et l’on vit naître une discipline nouvelle, le « droit antisémite ».
L’illégalité nécessaire à la survie. L’exclusion aboutit rapidement à la paupérisation et l’historien cherche à analyser les « méthodes de survie ». Pour ceux qui possèdent quelques ressources financières, le premier moyen de faire face à la situation est de garder leur argent avec eux et de l’emporter si nécessaire, de retirer leur argent des banques afin de ne pas tomber sous la sanction du blocage des comptes, de contourner les lois d’aryanisation des biens juifs. Beaucoup continuent à exercer leur profession, surtout quand elle est utile à l’occupant (par exemple la profession de fourreur qui approvisionne l’armée allemande) ou quand elle s’intègre dans une organisation juive légale car reconnue par Vichy (par exemple l’UGIF, les Eclaireurs israélites, l’Oeuvre de secours aux enfants). Quelques exemples attestent de reconversions professionnelles, vers les difficiles métiers de la terre par exemple. Là encore l’étude met en évidence « des trajectoires infiniment variées » et, « de cette diversité de situation se dégage une tendance générale : les individus sont de plus en plus nombreux à quitter le monde de la légalité pour celui de la transgression des normes et des règlements. Ils n’ont pas vraiment le choix : pour gagner leur vie, ils doivent accepter de travailler au noir ou de prendre un emploi légal, mais sous un faux nom (…) On assiste à l’imbrication de plus en plus fréquente entre comportement légaux et transgressifs, ce qui devient le trait général d’une époque. »
Aidés par Vichy ! Cette étude met en évidence un étonnant paradoxe : la politique sociale de Vichy, dont des travaux récents et novateurs ont montré l’importance, a permis à nombre de juifs de recevoir des allocations de l’État. Les ressources du Secours national ont par exemple pu contribuer à la survie des juifs. « Ainsi Vichy met ses opposants en prison ou en camps d’internement, utilise son administration et sa police comme supplétifs de la Gestapo dans la déportation des juifs, et verse en même temps à leur famille des allocations de secours, il est vrai très faibles ».
Face aux arrestations : se fondre dans la population
À partir de l’été 1942, les rafles contribuent à modifier l’état d’esprit des persécutés qui recourent à divers procédés pour ne pas se faire prendre. Ils cherchent à fuir, ou à se « dissimuler socialement », c’est-à-dire se fondre dans la population. Ces deux réactions supposent un important effort d’adaptation. « Pour s’en sortir, les personnes doivent en quelque sorte, accepter d’entrer dans un nouveau monde (…) À travers les témoignages recueillis, on est souvent frappé par la volonté des individus et des familles de continuer à vivre malgré tout, malgré la peur. » Les 17 chapitres de cette partie démontrent que « tout se passe comme si les individus avaient alors mis en oeuvre une forme de résistance de vie, de résistance pour la vie, afin de préserver leur dignité et leur identité, faisant fi du projet mortifère qui les assaille ».
La vie comme résistance. Les titres de quelques-uns des chapitres de cette partie permettent d’ appréhender l’originalité et la finesse de l’analyse : « L’étoile jaune, ou comment défier le port d’un stigmate », « S’échapper », « Mettre ses enfants à l’abri », « Se préparer à fuir, se faire prendre », « Se rendre invisible », « Basculer dans l’illégalité », « Se faire catholique », « Aller à l’école et poursuivre ses études », « Aimer et faire des enfants ». Dans un chapitre intitulé « La résistance de l’intime » l’historien découvre « la capacité des individus, en dépit de la persécution dont ils sont les victimes, de continuer à vivre et à aimer malgré le malheur ». Dans un autre intitulé « Prier et pratiquer le culte » on apprend qu’à Paris, pendant l’Occupation, cinq rabbins continuent à officier, que les commerces rituels, boucheries ou charcuteries juives, les huit librairies religieuses, les deux établissements de bains rituels, ne furent pas fermés et que dans certaines villes et régions de province, l’activité religieuse était parfois importante. Beaucoup de synagogues ne sont pas fermées, alors qu’elles constituent des « viviers » disponibles pour y capturer des juifs. On peut ne pas partager l’opinion de Jacques Semelin qui considère que « cette volonté de maintenir coûte que coûte une vie religieuse juive apparaît en définitive comme une forme de résistance religieuse en dépit de la persécution » et l’on peut préférer y voire, comme l’historienne Renée Poznansky, « une forme de myopie politique ».
La solidarité des petits gestes
Les témoignages des juifs non déportés s’accordent tous sur le fait que la population française a fait preuve en général à leur égard d’une bienveillance discrète et salvatrice, constatation qui est confirmée par un certain nombre de documents d’archives, des rapports du Commissariat général aux questions juives par exemple. Jacques Semelin dénonce comme « un pur cliché », « cette représentation d’une masse de Français antisémites, au sein de laquelle opère de manière héroïque une élite courageuse de « gentils » dévoués au sauvetage des juifs ». Il démontre que la politique antisémite de Vichy et de l’occupant « n’a pas irradié le corps social dans son ensemble ».
La France n’était pas antisémite. Les populations rurales qui voient arriver des gens de la ville ne les perçoivent pas comme juifs, mais d’abord comme des réfugiés et des victimes de guerre. L’auteur critique les thèses défendues dans l’ouvrage de Michael Marrus et Robert Paxton, Vichy et les juifs (Calmann-Lévy, 1981), selon lesquelles la population française aurait ét profondément antisémite. Il estime que les rapports de préfets sont des sources biaisées, et s’appuie sur des études plus récentes, qui contredisent la thèse d’une opinion hostile aux juifs ou même indifférente avant les rafles de l’été 1940, en s’appuyant sur d’autres sources, les rapports internes au Commissariat général aux questions juives. Le silence de l’opinion aux premiers temps de la persécution des juifs en France n’est alors plus interprété comme une approbation de cette politique, mais comme une indifférence à une question jugée mineure par rapport à d’autres inquiétudes : sur les prisonniers, sur le ravitaillement, sur les autres mesures de répression etc. Jacques Semelin rejoint Pierre Laborie pour rejeter les jugements de l’historien Robert Paxton quant au comportement collectif des Français et pour souligner l’hostilité croissante de la population aux mesures infamantes et brutales dont les juifs sont les victimes. Il insiste cependant à plusieurs reprises sur sa volonté de ne pas présenter une vision idéaliste et rose de l’occupation et rappelle que des milliers de Français sont devenus des délateurs. Néanmoins l’importance de la délation antisémite ne doit pas être exagérée : 6 % des lettres anonymes visent les juifs selon des études récentes (http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article4064).
« Il s’est produit un phénomène social étonnant qui n’a certainement pas été prévu par les autorités : sans s’être donné le mot, des milliers de Français ont alors, ici ou là, aidé et protégé des juifs contraints de se cacher et de fuir. Il est impossible de restituer l’infinie diversité de ces situations. Pour la plupart, elles tiennent à des initiatives individuelles dans des circonstances souvent tragiques. » C’est dans ce cadre que Jacques Semelin aborde la question des Justes, considérant que « le titre de Juste procède avant tout d’un jugement moral, porté sur la conduite des individus non juifs, ce qui rend difficilement utilisable en histoire cette distinction mémorielle. » Il estime que « la définition du Juste parmi les nations repose sur une représentation étroite de celui qui sauve », et que « cette approche élitiste du Juste qui sous-entend un acteur au courage exceptionnel, puisqu’il lutte dans un milieu hostile, ne résiste pas à l’analyse historique ». Pour tout ce qui concerne l’histoire des Justes en France on se reportera à l’ouvrage remarquable de Patrick Cabanel auquel Jacques Semelin fait plusieurs fois référence ( http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article4113).
Un beau chapitre de cette partie dresse les portraits de quatre personnages archétypiques qui symbolisent les figures incontournables de l’aide aux persécutés : « l’Ange gardien », une personne qui « pour une minute décisive, pour quelques heures, s’interpose en quelque sorte entre le chasseur et le chassé », « l’hôtesse », qui recueille, loge, nourrit le persécuté en fuite (Jacques Semelin n’hésite pas à citer longuement la Chanson pour l’Auvergnat de Georges Brassens), « le faussaire » et « le passeur » de lignes et de frontières.
La France a connu un important mouvement de réactivité sociale. Comment qualifier cette multiplicité des gestes d’aide aux persécutés, gestes individuels qui prennent une dimension collective ? Pierre Laborie utilise le concept de « société de non consentement », François Marcot celui d’ « adaptation contrainte », Jacques Semelin développe celui de « réactivité sociale ». « Réactivité parce que des individus font spontanément quelque chose sans se concerter (…) Sociale parce que le développement simultané de telle conduite ne peut être interprété à partir de la seule histoire des personnes ». Il en arrive ainsi à une sorte de profession de foi : « Face à la persécution antisémite, nous soutenons donc que la France a connu entre 1942 et 1944 un important mouvement de réactivité sociale, au sens où nombre d’individus, sans nécessairement se connaître entre eux, ont porté assistance à d’autres que, le plus souvent, ils ne connaissaient pas davantage, mais dont ils percevaient la situation de détresse -du moins de grande vulnérabilité. C’est ce phénomène qui est en soi remarquable et constitue la marque de cette période historique. » Jacques Semelin estime que cette notion de « réactivité sociale » est préférable à celle de « résistance civile », pour laquelle il est essentiel de conserver la dimension d’un acte volontaire et organisé. C’est donc une toute nouvelle vision de la société française qui se dégage et Jacques Semelin souhaite explicitement « que les prochains manuels scolaires en fassent état ».
De l’entraide spontanée à la résistance civile
La notion de « résistance civile » ne désigne pas seulement des actes d’aide et de protection mis en oeuvre spontanément par des personnes anonymes mais « des actions concertées et organisées pour permettre aux victimes potentielles d’échapper à l’arrestation et à la déportation ». Les 11 chapitres de cette partie étudient l’action de diverses organisations, principalement juives. Il s’agit selon l’historien d’une des deux « dynamiques de résistance durant l’occupation », celle qui vise la survie des populations persécutées, l’autre, plus connue et davantage étudiée, visant la libération du pays. Il récuse l’appellation de « résistance humanitaire » pour qualifier le sauvetage organisé des juifs, « car il y a bien davantage un enjeu politique qui touche au fondement du lien social ».
Les faits présentés dans cette partie sont mieux connus : « réveil de la conscience chrétienne » (engagement des protestants, fondation des Cahiers du Témoignage chrétien, protestations publiques des évêques contre les rafles), action des réseaux clandestins juifs et non juifs de sauvetage, présentation des lieux de refuge : le Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, les Cévennes. Pour ne pas alourdir ce compte rendu, on se reportera à celui de l’ouvrage de Patrick Cabanel, à celui consacré à Dieulefit (http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2993), ainsi qu’à celui des Actes du colloque sur l’histoire régionale de la Shoah en France (http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3704). Tenant compte des travaux récents de Sylvie Bernay sur l’Église de France face à la persécution des juifs 1940-1944 (CNRS Éditions, 2012), Jacques Semelin reprend l’expression de « diocèse refuge » pour caractériser « des cas où le sauvetage ne repose plus sur l’aide spontanée des habitants d’un village, mais sur la décision d’une autorité religieuse couvrant un vaste territoire ». Dans ces diocèses (Nice, Toulouse, Montauban, Clermont-Ferrand, Albi, Lyon et Annecy), l’évêque est prêt à couvrir et à organiser les activités clandestines de sauvetage. Le « planquage » clandestin est confié à des relais, qui sont des curés de paroisse ou des institutions religieuses, sous l’obédience de l’évêque.
Conclusion. Singularité de la France de Vichy dans l’Europe nazie
C’est le titre d’une longue conclusion structurée en six chapitres. La majorité de la population juive persécutée est restée sur le territoire français et n’a pas été déportée. L’étude de Jacques Semelin a porté sur la survie des juifs au quotidien et sur la manière dont la population non juive les a aidés, aspect largement absent des publications antérieures. Ces formes d’entraide ne proviennent pas seulement de ce qu’on appelle aujourd’hui les Justes, « ce sont des gestes diffus, fugaces, bienveillants, venus d’inconnus dont les historiens ne parviendront jamais à retrouver les noms. » Comment expliquer ces multiples petits gestes qui définissent une « réactivité sociale » ?
Jacques Semelin caractérise quelques facteurs culturels qui ont pu freiner la persécution en France : le christianisme (« nul doute que les petits gestes d’entraide provenant des catholiques s’enracinent dans cet esprit de la charité chrétienne », vertu théologale enseignée au catéchisme dans toutes les paroisses de France pour inciter les fidèles à désirer et à faire le bien de leur prochain), l’héritage républicain (« les instituteurs laïcs, répartis dans des milliers de communes de France, jouent un rôle fondamental dans l’accueil des enfants juifs français et étrangers. Les internats des lycées ont aussi servi de lieu de refuge pour les élèves juifs (…) Les historiens ont rarement souligné l’importance de l’acceptation des enfants étrangers juifs dans les écoles laïques ». Sauf en Algérie, Vichy n’a pas osé rejeter les élèves juifs de l’éducation nationale), l’esprit patriotique (« des Français ont pu vouloir aider les juifs, non parce qu’ils étaient philosémites, mais parce qu’ils voulaient faire quelque chose contre les Allemands »), l’intérêt enfin (« l’arrivée de réfugiés, juifs ou non, dans telle ou telle région, est une source possible de tensions mais aussi de profit pour certains »).
Il identifie aussi quelques facteurs structurels de la survie des juifs en France : l’existence d’une zone « libre » et les différents statuts des territoires (la zone « libre » a été plus propice à la survie des juifs, hormis pour ceux qui sont enfermés dans les camps d’internement), le développement de la politique sociale (« on est tellement habitué à percevoir Vichy à l’aune de son antisémitisme qu’on oublie son action en matière de protection sociale de la population » dont beaucoup de juifs pauvre ont pu bénéficier), le maintien d’un État français (bien que faible et collaborateur, l’État français constitue un pouvoir intermédiaire entre les Allemands et la population. Les dirigeants français se sont d’abord faits les relais de la volonté de l’occupant et ont facilité les déportations puis, de la fin de l’été 1942 à 1944, prenant conscience de l’hostilité de la population aux déportations, ils ont relayé de moins en moins les exigences allemandes).
Pour comprendre cette singularité française, il faut encore tenir compte de l’évolution des rapports entre les Allemands et Vichy. L’objectif des dirigeants de Vichy n’a jamais été l’extermination des juifs ; la logique d’exclusion de Vichy n’était pas la logique d’extermination des nazis. Les autorités d’occupation entendaient s’appuyer sur Vichy pour faciliter les déportations. Quand Vichy devint plus réticent, les Allemands furent de plus en plus contraints à opérer les arrestations eux mêmes mais ils durent accepter de réduire leurs exigences quant à la « question juive » pour maintenir les intérêts stratégiques et économiques du Reich en France : la priorité de Berlin est que Vichy assure le maintien de l’ordre, le recrutement des travailleurs français en Allemagne et l’exploitation économique de la France. Si Vichy se rétracta à la fin de l’été 1942, il faut en chercher l’explication dans la mobilisation conjuguée de la société civile et de l’Église. « Dans cette période critique ou « la solution finale » est à l’oeuvre, la société française a donc agi comme un garde-fou, retenant les dirigeants de Vichy de s’enfoncer davantage dans l’entreprise criminelle et délirante des nazis. » Il faut enfin prendre en contre le fait que les fonctionnaires de Vichy, et une partie de ses dirigeants, considérant la défaite de plus en plus probable de l’Allemagne, ont évolué dans un sens de plus en plus favorable aux persécutés : ainsi les autorités connaissaient-elles les « planques » d’un grand nombre de juifs qui n’ont pas été inquiétés.
À la fin d’une étude dont il dit qu’elle a constitué pour lui « un double défi émotionnel et intellectuel » et au cours de laquelle il affirme avoir eu « comme obsession permanente d’allier, dans le même souffle, le quotidien de la persécution et celui de l’entraide », Jacques Semelin considère que les résultats de son travail, sans du tout réhabiliter Vichy, (« la tache rouge de sa participation à la déportation des juifs reste indélébile »), plaident pour une présentation moins « caricaturale » et « manichéenne » de ce régime, et sont « de nature à modifier les représentations que les Français se font aujourd’hui de la persécution des juifs dans leur pays ».




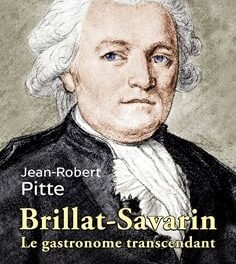









il est necessaire de se souvenir que par example en Pologne occupee par Nazi a ete instauree la peine de mort pour le sauvetage des Juifs en Pologne occupée. « Il est nécessaire de rappeler que, conformément à l’article 3 du décret du 15 octobre 1941 sur la limitation de la résidence en Gouvernement général (page 595 du registre GG) Les Juifs qui quittent le quartier juif sans permission encourent la peine de mort. Selon ce décret, ceux qui aident sciemment ces Juifs en leur fournissant un abri, en leur fournissant de la nourriture ou en leur vendant des denrées sont également passibles de la peine de mort.
Ceci est un avertissement catégorique à la population non juive contre:
1) Fournir un abri aux juifs,
2) leur fournir de la nourriture,
3) leur vendre des produits alimentaires. »
Aider les juifs comprenait: «de quelque manière que ce soit: en les accueillant pour la nuit, en les transportant dans un véhicule de quelque sorte que ce soit» ou «en nourrissant des juifs en fuite ou en leur vendant des denrées alimentaires». La loi a été rendue publique par des affiches distribuées dans toutes les villes et villages, pour semer la peur.
L’imposition de la peine de mort aux Polonais aidant les Juifs était unique à la Pologne parmi tous les pays occupés par l’Allemagne, et résultait du caractère évident et spontané d’une telle aide. Les escadrons de la mort nazis ont procédé à des exécutions massives de villages entiers qui ont été découverts pour aider les Juifs au niveau communautaire
AU MEME TEMPS, Le gouvernement polonais et ses représentants clandestins dans leur pays ont émis des déclarations selon lesquelles les personnes agissant contre les Juifs (maîtres chanteurs et autres) seraient punies de mort et en faite la solidarite et l aide aux juifs etaient encourges.