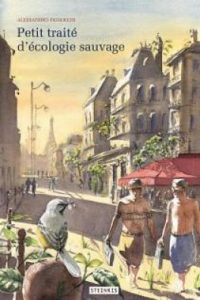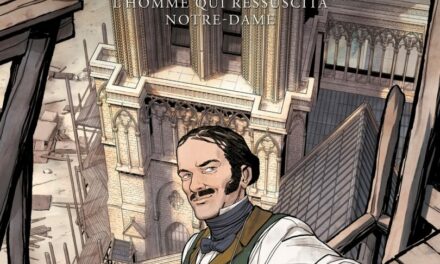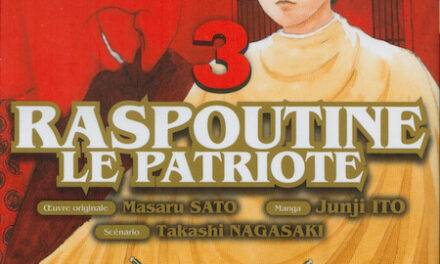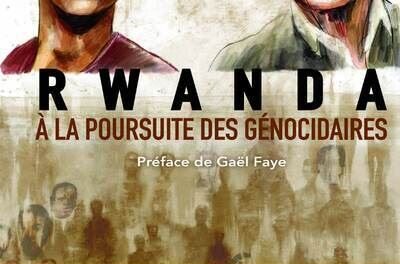On a affaire, avec les bandes dessinées, à des ouvrages parfois très surprenants. Les deux volumes du Petit Traité d’écologie sauvage fait partie de ceux-là. Avec un humour teinté de cynisme, l’auteur nous amène à réfléchir, ce qui nous incite à le relire encore et encore. Le propos d’Alessandro Pignocchi, très riche, est soutenu par des dessins aux tons pastels, très doux.
Le parcours de l’auteur n’est déjà pas si banal en soi. Chercheur en sciences cognitives et en philosophie de l’art, il s’est progressivement mis à dessiner. Il tient d’ailleurs un blog, Puntish, où l’on trouvera un certain nombre de planches de ses albums. La dernière livraison montre d’ailleurs un anthropologue jivaro étudiant les faits et gestes des indigènes peuplant Bois-le-Roi pour comprendre sur quoi repose la civilisation seine-et-marnaise. C’est qu’on a là l’une des dernières zones où survit la civilisation occidentale traditionnelle, et que l’un des enjeux est sa constitution en réserve. Il met en scène également son anthropologue jivaro, qui observe un pêcheur à la ligne, ce qui l’amène à penser que son action est une recréation d’une « nature sauvage », façon de gommer temporairement la distinction entre nature et culture, quitte à ce que ses prises aient été préalablement élevées et lâchées dans les rivières.
Le ton est donné : les deux volumes prennent résolument le contre-pied de la vision européano-centrée, et amène à reconsidérer notre façon de vivre, et notamment les relations de pouvoir, les échanges, etc., au travers d’yeux extérieurs. Alessandro Pignocchi amène aussi à relativiser la notion de valeurs qui seraient universelles, comme s’il n’y avait qu’une seule façon de voir les choses, sans aucune autre alternative, jugée alors avec condescendence.
Il s’agit, pour l’anthropologue jivaro, de comprendre les fondements mythologiques de ce groupe de Bois-le-Roi, et voici sa théorie : « il y a bien longtemps, les hommes se sont mis à décorer ce qui les entourait de jolis chiffresLa valeur monétaire.. Un jour, Travail, Monnaie et Terre voulurent eux aussi des chiffres. Les hommes refusèrent, car Travail, Monnaie et Terre ne pouvaient s’échanger. Alors, Travail, Monnaie et Terre se fâchèrent, mangèrent beaucoup d’hommes et mirent à parcourir le monde, selon des itinéraires complexes qui rappellent les pistes chantées des aborigènes d’Australie. Et, comme chez les aborigènes, sur les traces de ces créatures mythiques du temps des rêves, de nouveaux êtres totémiques sortirent du sol et parcoururent le monde à leur suite, réclamant à chacune de leur halte que soit embellie, lors des échanges rituelsLes transactions commerciales., leur valeur chiffrée, comme pour laver l’affront qui avait été fait aux premiers membres de leur famille totémique. C’est une ferveur mystique, d’une intensité à peine imaginable, qui pousse encore aujourd’hui les occidentaux à se montre fidèles à ce mythe fondateur. Sa trame organise chacun de leurs actes, confère sa profondeur à chaque facette de leur quotidien ». Le Jivaro tente, fort de son interprétation des choses, de s’immiscer dans les relations sociales, ce qui l’expose à certains déboires. Dans le premier volume, ce discours sur les Occidentaux était tenu par des mésanges, qui commettaient bon nombre de déprédations (vol du cuivre du système de refroidissement de centrales nucléaires, par exemple, pour en faire des sculptures). Au passage, l’auteur détourne l’histoire du colibri qui lutte contre un incendie en apportant des gouttes d’eau (comme si les profondes difficultés environnementales pouvaient se régler avec des initiatives individuelles, à base de gestes quotidiens) : des mésanges se sont associées à des pinsons et des roitelets, car ces oiseaux se sont rendus compte qu’ils pouvaient transporter un gros bidon d’essence et hâter la fin du monde dominé par les hommes.
Pour nous faire mieux percevoir l’étrangeté du monde occidental, Alessandro Pignocchi utilise d’autres procédés. Un cours d’histoire, dans un futur proche, revient ainsi sur le projet de construction d’un aéroport à Notre-Dame des Landes, par exemple, pour mieux souligner l’absurdité de la société d’alors. Il nous propose une projection du monde, débarrassé des idées fausses concernant les migrations — perçues alors comme une catastrophe, une menace — et le discours mensonger des détenteurs de l’autorité politique, d’une façon générale.
Alessandro Pignocchi s’appuie non seulement sur ses propres observations, mais il reprend les propos de l’ethnologue américaniste Philippe Descola, notamment en ce qui concerne la distinction entre nature et culture sur quoi est fondée la civilisation occidentale. Il invite à réfléchir sur les conséquences de cette séparation, notamment celle qui place fictivement l’homme au-dessus de toutes les espèces vivantes, et d’une nature (dont il s’exclue de fait) qui serait ainsi à son service et qu’il lui faut dominer et maîtriser. C’est pourquoi il met en avant l’exemple des ZAD, où cette vision est renversée. Alessandro Pignocchi met ainsi en scène Marcel Proust, grimé en Jivaro, partant retrouvait des bases saines, et des dirigeants politiques complètement désemparés (Macron se vautrant dans la mare aux sangliers ; Nicolas Hulot retrouvé drogué dans une roselière de Camargue…), au point d’imiter la démarche de Proust (Macron réfugié chez les Jivaros Achuar de Napurak) ou d’adopter la vision animiste des Jivaros. C’est que, comme chez les Jivaros, la population estime désormais que les élus sont à son service , et non l’inverse.
Bref, on a là de quoi reconsidérer les bases de la vision occidentale du monde, et notamment ce concept flou qu’est le « développement durable ». Il ne faut surtout pas s’arrêter au statut scientifique de l’auteur : il nous offre une vulgarisation rigoureuse, éclairée par des citations, que ses dessins et son humour mettent à la portée de tous. Est-il besoin d’ajouter qu’il faut absolument lire les deux volumes de ce Petit traité d’écologie sauvage ?