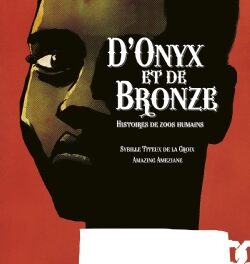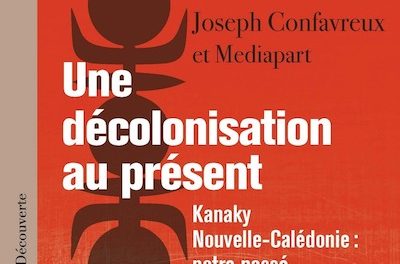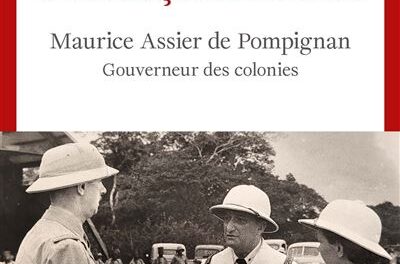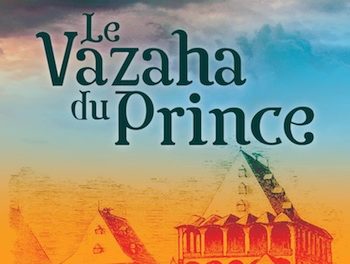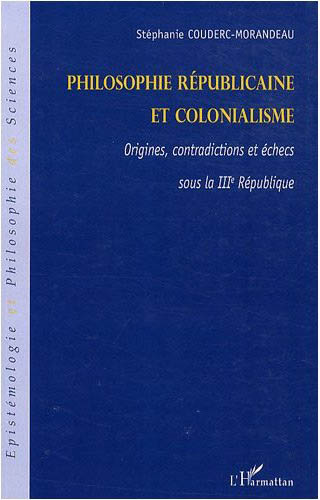
D’une manière générale, les passages historiques sont peu clairs. Nous apprenons par exemple qu’à l’époque où débute l’aventure républicaine impériale, « la République détenait un pouvoir relativement fragile face à la Monarchie européenne » (p. 111), formulation pour le moins étonnante.
Non moins surprenant est ce jugement que l’on trouve dans la note 1, p. 183, qui explique que la France est le seul pays où on a réfléchi sur la colonisation : « En Angleterre, le droit de coloniser et celui de l’esclavage ne se justifient pas. » Faut-il rappeler que le mouvement abolitionniste fut plus précoce et bien plus puissant au Royaume-Uni qu’en France, et qu’il avait entraîné des débats et des justifications très poussées ? La formule « y penser toujours, n’en parler jamais », prononcée par Gambetta en 1872, est par ailleurs attribuée à Jules Ferry (p. 106).Ces erreurs mentionnées, on se demande ce qu’apporte l’ouvrage au sujet. Nombre des réflexions figurent déjà sous une forme plus complète dans diverses œuvres, dont le grand livre de Raoul Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962 (1972) qui n’est cité, sauf erreur, qu’à partir de la p. 187, et dont on se demande si l’auteur a tenu compte.
Sur la plan philosophique, il n’est pas certain que la réflexion soit plus novatrice : l’échec de la colonisation et les horreurs qu’elle a suscitées sont bien connus, nous n’apprenons rien de nouveau sur l’exploitation de l’homme par l’homme ni sur les difficultés de la décolonisation.
Si l’on ajoute que la typographie n’est pas exempte de tous reproches et que la quatrième de couverture parle de la « politique coloniale en partie poursuivie par Jules Ferry au cours de la première (sic!) moitié du dix-neuvième siècle », on peut conclure que l’ouvrage, curieusement paru dans la collection « Épistémologie et philosophie des sciences », nous apparait peu indispensable au regard de la critique de l’historien.