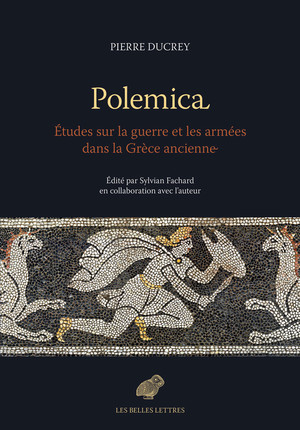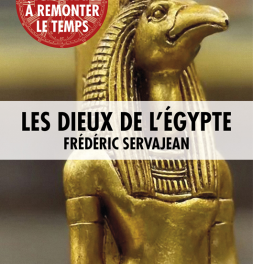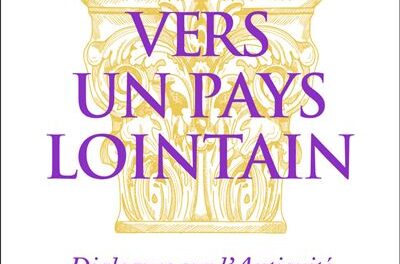Sylvian Fachard, chercheur suisse, spécialiste de la cité eubéenne d’Erétrie, a étroitement collaboré avec Pierre Ducrey, professeur honoraire d’histoire grecque de l’Université de Lausanne et éminent spécialiste de la guerre dans la Grèce antique, pour donner aux lecteurs, spécialistes ou non, une édition exemplaire d’études et de réflexions du maître sur la guerre en Grèce ancienne, publiées (sauf une, inédite) au cours des cinquante dernières années. Pour donner la mesure de l’étendue des compétences de l’auteur, l’ouvrage rassemble 22 études qui permettent de faire le point sur diverses questions, d’autant plus que les textes ont été entièrement revus et actualisés depuis leur date de parution initiale.
Il ne peut ici, bien sûr, être question d’aborder toutes les études proposées à la (re)lecture. A côté d’études spécialisées, qu’on évoquera plus bas, en figurent de plus synthétiques, qui fournissent un bon exposé, actualisé, de la recherche. Ainsi en est-il par exemple de la question des rapports entre armée et pouvoir (marqués notamment par une nette subordination du militaire au politique), de celle qui mêle guerre et religion (excellente synthèse qui aborde les principaux thèmes et notamment celui de grands sanctuaires contraints de conclure des traités d’asylie, signe qu’ils ne sont, contrairement à une idée reçue, pas épargnés par les violences de guerre) ou du rôle des femmes, longtemps sous-estimé, dans les guerres antiques (outre le fait, par exemple, qu’à plusieurs reprises on les surprend à monter sur les toits des maisons pour agresser les assaillants à coup de pierres et de tuiles, on apprend aussi qu’à l’époque hellénistique, on se sert de leurs cheveux en guise de détente des catapultes pour projeter au loin lourdes flèches et autres blocs de pierre).
Concernant les études plus spécialisées, nous avons été particulièrement intéressé par celles qui traitent de l’usage de la fronde dans les conflits de différentes époques de l’histoire de la Grèce ancienne. La découverte en Erétrie en 1988 d’une grappe de balles de fronde en plomb, fraîchement sortie du moule lors de deuxième guerre de Macédoine (au début du IIè s avant J.-C.), permet d’analyser l’usage de la fronde en Grèce ancienne. Les sources littéraires comme les trouvailles archéologiques attestent largement l’usage de frondes par les Grecs, mais beaucoup plus rarement les représentations iconographiques. C’est, semble-t-il, à partir de la guerre du Péloponnèse que des troupes de frondeurs sont engagées à grande échelle. Et, régulièrement, à partir du IVè siècle avant notre ère, des détachements de troupes légères (peltastes, archers, frondeurs) appuient la phalange hoplitique : « Chaque armée de type hellénistique […] est pourvue de contingents de frondeurs mercenaires, recrutés en principe dans une peuplade dont la fronde est la spécialité (Achéens, Baléares) » (p. 199).
Les tacticiens de l’Antiquité considèrent que la fronde est l’arme légère la plus dangereuse : sa portée est plus longue que celle d’un arc et son tir est plus difficile à esquiver. En outre, des essais d’archéologie expérimentale ont permis de montrer que des balles de plomb, pesant en moyenne de 30 à 40 g, pouvaient perforer une cuirasse jusqu’à une distance de 100 m. Cependant, ce qui fait la force de la fronde comme arme de guerre, c’est l’engagement de plusieurs centaines, voire de milliers de frondeurs lors d’une bataille : ils peuvent alors constituer « une source de perturbation fatale pour le bon ordre de la phalange » (p. 202). Lorsque les frondeurs combattent dans une bataille rangée, ils sont disposés soit devant la phalange pour ouvrir le combat en lançant une série de balles sur les ennemis dans le but de les désorganiser, soit sur les ailes de la phalange de façon à attaquer les flancs de la formation ennemie.
Mais les frondeurs sont particulièrement à l’aise dans le combat en terrain accidenté. Le volume comporte à cet égard une étude excellente sur la guerre en montagne, dans laquelle Pierre Ducrey signale en passant que si les « grandes batailles qui retiennent l’attention des auteurs se déroulent […] en plaine, […] les escarmouches, embuscades et razzias qui forment l’essentiel des interventions armées, se déroulent majoritairement en montagne » (p. 238). Sur ce terrain, la phalange hoplitique, lourdement armée, est peu mobile : depuis les hauteurs, les frondeurs, à l’équipement réduit, harcèlent donc sans risques les soldats qui progressent dans les défilés.
Les montagnes sont parsemées de fortins et de forteresses, rarement mentionnés dans les sources écrites. En revanche, on en sait davantage sur les fortifications urbaines : coûteuses à édifier, coûteuses à entretenir, elles se multiplient pourtant après le Vè siècle avant notre ère ; leur fonction est principalement dissuasive et peu nombreux sont les assauts réussis en comparaison de ceux qui échouent. Dans les cas où le siège est sur le point de réussir, il vaut mieux pour les populations assaillies qu’elles ne s’acharnent pas à défendre la ville mais qu’elles facilitent, au contraire, leur reddition : l’auteur a calculé en effet que « sur cent sièges de villes menés entre 700 et la mort d’Alexandre, 25 se terminent par le massacre des défenseurs et l’asservissement de la population, 34 par l’asservissement de la population sans massacre et 41 par la capitulation en vertu d’une convention » (p. 103).
Pierre Ducrey consacre également des passages intéressants au fossé qui sépare la réalité des pratiques militaires grecques (tel l’emploi non négligeable des frondeurs) et leur représentation iconographique (qui valorise au contraire très largement l’hoplite) : « Arme de jet esquivant le corps-à-corps, la fronde est perçue à toutes les époques comme une arme déloyale et vile, indigne du citoyen-soldat hoplite » (p. 223). Quant au frondeur, c’est souvent un auxiliaire étranger, un mercenaire. L’auteur aborde d’ailleurs à plusieurs reprises la question complexe du mercenariat : ces soldats professionnels, comme les Crétois, qui trouvent à s’employer auprès de cités qui manquent de combattants et dont on croise la route tout au long de l’histoire grecque, comment faut-il en réalité les qualifier ? Philippe Gauthier, spécialiste de Xénophon, indique par exemple que ‘le fait d’être étranger à la cité pour laquelle on combat et le fait de recevoir une solde ne suffisent pas à caractériser un mercenaire’ (cité p. 290). Par ailleurs, il n’est pas assuré que la cité qui les enrôle y trouve son compte sur le plan financier.
Ces quelques considérations n’entendent pas épuiser la richesse de l’ouvrage mais indiquent quelques-unes des orientations de recherches d’un auteur qui a l’art de la synthèse, qui respecte à la fois son lecteur (son écriture est limpide et, à aucun moment, même dans les études les plus pointues, il ne se montre obscur) et les historiens dont il ne partage pas les hypothèses.
En bref, nous avons là un fort bon ouvrage, très bien édité, qui fourmille d’exemples précis, puisés aux meilleures sources et très utiles pour nourrir un cours, et doté à la fois d’une riche bibliographie, qui n’omet aucune des études importantes, anciennes ou très récentes je pense par exemple à l’excellente synthèse de Pascal PAYEN, La guerre dans le monde grec (VIIIe-Ier siècles avant J.-C.), Paris, Armand Colin, Collection U, 2018, sur la guerre en Grèce ancienne, et de huit index (des noms propres, des lieux géographiques, cités, peuples, des textes anciens cités, des inscriptions citées, des papyrus cités, des termes grecs commentés, des termes latins commentés, thématique). C’est dire combien il s’agit d’un précieux guide.