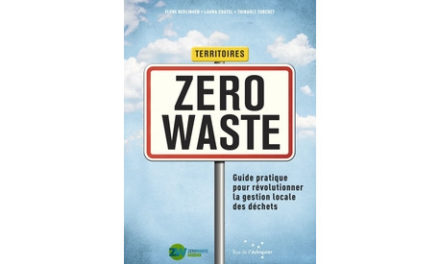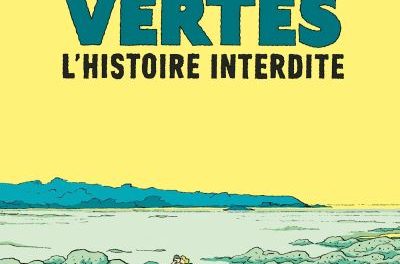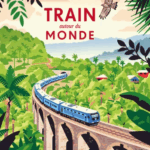Si des économistes, des banquiers, des fonds d’investissement donnent un prix à la nature c’est qu’ils en attendent des profits mais quand des
 défenseurs de la protection de l’environnement ont un point de vue comparable, cela peut surprendre. Le livre, comme le film documentaire des mêmes auteurs : NATURE, LE NOUVEL ELDORADO DE LA FINANCE, met en lumière ces ambiguïtés sans gommer la complexité du sujet. Décrivant le vaste panorama des intérêts en jeu il montre l’action des lobbies autour des « services » apportés par la nature. Sandrine FEYDEL, journaliste et co-réalisatrice du film, et Christophe BONNEUIL, historien au CNRS ont co-écrit ce livre. Ils nous conduisent en Ouganda, au Brésil, en Amazonie, aux États-Unis et en Malaisie … où des bio-banques « protègent » des écosystèmes en danger. Ils décrivent les conséquences pour les populations locales et l’environnement naturel. Ils montrent que ce sont les entreprises les plus destructrices de l’environnement qui investissent dans ces marchés associées aux institutions financières responsables de la crise des subprimes en 2008 préparant un « krach vert ».
défenseurs de la protection de l’environnement ont un point de vue comparable, cela peut surprendre. Le livre, comme le film documentaire des mêmes auteurs : NATURE, LE NOUVEL ELDORADO DE LA FINANCE, met en lumière ces ambiguïtés sans gommer la complexité du sujet. Décrivant le vaste panorama des intérêts en jeu il montre l’action des lobbies autour des « services » apportés par la nature. Sandrine FEYDEL, journaliste et co-réalisatrice du film, et Christophe BONNEUIL, historien au CNRS ont co-écrit ce livre. Ils nous conduisent en Ouganda, au Brésil, en Amazonie, aux États-Unis et en Malaisie … où des bio-banques « protègent » des écosystèmes en danger. Ils décrivent les conséquences pour les populations locales et l’environnement naturel. Ils montrent que ce sont les entreprises les plus destructrices de l’environnement qui investissent dans ces marchés associées aux institutions financières responsables de la crise des subprimes en 2008 préparant un « krach vert ».C’est bien l’émergence d’un nouveau marché, celui de la protection environnementale, que décrypte ce livre .
Les auteurs ont choisi pour la vulgarisation de partir de quelques exemples concrets et symptomatiques qui autorisent la démonstration comme dès le premier chapitre l’histoire de la mouche des sables de Californie ou comment la protection d’une espèce en voie de disparition donne lieu à une spéculation bancaire et boursière. Protéger la mouche ou développer le commerce et la construction autour de la ville de Colton ?
Ce premier exemple a permis aux USA la multiplication de « bio-banques » qui vendent en quelque sorte des droits à détruire une espèce en faisant de gros profits.
Un principe de compensation né dans les années 80 aux USA dans la mouvance du néolibéralisme pour contrecarrer l’influence grandissante des milieux environnementalistes depuis le début des années 70. Ce sont les années Reagan qui voient se développer les « marchés à polluer ».
Les chapitres 2 et 3 sont l’occasion d’un retour historique sur ces évolutions de 1972 Conférence de Stockholm à Rio et le rapport Brundland qui introduit le concept de développement durable jusqu’au protocole de Kyoto et au marché carbone. S’appuyant sur les rapports du PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement les auteurs tentent un bilan de la place des banques dans la financiarisation de la nature et des « services écosystémiques »
Franchissant l’océan le chapitre 4 nous entraîne dans les arcanes de la commission européenne et des lobbies. Sont décrits ici l’idée de « compensation » et ses modes de mise en œuvre notamment en Allemagne à partir de 1998 et l’envers du décor comme en Angleterre (page 74) à propos d’une forêt vieille de 1 000 ans, une occasion de montrer la notion de temps en cette matière, court, long terme, des pratiques discutables qui sont entrain d’entrer en France dans la loi de la biodiversité.
Des multinationales qui lavent plus vert, voilà un chapitre qui interroge la responsabilité environnementale, sanitaire et sociale des entreprises. Avec l’exemple emblématique de la multinationale minière Vale au Brésil (qui est aussi propriétaire d’une mine en Nouvelle-Calédonie) et de ses prétendus investissements dans les énergies vertes (plantations d’eucalyptus pour en faire du « bio carburant ce qui lui donne des permis à polluer. Suivent d’autres exemples de mensonges de l’économie verte : Inde, Panama, Honduras.
Le chapitre 6 permet de montrer par quels mécanismes les peuples des forêts intertropicales sont pris dans les marchés carbone ou comment une entreprise allemande de reforestation tire des revenus du marché carbone et affame la population ougandaise. Les auteurs explicitent les projets REDD Réduction des Émissions dues à la Dégradation et à la Déforestation.
Il semble de la terre soit « bleue comme une orange » à presser. L’analyse des positions des grandes entreprises regroupées (Shell, Monsanto, Véolia, Vale, Nestlé, Total, Coca-cola etc) au sein du WBCSD Word Business Council for Sustainable Dévelopment met en évidence le poids politique et les espoirs d’une marchandisation de la biodiversité.
Un lobby qui cherche avant tout à éviter les contraintes édictées par les États et cache derrière un changement d’image une volonté de ne rien changer de ses pratiques. Les auteurs analyse le discours libéral qui veut que l’auto-engagement et la régulation par le marché soient plus efficaces que les réglementations.
Pour faire face à toute menace « altermondialiste » ces entreprises influencent les instances onusiennes notamment par le financement de certains projets autour de Rio +20. Les auteurs reprennent l’argumentation de l’économiste Geneviève Azam. enseignante-chercheur à l’université Toulouse 2 – Le Mirail, économiste et militante, membre du conseil scientifique et du conseil d’administration d’Attac France et en particulier dans : La finitude des ressources peut-elle fonder un nouvel humanisme ? -[ http://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2013-1-page-59.htm-> http://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2013-1-page-59.htm].
Le chapitre 8 est consacré aux étranges rapprochements entre multinationales et grandes ONG de protection de la nature (UICN, WWWF) au sein du forum des entreprises pour le Développement Durable qui s’est tenu en 2012 une semaine avant le sommet de la terre à Rio. Les auteurs montrent les liens étroits entre dirigeants des entreprises ou grandes banques et leaders des associations : les mêmes à divers moment de leur carrière.
Ce constat éclaire la spéculation qui se développe sur la biodiversité comme dans l’exemple développé au chapitre suivant avec la « bourse verte » de Rio : quand un latifundiaire laisse en forêt plus de 80% de sa surface, ce qui dépasse les 80% peut être proposé à la vente. Un second exemple est décrit pour Bornéo où le fond d’investissement australien New Forest prétend protéger les orangs-outangs et vend dans une banque verte (associée à HSBC) des droits aux planteurs et sociétés de l’agro-alimentaire utilisatrices d’huile de palme.
Le développement de ces marchés semble une nouvelle bulle spéculative favorisée par une évolution d’une nouvelle représentation scientifique de la nature basée sur la production de services écologiques et l’idée de cycles évolutifs en rupture avec la notion d’équilibre née avec Linné.
Cette évolution remet en cause l’idée même de protection puisqu’ il y a évolution permanente qui débouche sur une vision utilitariste des écosystèmes. Les auteurs mettent en parallèle ce glissement avec le passage du capitalisme fordiste au capitalisme financiarisé. La biodiversité est désormais pensée comme un ensemble de flux, les écosystèmes comme des réseaux, mode de pensée évoqué dans le film de James Cameron sorti en 2009 : Avatar.
Avant d’aborder les outils de la finance verte c’est la culture commune aux écologues et aux économistes qui ouvre vers une nouvelle façon d’évaluer le capital naturel d’un territoire comme d’une entreprise dans le contexte actuel de changement climatique ce que Standard and Poor’s appelle notation verte.
C’est aussi l’occasion d’évoquer les placements éthiques proposés aux épargnants par des banques qui en même temps financent par exemple des mines de charbon. Le traitement spéculatif des obligations vertes ou des obligations catastrophe est développé aux pages 176-177.
Le dernier chapitre est une projection vers les prochaines étapes, un tour du monde des futurs marchés de la biodiversité : l’eau en Australie en particulier dans le bassin de Murray, le marché carbone pour des sols au Kenya et le « carbone bleu » des océans (mangrove au Sénégal avec Danone, au Costa Rica avec Volkswagen) et quelques autres pistes aux portes de la science-fiction
Un épilogue sous forme d’un court récit fictionnel en 2029 !