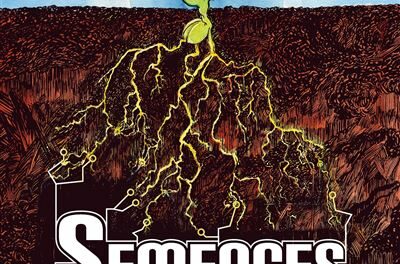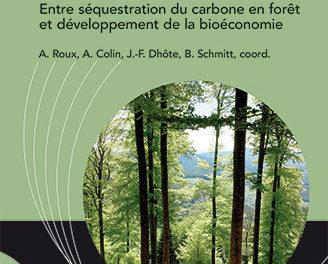Joëlle Zask est philosophe, maître de conférences à l’université de Provence, spécialiste de philosophie sociale et politique. Ses réflexions la conduisent à se plonger dans des domaines aussi différents que l’éducation, l’agriculture, l’économie, la démocratie participative et l’écologie. L’ouvrage qu’elle présente chez Premier Parallèle est le premier livre français à aborder la question des mégafeux tels que l’été 2019 a pu en connaître, avec une ampleur inédite. Le terme « megafire » est apparu en 2013 dans un rapport établi par Jerry Williams, responsable du Service américain des forêts (USFS). Serait « méga » le feu qui couvre une surface supérieure à 20 000 hectares, voire 40 000 hectares selon les auteurs. « Méga » évoque également « les cas où sont anéanties toutes les entraves qu’opposaient à la propagation du feu les cimes élevées des grands arbres, les lotissements, les zones dégagées ou humides, les abords des villes et les moyens de contrôle humain » (p.18).
Dans son introduction, Joëlle Zask annonce la couleur. L’ouvrage n’est pas une somme scientifique qui étudierait les causes et les conséquences des mégafeux. Il s’agit d’un « essai » qui envisage le phénomène des mégafeux comme un « accélérateur d’opinion » en faveur d’une action commune pour la sauvegarde des conditions d’existence humaine. Elle pose d’emblée un questionnement fondamental : « Comment affronter l’inquiétude légitime que les mégafeux suscitent, de manière à y trouver une nouvelle grammaire de nos interactions avec ce qui constitue notre milieu ? » (p.15). Pour l’auteure, les mégafeux sont un « fait socio-naturel total ». D’origine multifactorielle, le mégafeu impose de mobiliser les compétences de spécialistes aussi variés que les anthropologues, les forestiers, les pompiers, les chimistes, les riverains, les écologues et les géographes. Ainsi l’étude des mégafeux enseignent qu’il existe une « culture du feu » dont les hommes se sont peu à peu écartés. Cette culture est une culture de la participation individuelle au monde commun humain ou non humain sous la forme de l’entretien, de l’attention et du soin.
La démonstration de cette thèse se fait par maïeutique en 22 chapitres. On pourrait entrevoir trois temps ou trois axes dans cette argumentation. D’abord, l’auteure entend montrer que le feu de forêt est un phénomène « normal », qu’il a obligé la faune et la flore à s’adapter aux feux « naturels » (p.31). La culture sur brûlis fait partie de l’évolution de l’homme. Les tribus primitives possèdent une « culture du feu » qui permet d’aménager et de faire avec la nature. Le laps de temps qui s’écoule entre deux épisodes de feu est décisif pour la régénération de la forêt.
Les mégafeux bouleversent la donne. La célébration publique de la technologie de pointe en matière de lutte contre les incendies témoigne du paradigme de la maîtrise et de la domination de la nature, ce que les faits démentent massivement. Le mégafeu consume tout et s’éteint de lui-même, soit quand le vent tombe, soit quand le combustible est entièrement consumé. L’industrie forestière et les grands feux de forêts forment un « couple inséparable » : l’appauvrissement de la biodiversité que la première provoque prépare le terrain pour les seconds qui, en raison de leur intensité, perdent leur effet potentiellement bénéfique dans le maintien de la biodiversité (p.58). En détruisant une part des « poumons de la planète, les mégafeux aggravent le dérèglement climatique.
L’auteure reprend ensuite les thèses de l’historien de l’environnement, Stephen Pyne, selon lesquelles le feu et les pratiques qui en dérivent sont fondamentalement intégrés dans l’identité biologique de l’humanité. « Homo erectus est la seule espèce qui ait appris à apprivoiser, puis à domestiquer le feu » (p.81). L’anthropocène se révèle pyrocène dans la mesure où les feux anthropiques ont transformé la nature.
L’auteure défend alors le retour à une « culture du feu ». Ce qui cause les grands feux c’est souvent une absence d’entretien des forêts : interdiction des brûlages, augmentation de la biomasse, progression du maquis et des forêts de pins, disparition des mosaïques paysagères. À l’instar de Philippe Descola, l’auteure développe l’idée d’un « cleaning country » qui ferait passer de l’état de nature sauvage (wild and dirty) à celui de nature apaisée (clean and quiet). L’auteure termine ainsi sa démonstration : « Une politique cohérente de prévention des mégafeux préconiserait donc, bien au-delà des feux d’entretien qui ne sont pas toujours nécessaires, d’exploiter les forêts, d’y introduire des troupeaux, d’y pratiquer des coupures, d’ouvrir les milieux en multipliant les zones cultivées, de valoriser des productions directes, de diversifier les forêts au lieu de les livrer aux monocultures et de rétablir leur vocation multifonctionnelle » (p.114).
Quand la forêt brûle est un ouvrage passionnant. Joëlle Zask sait être particulièrement convaincante en nourrissant son propos d’une riche documentation factuelle et de lectures très diverses, provenant de recherches pluridisciplinaires. On trouve, dans la bibliographie qui parachève l’ouvrage, des références à des travaux d’anthropologues, de géographes, de sociologues, d’historiens, d’écologues.