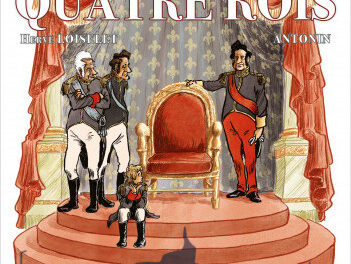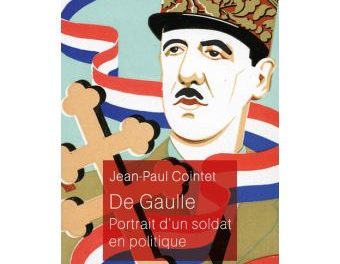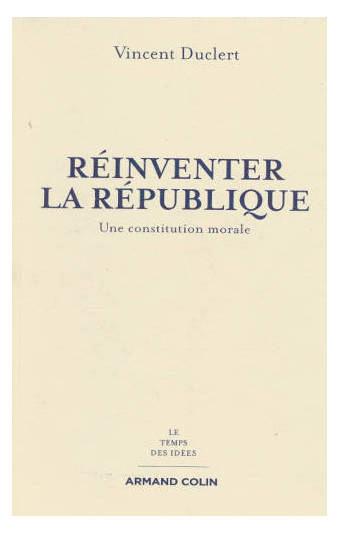
En ces périodes de crise sociale, de désenchantement du politique et de tentations extrêmes, qui se traduisent pour l’instant par un durcissement du discours, il est bon que l’on prenne le temps de réfléchir en mobilisant la réflexion croisée de l’historien, du philosophe, du sociologue. C’est la vocation de cet essai publié dans une collection qui porte bien son nom : « la vie des idées ».
Se donner le temps de la réflexion c’est aussi échapper un temps, même si c’est difficile, à cette dictature de l’instantanéité qui nous paraît aussi menaçante pour la République que les saillies de tel ou tel politique qui veut alimenter la parole publique sur elle ou sur lui. Cela commence par le tweet assassin et lapidaire, encore une fois au sens propre, dans la mesure où l’adversaire se voit « lapidé », par une appréciation catégorique en 140 caractères. Cela continue par les formules ciselées et développées par des « chargés de com. », le tout étant repris en boucle par les différents médias, réseaux sociaux inclus qui amplifient le phénomène en attendant, deux jours en général, qu’une nouvelle saillie ne vienne relancer la machine à buzz.
Rappeler les fondamentaux de la République est donc la « mission » que s’assigne Vincent Duclert, et celle-ci s’inscrit dans la continuité de son œuvre d’historien contemporanéiste, auteur entre autres de « la République imaginée », dans l’histoire de France en 13 volumes publiée par Belin et dont la Cliothèque a largement rendu compte.
La République est en panne d’imagination
C’est justement le constat que nous faisons aujourd’hui et que Vincent Duclert éclaire pour nous : La République imaginée est en panne d’imagination. Cela se traduit par une crispation frileuse sur « l’identité nationale », et autres « musées de l’histoire de France », qui voudraient figer dans le marbre d’une nécropole une spécificité qui serait exclusive et qui développerait surtout une volonté d’exclusion.
Sur le fond de la démarche, l’auteur dans la première partie, le régime réflexif de la République montre comment nos institutions politiques réagissent « de façon réflexive » aux différentes situations de rupture. La République elle même « est » rupture. Et il aura fallu au moins deux décennies pour que celle-ci s’installe à partir de « lois constitutionnelles » qui auraient pu tout aussi bien accoucher d’une monarchie parlementaire. En réalité la situation de l’époque n’aurait sans doute pas permis que ne s’installe une paisible monarchie parlementaire nordique tant les tensions sociales et politiques étaient vives.
En fait c’est bien cette République imaginée qui a permis, et l’auteur le rappelle à plusieurs reprises, le lien avec la démocratie. La République c’est le régime de la Loi qui ne serait pas imposée par le haut, mais c’est aussi le régime politique où le citoyen est acteur politique, par son vote et par sa participation à la vie publique, à la Res Publica, en fait. Peut-être aurait-il fallu alors mobiliser les grands textes de ces auteurs latins qui relataient l’exemple de ces soldats citoyens de Rome qui conduisaient les légions à la victoire avant de retrouver leur araire dans les champs de Campanie… Mais nous savons bien dans ce domaine la part du mythe et la réalité de l’absence de démocratie dans les institutions de la République romaine.
C’est justement ces questions qui se posent dans les différentes situations de rupture et les Républicains, essaient d’y répondre. Peut-être que cela manque-t-il aujourd’hui d’ailleurs.
Pourquoi je suis républicain ? écrivait Joseph Hours, professeur d’histoire en classes préparatoires en 1943, au moment où la République avait abdiqué. La République est un choix délibéré du citoyen. Et la communauté ne s’impose pas car la société est faite pour l’homme et doit le servir. Cela sans doute implique aussi la confiance dans une République irréprochable tant de fois promise et devenue parfois irrespirable avec des révélations d’affaires qui minent cette relation de confiance nécessaire entre le citoyen et ceux qui sont censés le servir en servant les institutions, au sens large, de l’État républicain.
La République et la loi
Dans la seconde partie, « une réflexion civique à l’œuvre », l’auteur apporte un bel éclairage sur différentes personnalités qui ont alimenté cet idéal républicain par leurs discours mais surtout par leurs actes.
Le cadre constitutionnel de la République intègre des droits fondamentaux qui font de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Cette exigence est portée par une définition philosophique de la République qui permet que les droits fondamentaux interdisent au législateur de voter des lois de circonstances qui s’opposeraient à eux. En fait le rôle du Conseil constitutionnel s’est vu réhabilité au fil des années, à partir des années 70, et il semblerait même que ce soit une des rares institutions de la République qui ne soit pas prise à partie en dehors de quelques remises en cause ponctuelles.
Jean Jaurès a su, dans son évolution de Républicain radical à Républicain socialiste incarner cet idéal qui conciliait République et démocratie, République et laïcité, République et Raison. Ce fil conducteur visait à permettre l’adhésion de tous à une République qui permettrait de concilier le mouvement et l’ordre, la liberté et la loi et que le combat d’idées n’irait pas jusqu’à la déchirure. (Discours d’Albi – 1903)
En citant Pierre Mendes-France Vincent Duclert apporte une autre dimension à son propos. Opposant à la constitution de la Ve République Pierre Mendes-France revient dans son ouvrage publié en 1962 sur les conditions de son arrestation et de sa captivité dans la France de Vichy. Si la décision arbitraire s’impose, si les garanties judiciaires sont remises en cause, la justice, fondement de la Démocratie ne joue plus son rôle. Et au passage on aurait pu continuer sur cette « anomalie » du système judiciaire français qui a pu entre 1940 et 1946, sans véritable remise en cause juger aussi bien des résistants que des collaborateurs sans parler de la sinistre section spéciale. Dans sa réflexion Pierre Mendès-France a développé également ce droit pour lui fondamental qui éclaire au sens propre sa conception du pouvoir, « le Droit de savoir », véritable exigence du citoyen qui peut alors exercer son libre choix en ayant les tenants et aboutissants du problème. Cela suppose de faire appel à la raison des individus et à leur capacité à appréhender les tenants et les aboutissants d’un problème porté à leur connaissance sans choisir la facilité des solutions sommaires et démagogiques. Ce sont bien les démagogues, ancienne appellation de ceux qui sont aujourd’hui qualifiés de populistes qui menacent la République, comme les démagogues stipendiés par Sparte, menaçaient la démocratie athénienne.
Le citoyen acteur et responsable existe-t-il encore ?
Cela suppose et c’est essentiel que le bulletin de vote, certes fondamental, ne soit pas la seule action du citoyen. Cela suppose la participation civique, l’engagement dans la vie associative Et au passage dans les débats sur l’enseignement de l’histoire, rejoindre les Clionautes serait déjà une belle façon d’engagement au moment où l’outil centenaire en charge semble avoir abdiqué !, politique et syndicale, entre autres. Au passage Pierre Mendès-France dénonce cette faiblesse de l’engagement et la rend responsable des difficultés de la IVe et de la Ve République. Il est vrai que le recours à l’homme providentiel, y compris dans le cadre du quinquennat malheureusement instauré en 2001, a sans doute aggravé ce phénomène en confiant la destinée à une sorte de monarque oint par le suffrage universel. Pierre Mendès-France et François Mitterrand ne disaient d’ailleurs pas autre chose en 1958, si ce n’est que le quinquennat, sans contre pouvoir a aggravé le phénomène.
Parmi les autres personnalités citées par l’auteur, il en est une qui est beaucoup moins connue que Jean Jaurès et Pierre Mendès-France, mais dont le rôle dans la constitution morale de la république a été éminent, à savoir Georges Boris. Acteur du débat intellectuel dans l’entre-deux-guerres, présent aux côtés du général De Gaulle à Londres, parmi les premiers, Georges Boris est chargé de mission auprès de Pierre Mendès-France et conseiller d’État en service extraordinaire dans différentes institutions internationales.
Républicain intransigeant, Georges Boris a consacré sa vie au service de ses idées, celle qui consistait à associer la république à l’idéal démocratique, avec un souci constant du bien public. Au tournant des années 1870 l’enjeu de la république au moment de sa fondation et de construire l’égalité des droits, l’universalité de la justice et de liberté politique tout en garantissant aux citoyens le respect de leurs identités. Ce programme semble toujours d’actualité, même sur un certain nombre de points, il peut encore faire débat.
Cette idée selon laquelle la République est fondée sur une constitution morale interpelle Vincent Duclert qui s’interroge dans la troisième partie sur les conflits de légitimité en temps de crise.
L’affaire Dreyfus, la France de Vichy, la guerre d’Algérie ont été autant de moments forts qui ont interpellé la république. La question qui s’est posée, au-delà des gouvernants, a des exécutants ou des metteurs en œuvre de leur politique, était bien de savoir comment concilier des exigences morales avec la loyauté envers leur fonction. La situation a d’ailleurs largement évolué et protège aujourd’hui des fonctionnaires qui peuvent refuser d’obéir à un ordre manifestement illégal. L’auteur ne mentionne pas que cela s’applique aussi aujourd’hui dans les armées.
De l’Affaire Dreyfus à la Guerre d’Algérie, le devoir de dire !
Aujourd’hui, ce qui a pu se passer en Algérie ne serait probablement pas possible à la fois parce que les cadres de l’armée ont été profondément renouvelés, mais également, en raison de la judiciarisation de l’espace militaire, ce qui peut être considéré comme un élargissement du spectre républicain dans une institution qui n’était pas naturellement porteuse de cet idéal au départ.
Pour des raisons évidentes, Vincent Duclert et beaucoup plus à l’aise lorsqu’il traite de la morale laïque de l’école républicaine, et du rôle de cette école dans la formation de la constitution civique de la république. On retrouve ces arguments dans les combats menés par Ferdinand Buisson au moment de l’affaire Dreyfus, un engagement qui n’a pas été immédiat mais qui, dès lors qu’il fut convaincu, a été total. L’affaire Dreyfus apparaît alors comme un laboratoire de la nécessité du devoir de réflexion critique, véritable obligation morale du citoyen républicain.
Et peut-être que ce devoir de réflexion critique devrait s’illustrer dans la défense de nos disciplines, à savoir l’histoire et la géographie qui forment, parmi d’autres, des citoyens acteurs conscients. Et si dans ce domaine le roman national peut-être remis sen cause, encore faut-il qu’un fil conducteur soit proposé au moment où l’on rédigera les programmes. La création de ce conseil supérieur des programmes ouvert à une sorte de société civile suscite effectivement question et espoirs, dès lors que l’on prendra la peine d’entendre les praticiens en charge de leur mise en oeuvre.
La guerre d’Algérie se retrouve également évoquée dans une partie que l’auteur consacre devoir d’information dans la république. La trajectoire de Michel Rocard, alors jeune inspecteur des finances nommé en Algérie en 1958, dans le cadre de son stage de « renforcement administratif » et à cette égard éloquente. Engagé dans une véritable quête de l’information, malgré le black out exercé par les autorités militaires de l’époque, Michel Rocard parvient à se faire entendre en présentant son rapport au délégué général du gouvernement, Paul Delouvrier. Par une chaîne d’information qui doivent beaucoup à des réseaux personnels que Michel Rocard, par tradition familiale, entretient avec des personnalités de la résistance proche des milieux gaullistes, ce rapport est finalement publié en avril 1959 dans le journal Le Monde, ce qui permet sans doute de favoriser dans l’opinion publique l’idée que la toute-puissance que l’armée exerçait en Algérie était moralement inacceptable.
Mais en même temps, il convient de rappeler que ce sont les autorités civiles qui avaient confié ces pouvoirs à l’autorité militaire, avec des ordres d’exécution parfaitement clairs mais non assumés.
Ce que l’auteur retient de l’affaire de « la note Rocard » c’est qu’il a été possible, sans faire de concession ni de compromis sur sa morale personnelle, d’être un serviteur loyal des principes de la République, principes qui avaient été bafoués par ceux là mêmes qui avaient mission à la servir.
La conclusion de l’auteur pose évidemment question : morale et politique en république ? Tout est affaire ici de mots et du sens que l’on veut bien leur donner. La politique c’est à la fois l’activité des partis, le travail des institutions, la constitution en fixe les règles de fonctionnement. Mais il y a aussi la politique qui est l’émanation d’engagements civiques, individuels et collectifs qui sont défendus également dans des constitutions qui rappellent de façon solennelle les droits fondamentaux.
Mais dans le même temps, cette exigence morale est portée par des femmes et des hommes qui s’engagent, qui disent et qui expriment aussi des alertes.
Encore ne faut-il pas confondre ceux que Raymond Aron appelait « les professeurs » et les coureurs de plateaux de télévision qui ont des plans « promo » à développer.
On permettra à l’auteur de ces lignes de penser qu’ils ne sont pas vraiment les plus qualifiés pour faire le lien entre morale et politique et que les engagements de circonstances ne durent que l’espace d’un tweet…
Bruno Modica