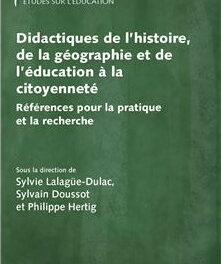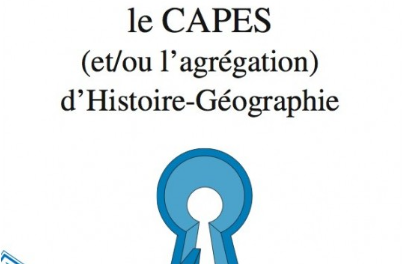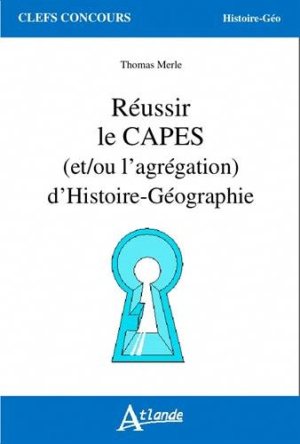
La partie III évoque les épreuves elles-mêmes. Comme dans la partie précédente, la vraie différence de ce livre réside moins dans l’exposition des règles officielles des épreuves, rappelées dans les rapports, que dans l’explication des attendus implicites du jury. On retiendra donc surtout le chapitre 10 sur l’épreuve sur dossier à l’agrégation de géographie, le chapitre 11 sur l’ « exploitation pédagogique » au CAPES et à l’agrégation interne, le chapitre 15 sur « réussir l’entretien », ainsi que quelques questions logistiques du chapitre 16, sur la nécessité supposée d’assister à des oraux du vrai concours avant son propre passage ou sur le contenu exact des bibliothèques de concours.
La partie IV, dans la foulée de la partie précédente, décrit les sujets et plans possibles. De précieux conseils sont donnés sur l’organisation du brouillon, ainsi que sur deux écueils redoutés : la problématique et l’élaboration du plan. La partie V est consacrée exclusivement aux croquis et représentations graphiques dans les copies.
L’intégralité de la partie VI sur la manière de rédiger une introduction, de concevoir une conclusion et de mettre en forme un paragraphe, rendra service à n’importe quel candidat. La partie VII sur la gestion du temps, à l’écrit et à l’oral, est assez courte. Elle vaut surtout, encore une fois, pour tous les conseils pratiques. Sur la prise d’aliments pendant une épreuve. Sur le temps de latence entre la fin de la préparation et le passage. Sur la gestion du temps à l’oral.
L’ultime partie n’est pas la moins intéressante, loin de là. Elle aborde l’après-concours et fourmille de conseils à propos de la saisie des vœux pour les stagiaires, de la formation en septembre en Espé, de la titularisation et de ses modalités, etc. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un professeur dans son cercle rapproché d’amis qui vous explique l’affectation des stagiaires. Tout le monde ne mesure pas à quel point le stage n’a rien d’une formalité.
En guise de conclusion, où réside la force de ce livre ?
Il est très difficile pour un candidat qui se présente pour la première fois au CAPES ou à l’agrégation de connaître, au-delà de la lettre, l’esprit et surtout la pratique des concours. Les préparateurs, souvent pressés de transmettre un maximum de connaissances sur un temps restreint, ne peuvent que rarement donner des conseils de méthode. Par ailleurs, le stress de la préparation et les récits des redoublants déçus, que l’on peut entendre dans les amphithéâtres ou devant la Maison des examens, alimentent fantasmes et angoisses. Qui n’a pas entendu de sordides récits sur les sujets qui tombent, sur la manière de corriger ou sur les oraux ? Les rapports eux-mêmes peuvent parfois, bien involontairement, donner l’impression d’un Everest tellement élevé qu’il en devient inaccessible. Entre la représentation du concours et ce qu’il est réellement, il y a souvent un monde. Ce livre a ceci de rassurant, c’est qu’il répond à toutes les questions, même celles que nul n’oserait poser à un préparateur.
Par ailleurs, le livre ne tombe pas dans l’écueil du simple retour d’expérience où l’auteur se contenterait de généralités produites par son seul parcours. Les conseils donnés sont à la fois percutants et pondérés. Percutants parce que l’auteur justifie la moindre de ses assertions et cultive une liberté de ton franchement rafraîchissante. Pondérés parce qu’ils croisent les analyses des rapports, des préparateurs, des ouvrages de méthode existants, des candidats et lauréats de sa connaissance. Tout au plus peut-on reprocher à Thomas Merle un goût immodéré des parenthèses, ce qui dans la balance, ne pèse quasiment rien.