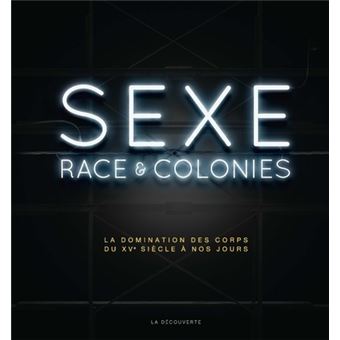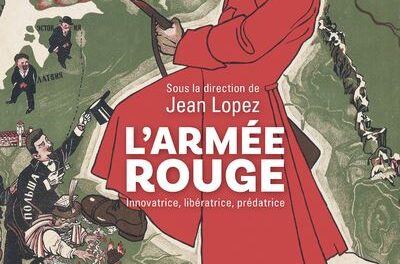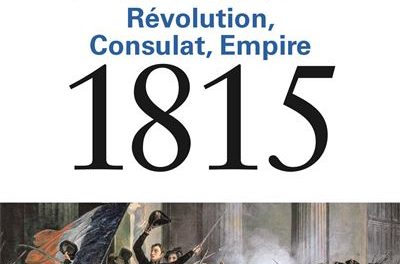Faut-il rappeler que, dès sa sortie, ce gros ouvrage a fait l’objet d’une sévère polémique dans la presse nationale ? En cause, la présence parmi les quelques 1200 images exposées dans le livre de photographies prêtant le flanc à une critique sur leur visibilité, en tant que clichés pornographiques et racistes, racistes dans leur obscénité.
Une polémique ciblée sur l’iconographie
Il n’est pas impossible que ce qui ait mis le feu aux poudres soit en fait la promotion de l’ouvrage dans le numéro du quotidien Libération du 22 septembre 2018, composé d’un cahier de plusieurs pages, d’une sélection de photos parmi les plus dures de l’ouvrage, mais aussi d’un titre en première page qui orientait leur lecture dans un sens restrictif et provocateur : « le viol colonial ». Parmi les nombreux comptes-rendus sortis dans la presse les jours suivants, prenons la tribune de Mélusine, « militante féministe et antiraciste », parue dans Libération du 30 septembre. Il apparaît qu’elle en vient à confondre la démarche des auteurs du livre avec celle des journalistes : « Si ces photographies sont traitées comme n’importe quelle image d’illustration, par les auteurs comme par les journalistes, c’est que ceux-ci n’ont pas compris ce qu’elles étaient ». Plus loin, elle poursuit : « Prises pour soumettre, diffusées pour exclure les colonisé(e)s de l’humanité, elles constituent en réalité des pièces à conviction, qui n’ont d’autres vocations qu’être mises en vitrine pour attirer le chaland. Les rédactions auraient pu faire un autre choix. Il leur était possible de ne pas du tout illustrer leurs articles et de justifier cette décision éditoriale par le refus de perpétuer la diffusion à grande échelle des images de l’exploitation sexuelle de corps racisés. Elles auraient également pu rendre à ces femmes leur visage et leur regard, recadrer ces cartes postales pour recouvrir les corps aux vêtements arrachés ». Qu’elle condamne la démarche journalistique visant à faire le buzz (quand bien même il est aisé de saisir les enjeux financiers à l’œuvre dans le monde plutôt mal en point de la presse écrite) peut sembler légitime tant l’échantillon iconographique sélectionné n’est en rien significatif du corpus général du livre. Mais il est pour le moins étonnant d’envisager une censure de ces images coloniales : en imaginant que cela se fasse, quelles images aurait-il fallu oblitérer et selon quels critères de définition du pornographique ?
L’histoire n’a rien d’une science morale (pour reprendre l’expression de Pascal Blanchard, l’un des directeurs de l’ouvrage, dans une interview parues dans les Inrocks du 8 octobre) qui aurait pour vocation à retoucher des sources, afin de les faire correspondre à un discours politiquement correct à l’égard des victimes de l’histoire. Le respect des victimes de la violence coloniale, que la violence exercée soit d’ordre sexuel, économique ou militaire, passe par un discours de vérité fondé sur toutes les sources à disposition des historiens, qu’elles soit écrites ou visuelles. Pour reprendre une comparaison faite à l’occasion de cette polémique, avec les images du génocide des Juifs lors de la Seconde guerre mondiale, imagine-t-on ne pas montrer les photographies anonymes, réalisées par des membre du Sonderkommando d’Auschwitz II-Birkenau, montrant des femmes poussées vers la chambre à gaz du crématoire V en août 1944, sous prétexte qu’elles sont nues ? Devrait-on se passer de ces preuves iconographiques accablantes, corroborées par de nombreuses documents écrits, par respect des victimes ? D’autant que les nombreux auteurs de l’ouvrage « Sexe, race & colonies », tous spécialistes d’une période précise de la colonisation, ont pris soin par des textes de longueur variable de mettre en contexte ces images, quelles qu’en soit l’époque et la nature, et de sélectionner un panel d’images allant des plus classiques aux plus troublantes. Surtout, ces images exercent une fonction réparatrice : « ne pas montrer, c’est édulcorer la nature des rapports coloniaux de soumission » répond Christelle Taraud dans la revue L’histoire de septembre 2018, où elle répond à la question : « Fallait-il montrer ces images ? » en décortiquant deux photos particulièrement choquantes présentes dans l’ouvrage. À ces yeux, affronter les images les plus insoutenables est un devoir de l’historien-ne, pour éviter qu’elles ne deviennent inimaginables.
Un « gros beau livre pornographique » ?
En fait, la polémique a aussi porté sur deux autres aspects (au sens premier du terme) de cet ouvrage. Il lui est reproché d’abord d’entrer dans la catégorie des « beaux livres », proche d’un catalogue d’exposition, de ceux que l’on offre à Noël et qui est finalement plus feuilleté que véritablement lu. Cette recherche de l’esthétique serait à l’origine d’un malaise chez le lecteur : c’est cette « esthétisation incongrue », incompatible avec un livre d’histoire, qui devient l’une des cibles principales de la critique d’André Gunthert dans Libération du 10 octobre ou de Florent Georgesco dans Le Monde des Livres du 4 octobre intitulée « Érotisme et colonialisme, le piège de la fascination », illustrée par une photo montrant la mise en scène d’un faux « couple mixte » au Mozambique au début du XXe siècle (p. 243). C’est encore l’objet principal de la critique de Daniel Schneidermann dans Libération du 7 octobre, qui dénonce « un beau livre de viols coloniaux ». Et de préciser : « On vomit parce qu’on a cru ouvrir un livre d’histoire, et qu’on se retrouve en train de feuilleter un gros beau livre porno ». Dans ce texte volontiers provocateur ( « Oui, certains lecteurs vont le lire d’une seule main. Tout le monde fait semblant de ne pas le savoir, de regarder ailleurs, mais l’auteur le sait. L’éditeur le sait. Les libraires le savent, s’ils ont ouvert le livre »), le journaliste manie même la mauvaise foi lorsqu’il affirme qu’ « à aucun moment, les auteurs n’ont tenté d’y coller des mots » ! Mais il est clair que toutes ces images auraient gagné en lisibilité et en signification si le choix éditorial avait été de placer, à la suite des notices de présentation (toujours impeccables), une courte analyse contextualisée de chaque œuvre. Même si cette démarche a parfois été accomplie brièvement, on aurait préféré pouvoir lire un décryptage plus fouillé, comme celle de la photographie page 335 expliquée dans le numéro 451 de L’Histoire… mais pas dans l’ouvrage, quitte au final à réduire la voilure iconographique du volume, pour faciliter la navigation visuelle du lecteur.
L’autre reproche concerne la maquette de la couverture. Alors que les auteurs ont justifié leur choix dans Les Inrocks, à savoir de ne pas mettre une image d’époque coloniale en couverture, de peur de ne pouvoir la contextualiser, ils ont opté pour une construction iconique et textuelle inspirée d’une œuvre de la plasticienne ivoirienne Valérie Oka. On y voit le titre inscrit sous la forme de néons blanc sur fond noir, afin de symboliser la domination sexuelle européenne sur l’Autre, dans une référence explicite aux néons criards des sex-shops et autres maisons de passe. Or, il apparait que cette image-texte n’est à aucun endroit de l’ouvrage explicitée ni contextualisée, tandis que la photo pudique d’une esclave égyptienne nue vue de dos, exhibée sur la 4e de couverture, est présentée en page 2 et peut trouver des éclaircissements dans certains des chapitres de la partie 2, comme ceux consacrés à « La lente fabrication des stéréotypes de l’Orientale et de l’Oriental » ou à l’« Érotisme colonial et « gout de l’Autre » ».
Une histoire mondiale de longue durée
La plupart des compte-rendu négatifs se sont cantonnés de fait à une critique polémique, parfois agressive, de l’utilisation de ces images troublantes et même violentes. Ils ne disent souvent presque rien du corps du livre, pourtant rédigé par un collectif d’historiens internationaux, pour la plupart français il est vrai. Le découpage de l’ouvrage reste très classique, fondé sur une périodisation en quatre temps, dont la chronologie épouse les contours du phénomène « colonisation-décolonisation », chacune désignée par un mot unique, faisant office de titres, dont certains pourraient prêter le flanc à la critique. La 1e partie s’intitule ainsi « Fascinations » et se développe sur quatre siècles, de 1420 à 1830, en gros la première colonisation ouverte par l’expansion portugaise jusqu’aux indépendances américaines et l’abolition de la traite Atlantique. Puis s’ouvre le siècle des « Dominations », entre 1830 et 1920, marqué par la colonisation de presque tout le continent africain et les avancées européennes en Asie et Océanie. Le 3e temps s’intitule logiquement « Décolonisations : 1920-1970 », tandis que les cinquante dernières années seraient caractérisées par les « Métissages ». Au sein de ces quatre parties, dix-sept longs articles de 25 à 30 pages se voient régulièrement truffés d’une incise d’une page ou d’une double page, allant de « La cartographie, un regard sexualisé sur le monde » à « Art, féminisme et critique de l’orientalisme » : ces cent vingt courtes notices sont autant d’entrées qui peuvent être lues au fil de l’ouvrage ou appréciées pour elles-mêmes. Au final, il faut reconnaître que l’omniprésence des images de toute nature et de toute taille (du format timbre à la double page couleurs luxueuses) et ces multiples entrées micro-thématiques rendent le suivi de la lecture des articles majeurs plus complexe… et peuvent in fine inciter le lecteur un peu pressé à se laisser « prendre » par les images et en venir à compulser l’ouvrage principalement pour l’iconographie, comme il en va de tout beau livre !
Imaginaires, violences, métissages
Les articles se polarisent en fait sur trois grands thèmes récurrents, qui offrent aussi une possibilité de lecture longitudinale, permettant d’observer les continuités et les ruptures sur le temps long. En fait, ce sont trois concepts qui structurent l’ouvrage, ceux d’imaginaires, de violences et de métissages.
– L’imaginaire renvoie à des questions de représentations de l’Autre, des stéréotypes visuels du colonisé/dominé, mais aussi des déconstructions récentes des ces clichés. Pas moins de sept articles renvoient à ces imaginaires sur l’altérité des corps, leur beauté, leur étrangeté, l’attractivité ou la répulsion qu’ils suscitent chez les Européens : « Les corps de l’ « Autre ». Les représentations des Africains et des Amérindiens » (p. 42-65), « L’iconographie sexuelle des « sauvages » et la passion exotique et érotique » (p. 90-113), « La lente fabrication des stéréotypes de l’Orientale et de l’Oriental » (p. 192-217), « Érotisme colonial et goût de l’Autre » (p. 244-269), « Spectacles ethnographiques, pornographie exotique et propagande coloniale » (p. 272-301), « Fascinations et répulsions pour le corps noir » (p. 302-331) et « Reconstruire l’ Autre corps : émancipation et création contemporaine » (p. 478-505).
– Au-delà de ces imaginaires des relations coloniales, uniquement considérés à sens unique, puisque ces images sont des productions des dominants, mettant en scène leur propre domination sur l’Autre, l’étape suivante de la dépossession du corps des dominés se fait à travers les violences physiques de la possession sexuelle, suggérée, mise en scène ou dévoilée dans cinq articles : « Possessions et érotisation violentes des femmes esclaves » (p. 114-137), « Disposer des corps : contrôler, surveiller et punir » (p. 140-165), « Économie politique de la sexualité coloniale et raciale » (p. 166-191), « Violences sexuelles au temps des décolonisations » (p. 362-391) et « Les nouveaux territoires de la sexualité postcoloniale » (p. 450-477).
– Enfin, ce parcours de lecture s’achève par une dernière thématique axée sur les métissages, un phénomène bien souvent entaché de violences en contexte colonial, mais qui permet aussi démontrer une des formes de l’ « agentivité » (du terme anglais agency) de certaines femmes, qui ne furent pas toujours aussi passives que ne pourrait le faire croire le discours victimaire dominant et disposait d’une capacité d’action relative. Cette réalité du métissage biologique est déclinée également sur la longue durée, des relations sexuelles entre Ibériques et Amérindiennes au XVIe siècle au tourisme sexuel contemporain, dans cinq articles : « De la désirabilité de l’ « Autre » à la hantise du métissage » (p. 66-89), « Hygiène coloniale, sexualité et métissage » (p. 218-243), « Sexualité, couple et mariages interraciaux dans le colonial tardif » (p. 332-361), « Métissage et Métis : sexualité, sociabilité et politique de l’identité » (p. 394-421) et « Mondialisation, immigration et nouvelle identité : libérer le regard » (p. 422-449).
La catégorie de métissage : une histoire mondiale sur la longue durée
C’est à partir de cette catégorie de métissage que nous aimerions pratiquer une lecture de longue durée d’un phénomène consubstantiel à la colonisation, un phénomène incontournable et pourtant d’emblée problématique, ce à plusieurs titres. Le brillant article de Gilles Boetsch, « De la désirabilité de l’ « Autre » à la hantise du métissage », montre que les représentations de la sexualité de l’Autre du XVe au XVIIIe siècle, réelle ou supposée, prennent les formes les plus extrêmes et curieuses : elle oscille entre deux pôles, l’exotisme et le désir par opposition à l’amoralité, la déviance, la bestialité et la transgression (en particulier les vices de la masturbation et de l’homosexualité) , mais toujours les Européens définissent ces sociétés par une absence de règles civiles, religieuses, morales. La liberté sexuelle, l’inversion des normes et des rôles genrés (avec des femmes actives qui prennent l’initiative) y sont dénoncées et permettent de promouvoir une morale sexuelle pour les Européens, axée sur la monogamie, l’indissolubilité du mariage et une sexualité préoccupée de reproduction.
Pourtant la rareté des femmes européennes en contexte colonial a conduit les administrations coloniales civiles et religieuses à tolérer les rencontres interraciales, y compris avec des esclaves, de préférence à travers le mariage chrétien et la conversion de l’épouse autochtone. A l’instar des Signares de Sénégambie, elles ont aussi servi d’intermédiaires au commerce des Européens dans cette région pendant plusieurs siècles (encadré, p. 74). Mais les XVIIe et XVIIIe siècles voient progressivement le passage d’une tolérance à l’égard des unions mixtes et des enfants métis à une législation ségrégationniste interdisant la sexualité interraciale, en relation avec des préjugés de couleurs et une idéologie raciste. Conçues à travers la grille de dégénérescence, ces unions interraciales sont vues désormais comme une menace pour les fondements de la politique coloniale et de la stabilité des catégories agissantes, comme celles de gouvernants-gouvernés : le métissage est un danger pour la pérennité des colonies, tandis que le mélange des « races » est aussi conçu comme un processus d’abâtardissement de la race humaine.
Puis, Olivier Le cour Grandmaison observe dans « Hygiène coloniale, sexualité et métissage » qu’au XIXe et au début du XXe siècle, l’hygiénisme dominant prescrit aux Européens vivant aux colonies de faire preuve de tempérance dans leur quotidien, en particulier dans leur vie sexuelle, surtout s’ils s’adonnent à des relations interraciales. Ils risquent en effet d’être victimes de l’anémie tropicale (une forme d’acédie contemporaine) mais surtout de contracter des maladies vénériennes, en particulier la syphilis, qui touchent aussi bien les civils que les militaires (seules quelques caricatures montrent que les Européens peuvent eux aussi les propager aux femmes « indigènes », comme on le voit à la page 221). Les mises en garde des autorités et des médecins concernent notamment les lieux de la prostitution interlope, dans les ports ou les villes de garnison. Dès lors que la colonisation de peuplement se développe, en Algérie, en Afrique du Sud ou en Indonésie néerlandaise, avec l’arrivée de « femmes blanches » plus nombreuses, la famille coloniale devient la norme d’un ordre sexuel strict. Cependant, la liberté sexuelle des colonisateurs se manifeste toujours, en particulier par le recours à des femmes plus exposées, comme les ménagères ou les prostituées. Mais la crainte de l’ « indigénisation » est de plus en plus manifeste et aboutit au début du XXe siècle à la promulgation de lois criminalisant les relations mixtes, sexuelles ou matrimoniales. Mais c’est en fait depuis certaines régions des États-Unis, en particulier après l’annexion de Porto-Rico et des Philippines en 1898, que se propagent l’idéologie raciste et la législation ségrégative. Elles est imitée dans les colonies allemandes, belges, japonaises et secondairement britanniques, tandis Français, Portugais et Italiens pratiquent un double jeu. Ainsi, la France se démarque par une absence de législation prohibitive, mais la norme sociale se charge de contribuer à une forte endogamie comme en Algérie. Car c’est désormais la figure du métis, incarnation de la dégénérescence raciale, qui inquiète les scientifiques et incite certains États à prôner la mixophobie. Désormais, l’hygiénisme rejoint le moralisme pour condamner sans retenue toute forme de métissage : il est synonyme de dégradation des Européens, hommes comme femmes, dont la « pureté de sang » est la garantie de la réussite de la « mission civilisatrice », fondement de l’idéologie coloniale.
L’article « Métissage et Métis : sexualité, sociabilité et politique de l’identité », rédigé par Rachel Jean-Baptiste, Dominic Thomas et Nicolas Bancel, nous fait entrer dans la période médiane du XXe siècle. L’idée dominante dans les sociétés tardo-coloniales était que le métissage biologique avait engendré peu d’enfants métis dans le demi siècle allant des années 1920 à 1970, sans doute parce que ces métis ont été victimes d’une tension fondamentale. Ils étaient soit rejetés à la fois par les Européens et les indigènes, parce qu’ils remettaient en cause les frontières raciales de la société coloniale, soit entièrement absorbés et niés dans leur identité métisse pour résoudre le problème de l’hybridité de sociétés très cloisonnées (voir l’ouvrage d’Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007). Ainsi, dans l’Empire colonial français des années trente, la loi permit aux métis issus d’un père français d’obtenir la nationalité française, pour des raisons de sécurité publique, ces individus de l’entre-deux étant par essence considérés comme des asociaux susceptibles de se retourner contre l’ordre social.
En contexte postcolonial, le statut du métissage prend une dimension nouvelle, en ce sens qu’il oblige les porteurs de cette identité à s’accommoder du legs d’une histoire personnelle réprouvée, par la loi ou par la morale. C’est l’expérience que rapportent deux romanciers dans deux ouvrages parus en 2016 : dans The Sympathizer, Viet Thanh Nguyen raconte l’itinéraire d’un métis de père Français et de mère Vietnamienne, tandis que Trevor Noah narre ses mémoires dans l’Afrique du Sud de l’Apartheid avec Born a Crime : Stories from a South African Childhood. Il apparait que la relation hiérarchique, sexuelle et raciale, issue de l’ordre colonial se poursuit, y compris dans la société métropole postcoloniale, comme le montre le cinéma français depuis un demi-siècle, ainsi dans Élise ou la vraie vie, roman de Claire Etcherelli de 1967, porté à l’écran en 1970, afin de mieux dénoncer le stigmate associé aux « couples mixtes », ici à travers l’amour entre une Française avec un Algérien. Néanmoins, depuis trente ans, nombreux sont les récits et les films mettant en avant des personnages métis, affichant et négociant leur « double identité », celle qu’ils ont d’eux-mêmes et celle que leur renvoie la perception des Autres.
La période très contemporaine est traitée dans « Mondialisation, immigration et nouvelle identité : libérer le regard », par Pascal Blanchard et Dominic Thomas. Aujourd’hui, le métissage se présente comme une mode, un référent esthétique de la société-monde : dans les médias et la publicité, incarnée par Benetton, est dévoilée une société sans « race » et sans conflit, faisant du métissage une nouvelle norme positive. Autant dire qu’il se fait idéologie de la société postcoloniale : issue de l’héritage colonial et des migrations Sud-Nord, la rencontre sexuelle interraciale remise au placard la prétendue pureté raciale : nouvelle utopie dans le contexte du village global, le métissage peut aussi être perçu comme horizon absolu de la perte de la tradition. Mais en brisant le mythe des origines, il devient une menace, qui engendre une mixophobie de la part des « petits-blancs », nettement visible dans les États-Unis de Trump, où le melting-pot n’est envisageable qu’entre descendants d’Européens.
Le cas du Brésil (développé dans un encart page 430) démontre que le métissage devient une identité en soi, comme on le perçoit dans les données du dernier recensement, mais qui ne remet pas en cause pour autant les hiérarchies socio-raciales, car il s’insère aussi dans des stratégies de blanchiment. Le Brésil connaît aussi des formes de déconstruction du mythe fondateur du métissage, que la réalité sociale se charge de nuancer fortement : ainsi, 80% des mariages y sont endogames, au sein d’un même groupe de couleur, tandis que l’identité africaine est revendiquée et assumée comme positive et favorise l’éclosion des mouvements culturels d’africanisation.
Si le métissage biologique a longtemps été vu comme un facteur de dégénérescence raciale depuis l’époque coloniale, jusque dans l’Apartheid sud-africain, peut-il aujourd’hui constituer « une troisième voie entre les discours d’assimilation et les revendications communautaires » ? Rien n’est moins sûr, car il repose lui aussi sur une approche raciale, voire raciste de la société (un « racisme inversé » selon Jean-Loup Amselle). Surtout, par la diversité des ingrédients qu’il intègre et dissout, le métissage pourrait ne pas devenir un principe collectif d’appartenance, mais continuer de relever de la sphère personnelle, d’une identité individuelle comme une autre.