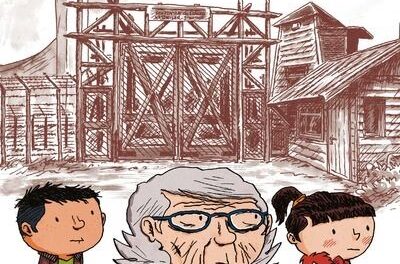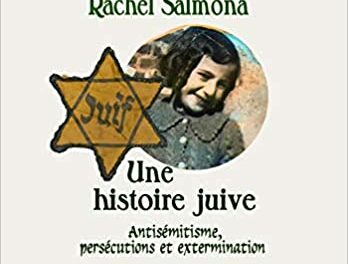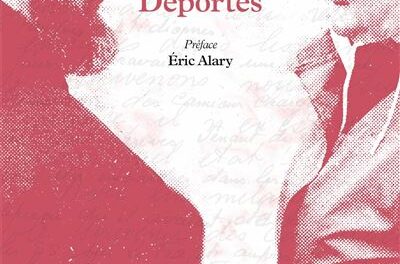Le titre peut être trompeur et le livre aurait pu s’appeler « De la douleur de témoigner » car c’est bien de cela qu’il s’agit. Il n’y a rien ici d’un récit de déportation, aucune description d’Auschwitz, pas de crématoires, pas de SS violents ni de squelettes en pyjama rayé. Là n’est pas le propos. Juive hongroise, Edith Bruck, surnommée plus tard « Signora Auschwitz » par une jeune lycéenne, est revenue de « là bas ». Ce « là bas » que l’on trouve aussi, de manière récurrente, sous la plume de Charlotte Delbo comme pour ne pas nommer cet « ailleurs » indescriptible et surtout incommunicable. Un « ailleurs » qui n’est nulle part et qui est partout. Partout dans la mémoire et dans le corps de « la dame d’Auschwitz », déportée en avril 1944, à l’âge de 12 ans, avec sa famille qui elle ne revint pas. Ce livre, sous-titré « Le don de la parole », est un essai sur la nécessité vitale de témoigner et la douleur de ce témoignage, ainsi qu’une réflexion sur la mémoire et sa transmission. Tenter de dire l’indicible est une souffrance, surtout lorsque l’on a choisi – mais est-ce un choix ? – d’être un témoin « professionnel » ou, pour mieux dire, « presque un mercenaire » (Primo Levi) de la mémoire.
Le livre témoigne donc de la difficulté à témoigner et de l’état de délabrement physique, moral et psychologique que suppose ce témoignage. Edith Bruck nous fait part de sa profonde souffrance et des intenses douleurs, largement somatiques, qui s’emparent de son corps pendant et après chacun de ses témoignages. Douleurs qui la conduisent à consulter de multiples médecins, à ingurgiter de fortes doses de médicaments pour tenir et à séjourner régulièrement à l’hôpital. En outre, à son passé, sédimenté dans ses organes, s’ajoutent les affres de la vieillesse. L’auteure, femme de lettres, tente de nous faire partager le conflit permanent qui la traverse. D’une part l’impérieuse nécessité de témoigner, de l’autre la volonté d’en terminer avec cette épreuve presque insurmontable. Sa volonté de témoigner le dispute à son désir de ne plus se livrer à cet exercice qui est devenu un « second métier ». Edith Bruck est en permanence sollicitée et ne parvient pas à refuser car « dire non coûte presque autant que de dire oui et le non n’apporte rien d’utile ».
Alors, « Signora Auschwitz », italienne d’adoption, parcourt le pays à la rencontre des jeunes Italiens pour délivrer son témoignage de rescapée mais aussi ses réflexions sur la violence, le racisme et l’antisémitisme et surtout la mémoire. Une mémoire polymorphe, tout à la fois personnelle et collective. Or, la douleur d’Edith ne vient pas simplement des souffrances du passé et de la conscience d’un « impossible retour – on ne revient pas de « là-bas » – mais également de la difficile confrontation avec les jeunes générations. Son ami Primo Levi, spécialiste lui aussi de la transmission mémorielle, a le premier désidéalisé cette rencontre entre témoins et « Jeunes ». Dans son livre, « Le devoir de mémoire » (1983), il fait part d’une grande lassitude en tant que témoin et ne veut pas être réduit à son seul statut de survivant. En 1996, une autre rescapée, Anne-Lise Stern, intitule par dérision l’une de ses conférences « Sois déportée… et témoigne ! ». Si le « travail » de mémoire est nécessaire, le « devoir », lui, en ce qu’il implique d’obligation, pour les survivants comme pour les plus jeunes, est un fardeau. En ce sens le surnom « Signora Auschwitz », pour être innocent et certainement bienveillant, n’en résonne pas moins de façon terrible. Il en va de même de certaines phrases prononcées par des enseignants maladroits qui encouragent leurs élèves à profiter pleinement de la présence d’un témoin, tant qu’il est encore temps… Si le passé est douloureux, le présent l’est aussi qui ordonne de se dépêcher et de témoigner jusqu’à l’épuisement.
Ainsi la confrontation avec les élèves, et parfois leurs enseignants, n’est pas chose facile et la bonne conscience pédagogique fait trop vite oublier que la personne qui témoigne n’est pas simplement une « voix » ou un être désincarné. Lorsqu’il prononce ses phrases, le témoin souffre dans son corps. Voilà de quoi témoigne celle qui n’est pas Que « la dame d’Auschwitz ».De plus une autre question embarrasse le témoin : la valeur et la légitimité de son témoignage. Comme l’écrit Primo Levi « Avons-nous été capables, nous qui sommes rentrés, de comprendre et de faire comprendre nos expériences ? » (« Les Naufragés et les rescapés », 1985). On notera au passage que Primo Levi utilise ici le terme « rentrés » et non celui de « revenus ». La nuance est importante si l’on souhaite approcher la psychologie de nombreux témoins. Cette interrogation préoccupe aussi Edith Bruck tout comme elle partage avec son ami un difficile rapport aux « Jeunes ». Rapport qui, effectivement, ne peut être simple sinon à céder à l’idéologie « jeuniste ».
L’attitude de ces jeunes, que la société nouvelle met sur un piédestal, est souvent une offense pour la « Signora » qui doit se confronter à des rires ou des questions déplacés, une indifférence volontairement affichée, des attitudes peu conformes à la situation ou encore voir sa parole se heurter à un mur d’écouteurs… La liste n’étant bien entendu, et hélas, pas exhaustive. De fait, Edith Bruck doit faire face à tout le catalogue « jeuniste », particulièrement riche en interventions saugrenues (l’amour et le sexe au Lager) et aux questions sempiternellement répétées (sa haine ou son pardon, les horreurs vécues, sa foi…). Et, tout blesse et démoralise Edith. Mais, comme le lui dit un ami, ancien déporté lui aussi : « L’ignorance n’est pas la faute de ceux qui ne savent pas mais de ceux qui savent et n’enseignent pas. C’est pour cela que nous, nous devons parler, de tout ». Soit. Pourtant Edith Bruck avoue : « l’attitude de certains jeunes me tourmentait des jours et des nuits. Je vivais leur indifférence comme une défaite ».
Néanmoins Edith trouve la force de persévérer et cherche du réconfort dans les témoignages remplis d’une sincère émotion et montrant un vif intérêt de la part de certains de ces jeunes. Aussi se dit-elle qu’il faut continuer, ne serait-ce que pour quelques uns… Où l’on constate la position particulièrement ingrate dans laquelle se trouve le témoin, et que connaît, en partie, n’importe quel passeur de savoir. Ainsi, et en dépit de ses tourments, psychologiques et physiques, Edith se rend inlassablement dans les établissements scolaires pour porter la voix nécessaire de la mémoire mais tout en se demandant, au fond, pour qui elle témoigne vraiment. Les morts ou les vivants ? Pour « eux » ?, Pour elle ? Pour les jeunes ? Certainement un peu de tout cela. Or, après chaque intervention, Edith se jure que c’est la dernière. Physiquement, plus encore que psychologiquement, mais les deux sont liés, elle ne se sent plus capable et ce d’autant que, dans ses phases d’abattement, elle perçoit de moins en moins l’utilité de son témoignage. Sollicitée par les établissements scolaires, poussée par ses amis, elle persiste malgré la douleur, malgré cet « ailleurs » qu’elle porte en elle et qui la ronge. Chaque témoignage est alors comme un exutoire, une tentative d’expulser Auschwitz, de s’en débarrasser. Vaine illusion. Auschwitz fait partie d’elle et continue de l’endolorir.
Un jour, durant une « tournée » de conférences dans la région de Brescia, et après avoir honoré un agenda rempli par une amie, elle s’effondre. Edith ne peut plus. Ecoutons-la : « Je suis vidée et fatiguée comme si j’avais non pas témoigné, mais trop marché pendant un demi-siècle. Je n’arrive même plus à transmettre aux jeunes ce que je devrais, je suis un peu comme un robot exsangue. Un pantin à la batterie déchargée, et la bande son abîmée d’avoir trop servi ». Littéralement malade, Edith, après un passage par les urgences, doit absolument rentrer chez elle et se reposer. Faisant part de cette nécessité à son amie qui s’en inquiète un échange s’ensuit :
– « Tu reviendras alors ? Tout le monde t’attend ici, nous avons tellement besoin de toi »
– « De moi ou de ce que je représente ? »
– « Ce n’est pas la même chose ? »
Edith Bruck se résigne finalement, non sans douleur, à arrêter la ronde infernale de ses interventions mais continue à donner des interviews pour témoigner tout de même car« c’est une histoire qui ne passe pas, qui ne peut pas passer et qui ne doit pas passer »…