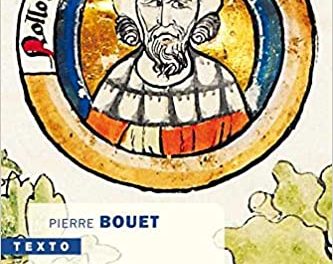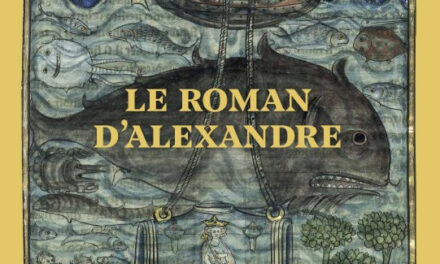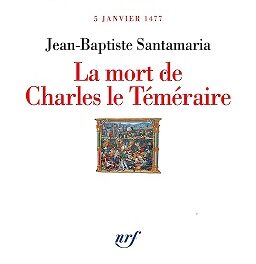À partir de la chambre à coucher, notre historienne explore donc le quotidien de la maison : le lit, souvent isolé du carrelage par une estrade et du froid par son éloignement de la porte, était le meuble essentiel ; il était suffisamment large pour qu’on y dorme, nu, à plusieurs. La chambre à coucher servait également à d’autres usages : comme salle à manger, comme lieu de réception, le lit servant alors de divan, comme bureau, etc.. C’est bien entendu là que se tenait le berceau du nouveau-né, qu’on avait solidement emmailloté, pour son bien, pensait-on alors ; or, l’emmaillotage « serré des membres inférieurs […] augmente de façon notable le risque d’une luxation de la hanche pour le nouveau-né. » (p. 50) Les couleurs de son vêtement renseignent sur son appartenance sociale : ainsi, les langes étaient blancs ou rouges quand on était né dans une famille aristocratique. En Italie, l’enfant était bercé suivant un mouvement de bascule vertical, tête-pieds.
Comme on le sait, de nombreux enfants étaient rapidement mis en nourrice : « Les bébés, s’ils l’avaient pu, auraient dû se méfier des nourrices. En effet, les cas suivants sont documentés comme causes de rupture du contrat [entre le père et le mari de la nourrice] : mauvais traitements, chutes du berceau, dénutrition, défaut de soin, maladies, fièvres, et même mort par étouffement. » (p. 92) Comme l’enfant risquait, assez fréquemment, de décéder s’il dormait à côté de sa nourrice, les enfants étaient amenés chez elles munis de nombreuses amulettes … Chiara Frugoni commente d’ailleurs longuement un grand retable, la « Vierge à la Pergola », réalisé par Bernardino Detti en 1523 : commandé pour décorer l’autel de la chapelle de l’hôpital Saint-Barthélemy-et-Saint-Jacques de la Pergola à Pistoia, il représente, notamment, un grand nombre des menaces qui guettaient la petite enfance.
« Quand finalement le bébé était en mesure de tenir debout tout seul, les langes étaient mis de côté et il obtenait enfin son premier vêtement : une grande chemise longue, souvent rouge pour des raisons conjuratoires, sans aucun linge de corps. Les larges fentes latérales permettaient un moindre embarras pour les besoins naturels. » (p. 119) Il pouvait faire ses premiers pas, à l’aide d’un déambulateur.
Concernant l’apprentissage de la lecture et/ou de l’écriture, le marchand florentin Paolo da Certaldo écrivait, au XIVè siècle, dans son « Libro dei Buoni costumi » : ‘si l’enfant est une fille, apprends-lui à cuisiner et non à lire car il ne convient pas véritablement à une personne de sexe féminin de savoir lire à moins que tu ne fasses d’elle une religieuse.’ (p. 164) Les enfants qui n’étaient pas envoyés à l’école étaient mis au travail très jeunes. Pour Chiara Frugoni, « il semble que le divertissement n’ait été jugé approprié que pour les garçons : jeux d’action et de rôle avec des simulations de guerres et de tournois dans lesquels ils étaient les uniques protagonistes. » (p. 182) En effet, elle constate que, dans la documentation visuelle et archéologique, « les petites filles […] sont rarement montrées en train de jouer. Si elles ont une poupée en main c’est quasiment toujours une poupée de luxe, ce qui laisse supposer que ces filles appartenaient à une classe sociale privilégiée ; [ce] jouet coûteux […] apparaît non comme le support d’un échange participatif mais comme le modèle du futur qui les attend »… (p. 175) Les jeux d’enfants, pratiqués surtout à l’extérieur, compte tenu de l’exiguïté des espaces intérieurs, étaient nombreux : on en a un bel exemple avec les quelque quatre-vingt jeux d’enfants représentés sur l’étonnant tableau de Peter Brueghel (1560).
En généralisant quelque peu, Chiara Frugoni estime que « la femme au Moyen Âge ne peut affirmer sa personnalité si ce n’est en refusant le mariage et en se consacrant à l’époux céleste. » (p. 221) Elle consacre donc aux moniales tout un chapitre fort intéressant : elle y évoque notamment, par le texte et l’image, la béate Humilité de Faenza, à laquelle Pietro Lorenzetti a consacré, autour de 1340, un tableau ainsi que le fameux « Hortus deliciarum », l’« une des plus belles encyclopédies du Moyen Âge, réalisée entièrement par les sœurs du monastère du mont Sainte-Odile à Hohenbourg en Alsace » (p. 237) A ce sujet, elle souligne avec justesse : « Quand nous feuilletons un manuscrit enluminé, nous l’associons presque automatiquement à la main d’un homme. Nous devrions pourtant nous imaginer ces innombrables générations de moniales oubliées, occupées à copier, collationner, enluminer, composer, dont on parvient, avec un peu de patience et d’attention, à retrouver les noms. » (p. 225)
Avec le chapitre 8, on s’éloigne, définitivement, de la vie de famille car l’auteure nous emmène « en chemin et en voyage ». Sont ainsi évoqués rues et routes ainsi que les pèlerins qui les empruntent. L’intérêt du chapitre réside toutefois dans le fait qu’il évoque un guide rédigé au XIIIè siècle par un certain Maître Grégoire, sans doute un ecclésiastique anglais : sa « Narratio de mirabilibus Urbis Romae » présente la particularité de manifester à la fois l’admiration de l’auteur pour les œuvres de l’Antiquité, notamment pour le groupe équestre de Marc-Aurèle (qui a inspiré le fameux « Charlemagne à cheval »), sur lequel Chiara Frugoni s’étend sans doute trop longuement, et son « désintérêt presque total […] pour les édifices sacrés. » (p. 293)
Les deux derniers chapitres ne nous semblent pas refléter le titre que l’éditeur français a choisi puisqu’il n’y est guère question de la famille supposée structurer l’ouvrage. Or, l’original italien, publié en 2016, s’intitulait « Vivre au Moyen Âge », qui correspondait bien mieux au projet initial de l’auteure. Quoi qu’il en soit, mêlant vulgarisation d’excellente tenue et érudition pointilleuse, le livre de Chiara Frugoni s’avère, en dernière analyse, une bonne synthèse concernant certains aspects de la vie des femmes et des hommes des derniers siècles du Moyen Âge : l’auteure est particulièrement au fait des dernières recherches ; les œuvres picturales qu’elle analyse sont bien choisies, éclectiques et fort bien reproduites ; et l’on prend beaucoup de plaisir à sa lecture, grâce au talent de plume de l’auteure que sert magistralement la traduction de Jérôme Savereux. Une relecture plus attentive aurait cependant permis d’éliminer quelques fâcheuses coquilles, notamment une erreur de date concernant l’empereur Constantin Ier, à la page 308.