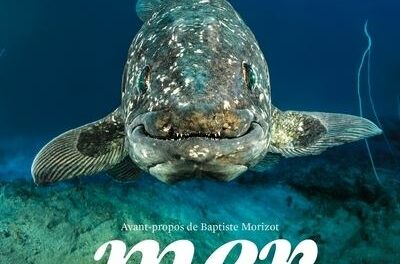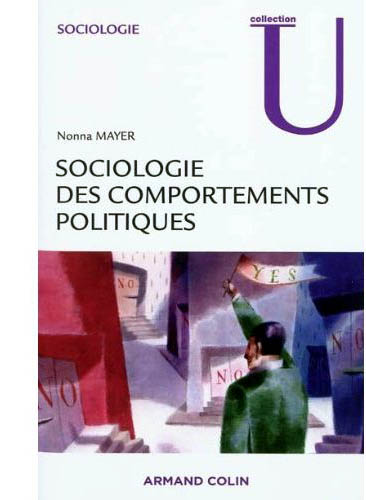
Trois aspects guident l’analyse des comportements : la place des comportements politiques en démocratie ; le moment central du vote comme acte de décision politique ; les pratiques qui autour du vote le prolongent ou le remplacent. Cette approche ne se nourrit pas d’une problématique spécifique, mais d’un fil conducteur sur la relation qui existe entre (re)présentation théorique de la démocratie et mise en pratique de la citoyenneté.
De la théorie à la pratique démocratique
La première partie est surtout une occasion de faire le point sur les conceptions de la démocratie en la mettant dans la perspective de la participation qu’elle suscite (c’est une conception maximaliste soutenue par les différents socialismes et les tenants du self-government jusqu’aux modèles de la démocratie participative et délibérative) ou qu’elle redoute et tente de contrôler (la conception minimaliste est défendue par des économistes qui depuis Schumpeter voient le peuple comme un mandant calculateur ou espèrent éviter le renversement paradoxal de la démocratie par trop de démocratie, c’est-à-dire trop de demandes contradictoires qui la rendrait ingouvernable). En présentant le cadre théorique de la compréhension de la participation politique, Nonna Mayer « borne » son sujet, montre comment en amont d’une réflexion sur les comportements politiques se structure tout un débat sur ce que serait la démocratie, comment s’organisent les droits qui donnent naissance à la participation. Cette partie offre l’intérêt de donner accès à l’objectif même de la sociologie politique : se déprendre des représentations de la démocratie fondée sur l’individu citoyen exigeant vis-à-vis de lui-même et de ses institutions pour comprendre comment la démocratie se pratique. La précision sociologique ne sert pas forcément à remettre en cause les intuitions des citoyens que nous sommes, mais à en percevoir le degré de pertinence et de réfutabilité ou à en comprendre le développement, et au final le poids dans nos perceptions.
L’ouvrage abandonne largement les perspectives historiques ou géographiques, ramenées ici au rang de variables explicatives. Pas d’histoire sociale du vote ou de géographie du vote, car ces écoles assez spécifiquement françaises et la « French Touch » (p. 51) analytique française ont avec leur « force explicative » le défaut d’évacuer de nombreuses dimensions des préférences individuelles au profit d’une lecture très collective du vote, les préférences électorales devenant le produit d’une histoire territorialisée qui détermine des clivages politiques. Dans une lecture hypothético-déductive de la sociologie politique, l’histoire et la géographie ne sont conviées ou ne s’invitent que lorsqu’elles suggèrent ou réfutent des hypothèses, voire montrent que la construction des hypothèses fait elle-même l’objet d’une sédimentation progressive. Par exemple l’histoire peut permettre de comprendre sur le long terme les « réalignements », c’est-à-dire les « changements durables des alignements électoraux » (p. 164, avec une erreur typographique sur le deuxième réalignement de 1893-1902), ou ponctuellement les enjeux qui structurent une consultation électorale, par exemple le chômage et l’immigration en 2002. Mais sur ce dernier problème du « vote sur enjeu », Nonna Mayer prend le contrepied de la satisfaction que pourraient ressentir les théoriciens de la démocratie : les enjeux sont eux-mêmes des construits politiques (pour ne pas écrire médiatiques) sur lesquels les citoyens se sentent plus ou moins sommés de développer une position et qui n’a de validité que très ciblée et contextuelle.
L’ouvrage est truffé de ces anecdotes de recherches qui montrent que la sociologie électorale n’est pas une science exacte et infaillible mais que la rigueur méthodologique permet d’anticiper les résultats électoraux. Il manque peut-être ici une réflexion sur la « cuisine » sondagière et les « corrections » apportées par les instituts de sondage, qui en fait de secrets industriels, tiennent à la « clairvoyance » de leurs politistes.
L’existence de variables lourdes déterminant le vote contribuent à un certain désenchantement du lecteur. Les premiers chapitres donnent en effet une image de l’acteur démocratique comme d’un agent – passif donc – qui dans une « boîte noire » institutionnelle produit la représentation qui permet de le gouverner. Les études notamment anglo-saxonnes égrenées par Nonna Mayer depuis les années 1960 insistent en effet toutes sur l’insertion des citoyens dans des tissus de normes et de relations sociales qui formatent son comportement électoral de telle sorte que seule une faible minorité (les plus diplômés, les plus autonomes) met en oeuvre de véritables choix politiques liés aux enjeux. En même temps, selon Berelson (cité p. 39), les plus impliqués sont également les moins susceptibles de changer, les plus rigides, donc les plus problématiques pour une démocratie ouverte fondée sur le débat et le compromis. Le dernier chapitre du livre est à ce titre intéressant puisqu’il porte sur le fait de « parler politique » et s’ouvre par l’idée simple et forte que la démocratie se caractérise par la possibilité qu’elle offre d’énoncer une parole (en) politique. Et si rapidement l’auteur décline un panorama des recherches et des enquêtes sur cette parole, elle nous rappelle que même les conversations se déroulent le plus souvent dans un cadre apaisé, celui du cercle familial (!) ou amical, qui permet d’éviter globalement le risque du conflit inhérent au débat public : serions-nous finalement de piètres démocrates ?
Voter est un défi
La deuxième partie prolonge cette question en regardant plus précisément sous le capot de la démocratie. Nonna Mayer entre dans la boîte noire du vote pour comprendre comment autour de lui se structurent toutes les représentations du monde politique, et du monde social au-delà. Cette partie est centrale dans l’ouvrage car le vote est évidemment déterminant. Si dans la première partie Nonna Mayer rappelle les tendances à la « directisation » croissante de la participation politique (par le référendum d’initiative populaire, la démocratie participative, les comités locaux…), le moment électoral est essentiel en ce qu’il est celui du choix, de la décision. Les autres formes de participation préparent ou prolongent mais ne remplacent pas ce qui demeure l’acte souverain du citoyen et le moment fort de la démocratie moderne.
Le moment électoral cristallise toutes les représentations et donc toutes les grilles de lecture du politique, et Nonna Mayer en fait un panorama exhaustif. Des modèles les plus individualisants (l’électeur rationnel ou le consumérisme électoral) aux plus collectifs (le vote de classe, la relation entre vote et religion), chacun est décrit, parfois avec un luxe de détails (l’indice d’Alford sur le vote ouvrier et sa remarquable formule p. 108 permettent de mesurer la distance qui sépare parfois l’homme de la rue du statisticien !) qui nous permettent de ne jamais nous contenter des idées reçues, d’en signaler les contradictions, par exemple dans les fausses évidences du clivage religieux – la causalité, voire la corrélation discutable entre modernité et sécularisation – ou les évolutions historiques du vote des femmes ou du « vote ethnique ».
Cette partie est la plus stimulante car des recherches émergent de nouvelles interrogations, et en tant que directrice de recherche au CNRS Nonna Mayer y est elle-même très sensible. Elle nous apporte les arguments pour formuler ces questions, nous fournit les éléments pour cultiver cette curiosité, notamment par une imposante bibliographie de vingt pages et quelques six cents titres qui rayonnent dans toutes les directions. Le pendant de cette approche riche est cependant une sorte de frustration : on aimerait savoir s’il existe un vote de classe, un vote ethnique ou un effet générationnel. Mais parce qu’elle est une chercheuse rigoureuse, Nonna Mayer se garde bien de fournir une réponse unilatérale ; à tout objet correspond une réponse nuancée par l’échelle ou le prisme adopté pour mener l’étude. C’est le lot d’une science dont l’honnêteté repose sur des paradigmes complémentaires sur le fond alors qu’ils semblent si opposés en surface… Finalement, holisme et individualisme méthodologique, approches quantitatives et qualitatives ne sont pas si antinomiques… La démonstration la plus dense est donnée sur la notion de clivage. Nonna Mayer présente les différents types de clivage (socio-économiques, culturels, politiques) puis retrace les différentes étapes de leur articulation qui est le terreau sur lequel l’élection va être organisée. Tout est alors abordé, de l’organisation d’une offre politique partisane au rôle des médias pour nous montrer qu’à chaque étape, le citoyen est tout à la fois agent et acteur du système démocratique. Ici ou là on apprend que les médias ont une influence largement surestimée sur l’opinion, bien moindre que celle des relations interpersonnelles ou des « leaders d’opinion » locaux (p. 153 et suiv.), que les sondages renforcent les votes stratégiques (des électeurs peuvent reporter leur vote sur un candidat qui semble avoir plus de chances de l’emporter), mais ne modifient pas les représentations des électeurs sur les candidats (il n’y a pas de « contagion » p. 168) ou que « à la veille du premier tour, l’écart en faveur de Sarkozy sur la capacité de chef d’Etat atteint 25 points, contre 5 au début de la campagne » (p. 162). Ces exemples confirment une autonomisation croissante des citoyens qui explique qu’ils ne se contentent pas de la routinisation politique qu’est le moment électoral.
Le citoyen à la recherche de sens
La troisième partie a cela d’intéressant qu’elle nous permet d’appréhender d’autres comportements qui redoublent le vote et permettent de faire vivre le rapport à la politique des individus hors des échéances électorales. Les formes les plus classiques sont abordées : militantisme au sein d’organisations politiques ou syndicales, mobilisations dans le cadre de grèves ou manifestations. Il existe bien d’autres formes de participations qui font l’objet de travaux, parfois sur des thèmes originaux, explorés avec un bonheur inégal par la collection « Contester » dirigée par Nonna Mayer aux Presses de Science Po. Mais l’intérêt est ici de les mettre en relation avec la pratique du vote. L’abstention ou les votes blanc ou nul acquièrent – enfin – dans ce manuel une place sérieuse et croissante comme « formes actives et assumées de refus de vote » (p. 173).
Nonna Mayer en retrace les différentes étapes pour montrer que le processus qui conduit à voter ou à s’abstenir ne va pas de soi. Il est le fruit de la trajectoire sociale et politique des individus, et singulièrement de leur intégration sociale : les femmes s’abstiennent plus que les hommes, les jeunes plus que les vieux, les urbains plus que les ruraux, les non-diplômés plus que les diplômés (en corrélation finalement avec les critères qui font le « bon » citoyen démocratique, fondant l’hypothèse d’un « cens caché » dans le système démocratique). Le critère ethnique laisse encore songeur car si en France (et en 2004), « les personnes d’origine maghrébine et surtout antillaise s’inscrivent moins et s’abstiennent plus que la population française de naissance ou issue d’une immigration européenne » (p. 185), comment positionner l’enfant français de ces immigrés ? Il devient difficile d’y voir un marqueur ethnique plus que social (et territorial, donc en relation avec la question de l’intégration évoquée plus haut). En fait, l’abstention tient également au sentiment de l’utilité de la participation pour l’électeur, pas seulement en vertu d’une rationalité en finalité (je vote parce que j’en retire un bénéfice) mais également en valeur (je vote parce que c’est importante de participer ou dans l’estime de moi que j’acquiers par l’acte civique).
L’abstention a de surcroît un « coût » social à la mesure de la valorisation de l’acte de voter, et le choix qui conduit à ne pas voter devient alors le fait d’individus qu’on envisagerait plutôt comme des votants : politisés, diplômés… La posture de retrait électoral est l’un des symptômes d’une crise de la démocratie dont l’issue passe peut-être par le rajeunissement du corps électoral : Nonna Mayer souligne les travaux de Mark Franklin qui voit dans l’abaissement de la majorité électoral un moyen d’agréger les jeunes au corps électoral car le lycée serait un cadre propice à cet apprentissage « en acte », alors que les plus de 18 ans ont déjà basculé dans l’anonymat de la société.
L’insatisfaction face à l’offre politique est l’écueil majeur auquel se heurtent les démocraties modernes et qui conduit vers d’autres formes de participation et d’action. Les « mouvements sociaux » sont essentiels entre et en marge des élections, mais Nonna Mayer ne propose pas le descriptif par le menu des répertoires d’action à la disposition des citoyens (grève, manifestation, sit-in, actions violentes, etc) qui font l’objet d’une abondante littérature. De manière plus heuristique, elle questionne la nature même des comportements collectifs en ce qu’ils sont l’inverse de l’acte de vote, le plus souvent perçus comme les moments éruptifs de contestation d’un contrôle social qui s’est momentanément interrompu (et donc les rend possible). La frustration du groupe social l’emporte alors sur l’individu démocratique, la classe consciente d’elle-même devenant ainsi le moteur de l’histoire que l’individu ne peut plus être. Cette posture conduit à l’inverse à la position de Francis Fukuyama qui voit dans la démocratie apaisée post-Guerre froide le symptôme d’une « fin de l’histoire » par le passage de la conflictualité idéologique dont l’URSS aurait été porteuse à la régulation démocratique apaisée. Les « nouveaux mouvements sociaux » qui le contredisent, analysés par Alain Touraine ou Jürgen Habermas, sont une sorte de prolongement postindustriel de la conflictualité qui met les acteurs de la société civile avec leurs perceptions, leurs croyances et leurs affects aux prises avec le capitalisme et l’Etat. Du côté du pragmatisme américain, la mobilisation collective est affaire d’intérêts individuels (Mancur Olson et son célèbre « ticket gratuit » le démontrent) pilotées par des organisations qui leur donnent sens par un répertoire d’actions disponibles et de fenêtres d’opportunités conjoncturelles ouvertes.
Ces grilles convergent finalement vers une analyse de la protestation qui s’appuie sur des sociétés développées globalement plus instruites, à la recherche d’une participation accrue et dans lesquelles l’action directe n’est jamais que la continuation de la politique par d’autres moyens. En France par exemple, la grève ou la manifestation comme moyens d’action sont de plus en plus légitimes auprès d’une large majorité de Français ; beaucoup moins l’occupation de locaux, le refus de payer des impôts ou la dégradation des biens qui est en nette décrue (p. 225), loin donc des représentations qu’en donnent parfois les médias. La manifestation étant ainsi devenue dans l’opinion légitime et normale comme moyen d’action, les manifestations sont de plus en plus nombreuses tout en rassemblant de moins en moins de monde (et subissant ainsi très souvent le filtre des médias). Là encore les études sont mobilisées pour nous montrer que les plus jeunes et les plus instruits à gauche ont le « potentiel protestataire » le plus fort, que le militantisme partisan (comme syndical) obéit plus ou moins aux mêmes schémas de mobilisation associant croyance, socialisation et intérêt (dans la rétribution matérielle et/ou symbolique), alternant engagement et désengagement, que son déclin repose sur la baisse de l’identification partisane. Mais là encore, à chaque pays sa propre histoire partisane. Par ailleurs, le militantisme se manifeste par « l’essor associatif » et se caractérise par une individualisation croissante et une souplesse dans l’engagement qui se fait souvent au détriment de l’adhésion (au propre comme au figuré).
Les citoyens s’autonomisent ainsi de la politique « conventionnelle », au point de confronter par exemple en 1997 « gauche officielle » et « gauche réelle », toujours sur le mode de la contestation des représentants – on retrouve ainsi le fil conducteur du livre : le hiatus entre théorie démocratique et pratique citoyenne. La tendance est également à la globalisation des discours et des enjeux, mais les auteurs convoqués par Nonna Mayer nous rappellent opportunément que les actions concrètes ont minoritairement une dimension globalisées, et demeurent à plus de 80 % des « protestations intérieures » (p. 254) ou « internalisant » des enjeux européens, avec finalement plutôt une forme d’euroscepticisme et de repli national. Cette ouverture vers d’autres échelles explique une conclusion qui n’en est pas vraiment une, mais plutôt une mise en perspective par le passage à l’échelle européenne, parce que c’est une dimension qui commence à être sérieusement défrichée et qui nous montre que la France a des caractéristiques, mais que cela ne fait pas d’elle une exception.