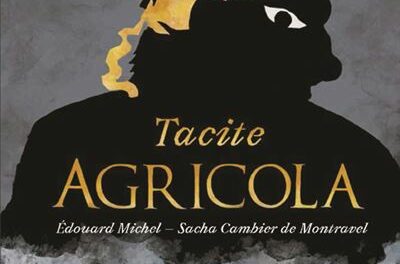Avec Soleil Brûlant en Algérie, adapté du récit autobiographique d’Alexandre Tikhomirov, appelé de 21 ans en 1956, Gaëtan Nocq nous plonge au cœur de la seconde guerre de décolonisation française (1954-1962), qualifiée longtemps d’«événements» pour ne pas troubler le moral public et laisser penser que la domination française était belle et bien mise en question.

La guerre d’Algérie du point de vue d’un appelé du contingent
Ce déni de la réalité transparaît au long d’une histoire où l’on suit des hommes moins soldats que jeunes gars encore fragiles, auxquels on donne à découvrir le Monde sous son aspect le plus déplorable : celui de la guerre. Les seuls qui semblent en guerre, ici, sont d’ailleurs, d’une part, les officiers qui veulent faire carrière ou les sous-officiers qui en rêvent, et d’autre part, les paras et autres commandos qui s’illustrent par leur brutalité joviale et leur épanouissement guerrier.
Des combats, d’ailleurs, on n’en voit pas ou si peu, plutôt les vestiges d’affrontements qui sont matérialisés par les blessés qu’on ramène sur des brancards et les tombes qu’on creuse occasionnellement, mais en nombre, quand une embuscade porte sur quelque unité isolée. De l’ennemi, les fellaghas, on entend seulement parler mais ne les voit jamais, c’est frappant, et finalement assez attendu, dans cette guerre d’un nouveau genre, où coups de main et embuscades prennent de court, au début, des combattants gardant en tête l’exemple de la Seconde Guerre Mondiale.
Mais pas que : on en entend certains parler de l’autre guerre, celle d’Indochine, qui a quelque chose de comparable : ennemi invisible ou fondu dans la population, vaine occupation militaire du terrain et montée en puissance des renseignements. Une scène de mess des officiers nous montre ceux-ci aborder le sujet des nouvelles méthodes de guerre, passant en particulier par le renseignement : « connaître son ennemi pour le surprendre mais aussi le manipuler ». Est-ce à cette époque, dans un combat dissymétrique entre une puissance militaire et des réseaux rebelles, que sont nées ces fameuses « guerres d’un genre nouveau », frappant aujourd’hui de plus en plus fort le cœur de nos sociétés qu’on pensait sanctuarisées ?
La vie militaire d’un appelé du contingent
On voit en tout cas l’armée française s’investir franchement dans ces nouvelles tactiques, et si l’usage de la torture est peu relatée, elle est suggérée à plusieurs reprises par la rugosité de certains chefs, la brutalité de certains caractères et la nervosité diffuse mais croissante qui se dessine au fil de l’histoire, envahit progressivement le moral de tout un chacun. Pour autant, tout le monde ne devient pas bourreau, au contraire, les simples soldats, les secondes classes, à l’image du héros, sont bien souvent brinquebalés par les événements et les ordres contradictoires, n’attendant qu’une seule chose, le rapatriement à la «maison».
Cette guerre, pour les appelés «de l’arrière » comme le héros — qui a la chance relative d’être en garnison à Cherchel, sur un littoral épargné par les combats, contrairement aux Aurès dont on parle, au cours du récit, comme d’un « front de l’est » algérien — ne ressemble pas non plus à l’image de cruauté que les récentes actualisations historiographiques ont généré dans l’inconscient collectif. Pendant longtemps, c’est la formation — sommaire et parfois absurde — à la caserne, puis les patrouilles, les sempiternelles et interminables patrouilles. Autre genre de torture, sans doute moins physique mais qui ne laisse pas de bons souvenirs, voire des cauchemars répétitifs. Car on vit dans la peur de l’embuscade, moins réelle que fruit des légendes qu’on se raconte le soir à la veillée ou qu’on assène aux bleus pour rigoler ou les édifier.
Et puis une porte de sortie : notre héros parvient à devenir serveur au mess des officiers et fréquentent dès lors un « monde qui n’est pas le sien», assez choquant d’ailleurs, où l’on voit des gens faire ripaille de bons vins et bonnes chères en parlant doctement, avec suffisance ou même mépris de la vie du troufion qu’ils envoient au front ou le plus souvent en patrouille quand la nécessité mais le plus souvent le caprice les en prend. Ainsi ce colonel, qui avait « chaque jour une idée » : pourquoi ne pas faire les patrouilles de jour avec des lunettes de soudeur pour s’entraîner aux patrouilles de nuit, tiens !…
Comment sortir de la guerre pour un appelé du contingent ?
La dernière partie de l’ouvrage se passe à Paris, raconte la fin de la guerre du point de vue du soldat passé du côté des pacifistes et qui se coltinent avec les terroristes de l’OAS et la police réprimant, en ces temps d’état d’urgence, avec une grande brutalité. Il en coûtera à notre héros un disque de la colonne vertébrale abîmée et les deux pieds cassés… On oublie trop souvent que dans cette guerre coloniale, il y eut de par et d’autre deux guerres civiles algéro-algérienne et franco-française. En forme d’épilogue, on voit le héros revenir en Algérie une ou deux décennies plus tard, avec femme et enfants, pour panser les plaies de ses souvenirs. Mais, dit-il, il ne reconnaît rien – un effet de la désinformation jusqu’à l’absurde que pratiquèrent les pouvoirs de chaque camp ? En tout cas, ces blessures ne se refermèrent jamais complètement puisque, tout en racontant à Gaetan Nocq ses souvenirs, il disait lui en vouloir de le replonger dans une époque qu’il avait voulu oublier en écrivant son autobiographie.
Adaptation remarquablement construite, qui donne envie de lire l’histoire originale, non seulement pour son intérêt mais aussi pour comprendre comment le dessinateur a sélectionné, découpé, représenté les épisodes de l’histoire. Peu de mots, beaucoup de dessins, des répliques choisis finement, qui disent tout en quelques phrases. Une narration presque filmique qui plonge non seulement l’esprit mais les yeux et le corps dans l’Algérie d’il y a un demi-siècle. C’était l’objectif, donner à vivre un témoignage individuel, qui on le sait ne peut faire toute l’histoire mais contribue à lui donner chair et donc compréhension. Un complément indispensable au difficile et complexe travail historiographique en cours sur le sujet.