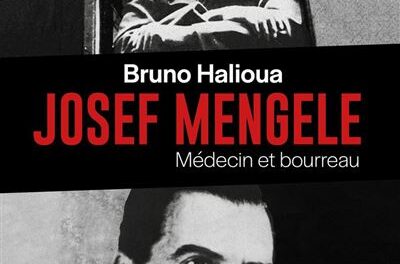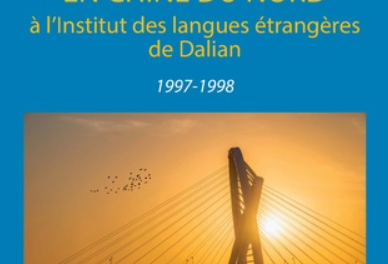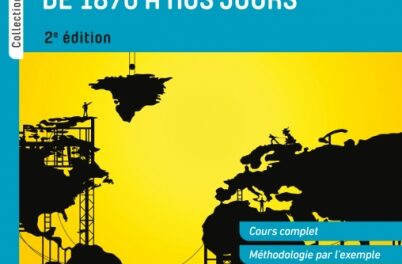La structure de l’ouvrage est fondé sur une double chronologie. La première raconte en détail les trois jours de mars 1953 durant lesquels Staline passe de la vie à la mort dans sa datcha des environs de Moscou. Occasion de décrire l’ambiance malsaine, kafkaïenne et paranoïaque qui régnait à la fin du règne Stalinien. La seconde chronologie est plus conventionnelle, on suit Staline avant la révolution, pendant la révolution, avec Lénine, sans Lénine, seul au pouvoir, pendant la Guerre Patriotique et après la guerre patriotique. Autant dire que si Staline est le sujet principal de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’on a devant nous une bonne tranche d’histoire russe, vue sur ses aspects sociaux, économiques et politiques. De nombreuses pages s’attachent à décrire la vie hallucinante et démentielle des Soviétiques et des Russes au quotidien. Un monde de souffrance, de privations, de méfiance, de mort, de délation, une dépendance totale envers l’état et peu de répit. Quand les choses vont bien, ou relativement bien, on dirait que Staline ne le supporte pas, et qu’il va tout faire pour mettre les citoyens sur le fil. Comme avec ses propres collaborateurs, Staline n’aime pas qu’on soit à l’aise, qu’on se sente léger. C’est un homme qui aime plus que tout faire pression sur son entourage et sur son peuple.
« Fabriquer des preuves ». Ce sont sans doute les mots les plus utilisés dans ces 600 pages. Staline n’aime pas la réalité. Elle s’apparente à de la désinformation. En conséquence, il plie la réalité à sa propre réalité, en faisant en sorte que les choses aillent en son sens. De 1928 à 1953 la fabrication de preuves est une manie. Parfois même certains préviennent Staline que ces preuves ne sont pas très bien fabriquées, qu’on voit vraiment qu’elles sont fausses. Staline épuise ainsi son monde. Ses citoyens et ses anciens amis, anciens camarades de combat, ou les nouveaux promus. Les seuls a pouvoir lui faire de l’ombre sans le payer de leur vie seront Molotov et Joukov. Les autres soit meurent, soit travaillent seuls, en évitant les pièges et les chausse-trappes, en étant discrets, disponibles et obséquieux. Les deux fois où la réalité rattrape Staline, il le vit très mal. La première est lors de l’invasion de l’URSS par le Reich allemand. Il fuit, déprime, se mure dans sa datcha jusqu’à ce que Molotov, Beria, Malenkov et Vorochilov viennent le chercher et, en quelque sorte, le sauvent. La seconde fois, c’est lors de sa mort. Son regard lancé aux gens autour de son chevet semble empli de haine et de fureur, comme s’il trouvait insupportable de mourir sans l’avoir lui même ordonné. La Guerre patriotique sera, passé l’année 1942, le moment ou Staline sera sans doute le plus à l’aise, le plus en confiance avec les autres, et cela jusqu’en 1946 où les théories de cinquième colonne reviennent aux galop, et qu’il s’attaque à Molotov et Joukov qui avaient pris trop d’ascendant à son goût pendant cette période. Toutefois, ni Molotov ni Joukov ne subissent le sort de Zinoviev, de Kameniev ou de Trotski.
Le bilan de la période Stalinienne est accablant. En vies humaines, en incohérences économiques, et performances sociales : le régime est très inégalitaire. Il est difficile de trouver dans l’ouvrage d’Oleg Khlevniuk le moindre signe positif, mis à part la victoire majeure sur le nazisme. La mort de Staline apporte un immense sentiment de soulagement chez les membres de la nomenklatura et chez les citoyens, même si la popularité de Staline reste forte en 1953. Mais la rapidité avec laquelle son héritage le plus délirant est abrogé, parfois même alors qu’il est encore en vie dans sa datcha proche de Moscou, montre qu’un immense poids se lève. Cela ne dédouane pas pour autant les dirigeants soviétiques de l’après-stalinisme, mais laisse percevoir chez une une part d’humanité qui restait difficile à trouver chez Staline.
Mathieu Souyris, lycée Paul Sabatier, Carcassonne.