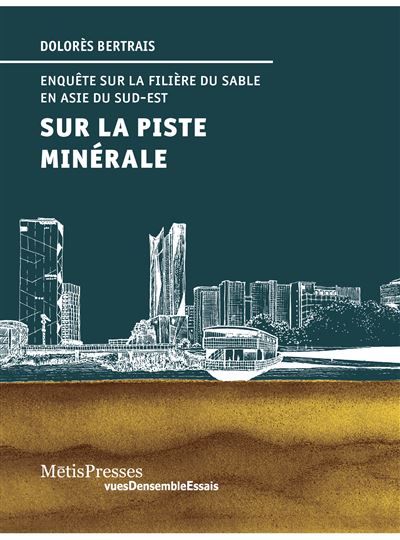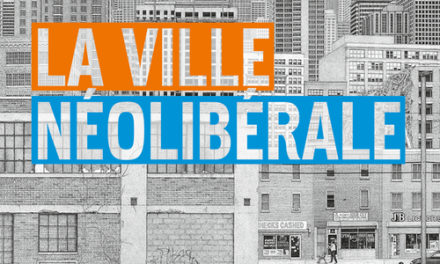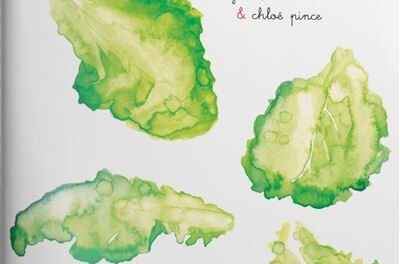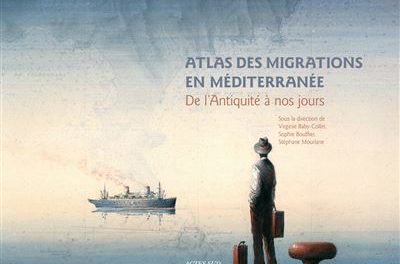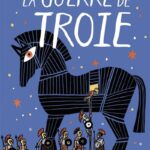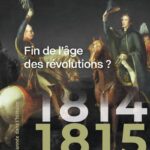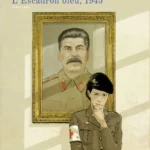Avec une population urbaine en hausse, les besoins de construction tant dans le domaine de l’immobilier que de celui des réseaux de transport sont importants au Cambodge. Le sable apparait donc un indispensable recours dans la fabrication du béton et c’est sur ses usages que Dolorès Bertrais, paysagiste-urbaniste et post-doctorante à l’Université de Genève, nous interpelle dans cet ouvrage à la présentation originale.
Si le sable bénéficie d’une image très positive dans les mentalités, il n’en est pas moins passé de « matériau » à « ressource » en très peu de temps et, dans notre contexte de logique extractive, à une ressource devenue déjà rare. Ainsi, il fait l’objet de mille convoitises et est entouré d’un grand paradoxe : il faut se taire au maximum à son sujet alors qu’il est pourtant visible aux yeux de tous.
Après avoir défini le sable avec des critères de couleur, de granulométrie, de valeur, le propos prend la forme du parcours d’un grain de sable autour de deux itinéraires distincts, celui qui reste dans son lit et celui qui en sera sorti par extraction.
Le texte fait dialoguer la géologie et les études urbaines dans le cadre d’une enquête démarrée en 2017 dans les environs de Phnom Penh avec le concours d’une résidente locale ici nommée « Sopheap ». Des dépôts de sable ont été investigués mais 6 sur 25 ont catégoriquement refusé d’ouvrir leurs portes à l’enquêtrice. Ont été interrogés des conducteurs de camions, des développeurs immobiliers, des décideurs politiques, des ONG…
L’impact physique de l’extraction massive joue sur la stabilité des berges ainsi que sur le débit du fleuve, sa biodiversité, sa salinité (qui augmente et qui impacte les cultures voisines).
Après cette contextualisation assez classique, le développement du livre change ensuite de présentation et voit arriver une succession de planches dessinées des plus explicites.
On y apprend que le sable est la seconde ressource la plus consommée après l’eau, notamment dans la conception du béton. On saisit son cheminement via une décomposition des étapes avec des cadrages différents (en amont ou en aval du fleuve) et des chronologies complémentaires mais également des témoignages de propriétaires de dépôt. Tout cela permet la mise en perspective et la comparaison jusqu’à l’aboutissement d’un document de synthèse systémique.
On comprend que les conditions de travail sont très difficiles dans cette filière qui pourtant n’en finit pas d’embaucher. Pas mal de non-dits demeurent avec notamment des taxes fixées par le gouvernement mais que certains arrivent à contourner.
Non sans humour (« faire parler un grain de sable, jusqu’où ira l’anthropomorphisme ? Ahh, c’était mieux avant, quand les chercheurs n’essayaient pas de vulgariser leurs recherches ! » p 56), l’auteure réussit justement ce pari d’allier rigueur du texte et clarté des images pour arriver à une démonstration limpide. Plus encore, le renvoi aux planches illustrées après coup autorise une double lecture : bien spécifique si l’on y retourne ou de portée plus générale dans le cas contraire. Les carnets de terrain ajoutent également à la plus-value de l’ouvrage pour l’affiner encore davantage.
Au final, on se demande pourquoi ne pas avoir eu cette si bonne idée avant ? Vraiment un sacré avantage pour cette recherche qui contribue à la visibilité des thématiques sur le minéral encore en-dessous de celles sur l’animal ou le végétal.