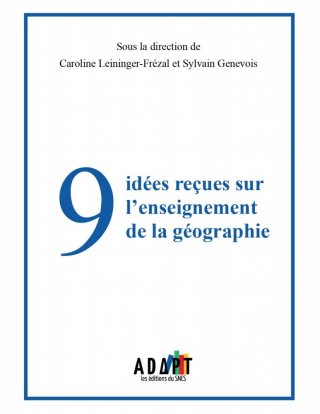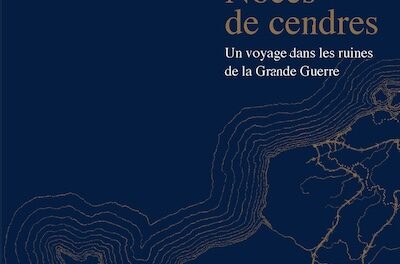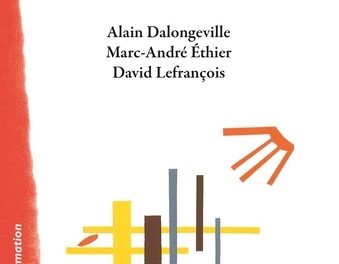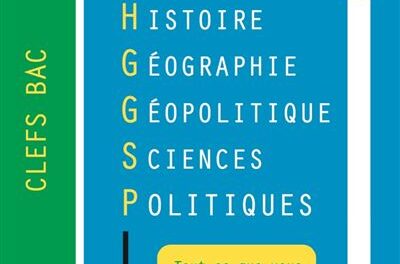A destination des enseignants du secondaire et de leurs formateurs, cet ouvrage réunit une équipe composite de didacticiens de la géographie confirmés ou en cours de doctorat. Il entend justement diffuser autour de ces neuf questions fréquemment rencontrées, les résultats des travaux les plus récents en la matière souvent cloisonnés à cette sphère de chercheurs.
L’élève n’est pas une page blanche » (Patricia Grondin, Aurore Lecomte et Cédric Naudet)
Ce premier chapitre montre que l’élève a déjà des savoirs. Qu’ils soient vernaculaires, des représentations ou issus d’expériences spatiales quotidiennes, ces savoirs peuvent constituer une béquille ou au contraire un obstacle à dépasser. Il est nécessaire de les croiser et de contextualiser pour passer d’une géographie spontanée à une géographie raisonnée. Il faut trouver la bonne « distance » pour ne pas être dans un contexte ni trop familier, ni trop inaccessible. Les codes scolaires (exemple du coloriage cartographique mis en lumière par Stéphane Bonnery) ou le jugement qui peut entrer en conflit avec le savoir scientifique et freiner les apprentissages sont à surveiller. Tout l’art est de trouver le bon dispositif didactique pour générer une visée émancipatrice et critique.
La géographie scolaire n’est pas une géographie savante simplifiée » (Corentin Babin et Caroline Leininger-Frézal)
Ce second chapitre pose, entre autres, le problème de la signification que l’on donne au terme didactique dans les maquettes des concours enseignants, une didactique vue comme une sorte d’application pratique des notions scientifiques associées. Le texte revient sur la complexité de la définition de la transposition didactique et sur l’idée que les enseignants n’ont pas vraiment d’impact sur les contenus prescrits. Les savoirs scolaires se renouvellent moins vite que les savoirs scientifiques qui, eux, sont débattus régulièrement. D’autres cadres existent comme la demande sociale (exemple du développement durable) et l’autonomie propre, l’autoréférencement : ainsi on peut parler d’une créativité épistémologique de la géographie scolaire mais qui peut s’avérer problématique si l’on croise des thèmes et des espaces pour lesquels il n’y a que peu de ressources pour guider les enseignants. Avec les questions socialement vives et les « éducations à », nous avons là une discipline vraiment recomposée.
« Faire de la géographie se réduirait à apprendre des lieux » (Julie Maurice et Caroline Leininger-Frézal)
La géographie l’a été par le passé (à des fins militaires), le récit géographique du pays mettait en scène les « vainqueurs ». Nous sommes passés d’activités de basse tension intellectuelle à des situations autorisant la problématisation mais il y a des réminiscences de ces visions simplistes (épreuves scolaires, le brevet notamment). Pourtant, l’habiter, le raisonnement géographique, les acteurs, la prospective, la géographicité permettent de convoquer des situations didactiques différentes comme le théâtre, les jeux de rôle, les visites virtuelles ou, comme ici de manière détaillée, la bande dessinée.
« La géographie n’est pas la petite sœur de l’histoire » (Corentin Babin, Karine Ferol et Caroline Leininger-Frézal)
La géographie a un rôle de formation du citoyen aussi important que l’histoire. Ce couple ancien qui subsiste dans le second degré est une spécificité française. La vision policée d’une discipline réaliste sans enjeu politique est dépassée et on invite désormais à voir le monde davantage comme un « construit » que comme un « donné ». Cela pénètre malgré tout très peu la sphère scolaire. Pourtant l’épistémologie propre, certaines démarches, certains objets doivent autoriser des finalités davantage tournées vers la pensée critique qu’envers la simple obéissance civique. La géohistoire est une reconfiguration majeure dans l’équilibre de ces deux disciplines. Pour qui, comme moi, n’est pas familier de l’univers des agrégations, on notera un passage anecdotique mais certainement révélateur sur les tenues vestimentaires des enseignants de géographie davantage « autorisés » à être décontractés par rapport à celles et à ceux d’histoire.
« La géographie n’est pas un outil de promotion du territoire national » (Karine Ferol, Aurore Lecomte et Caroline Leininger-Frézal)
Le discours scolaire est partiel : l’Etat est l’acteur dominant, les territoires les plus compétitifs sont les plus exposés. Le récit géographie n’est pas présent, il n’est pas naturel. La géographie classique a voulu affirmer sa scientificité et donc s’est tournée vers ce style d’écriture et non pas vers le style du récit. Mais le tournant spatial a amené la subjectivité, la controverse. Et il apparait plus aisé de faire un récit historique (chronologique) que géographique (comment l’organiser ?). L’ancrage du récit dans des manuels stéréotypés aux clichés issus de banques de données commues n’est pas pour aider : il n’y a pas de narrateur, pas d’acteurs, pas d’intentionnalités et donc pas vraiment d’autres chemins de pensées. Les paysages de carte postale dominent pour le tourisme, un ailleurs fantasmé, une absence de complexité de l’analyse. On note une opposition binaire Nord/Sud très limitative et une absence du milieu biophysique transféré aux SVT, les marges sont absentes, les acteurs ne sont vus que comme des agents. Il y a tout intérêt à proposer un « contre-récit ».
« Le document n’a pas seulement une valeur illustrative en géographie » (Benoit Bunnik, Karine Ferol et Sylvain Genevois)
Le document n’est pas unique, il en existe une grande variété. Le document n’est pas au cœur des réflexions scientifiques (cette entrée est absente des dictionnaires). Sur la terminologie, il faut entendre que la ressource est plus englobante que le document. Il y a une chaine de transformation du « brut » à « l’opérationnel ». Son rôle est d’illustrer (trop souvent) et de susciter le regard critique (pas assez). Les documents n’ont pas tous le même degré de difficulté intrinsèque. Réfléchir sur la source est vital, le document n’est pas neutre. Pour quelle activité et pour quelle pédagogie peut-il être pensé ? Ouvrir à l’autonomie des élèves nécessite que ceux-ci soient formés à la lecture de documents. Il y a une réflexion à avoir sur l’ordre et l’importance d’un document dans un corpus composite. Le document peut être crée par les élèves (à échelle locale, la sortie et ce qu’on pourra en ramener constitue un document). Produire des cartes, des brochures touristiques appuie la compétence « raisonner, justifier une démarche scientifique ».
« Traiter et analyser des données numériques en géographie, c’est possible mais cela s’apprend » (Sylvain Genevois et Patricia Grondin)
La donnée n’est pas si brute que ça. L’utilisateur, par le jeu de ses choix, la transforme en information pour répondre à un questionnement géographique. Ensuite, on passe à la connaissance. Saisir l’utilité réelle des donner, savoir pourquoi on les collecte est important. La suroffre de documents durant la pandémie de COVID-19 a noyé les lecteurs. La formule suivante est très parlante : voir n’est pas lire et lire n’est pas apprendre. Le chapitre comprend un intéressant tableau de propositions de progressivité de maîtrise de géocompétences. L’éducation aux données, plus spécifiquement vue sous l’angle de la géographie citoyenne, doit être de mise notamment dans un contexte actuel de partage de l’information (open data). L’information géographique est modelée par les représentations des individus au travers de ce qu’ils collectent et partagent. Certaines thématiques, de par l’intérêt « naturel » qu’ils peuvent avoir envers des enseignants et des élèves, peuvent se prêter à ces analyses comme la question des territoires scolaires.
« La géographie scolaire n’est pas une discipline fermée, elle est nécessairement ouverte au(x) Monde(s) » (Aurore Lecomte et Cedric Naudet)
Le changement de paradigme de la géographie enseignée s’accompagne d’un changement de posture de l’enseignant : celui-ci aide à construire les savoirs davantage qu’à simplement les exposer. La politique est forcément présente. Dans les programmes déjà avec des thématiques comme l’aménagement du territoire ou les choix de mobilité. Mais les enseignants ont peur de « mettre le feu aux poudres » avec certains sujets. Ce chapitre compte un très bon tableau des différentes postures enseignantes en fonction des valeurs portées, des démarches en classe, du rôle de l’élève et du degré d’ouverture de l’école au monde extérieur. Ainsi il peut y avoir tout intérêt à développer la didactique des questions socialement vives et viser un nécessaire émancipation de l’élève.
« On ne zoome pas en géographie, on utilise les échelles » (Benoit Bunnik et Sylvain Genevois)
Ce dernier chapitre revient sur la différence entre l’échelle cartographique (le taux de réduction employé) et l’échelle géographique (le niveau d’analyse). En zoomant sur un globe virtuel, on change l’échelle cartographique mais l’échelle géographique ne varie pas. Ce zoom numérique perturbe d’ailleurs la perception des distances, il invisibilise les flux, les temporalités ou encore le relief. Le vocable « d’emboitement d’échelles » fonctionne plutôt bien pour des logiques aménageuses avec des échelles de décisions. Pour le reste, c’est bien plus subtil et il y a souvent du transscalaire (phénomènes climatiques, circulation de virus, migrations lointaines…), d’où le regard comparatif sur plusieurs échelles. La clôture de ce chapitre nous invite à réfléchir sur les écarts visibles dans les programmes : primauté du local dans le premier degré, études de cas dans le second degré. N’y-a-t-il pas un meilleur équilibre à rechercher ?
Conclusion
L’ouvrage remplit sa mission de largement parcourir les thématiques liées à un enseignement de la géographie renouvelé et dynamique en prise avec la riche réflexion scientifique sur la géographie comme science de l’organisation spatiale des sociétés humaines et le rôle émancipateur que la discipline doit tenir dans la construction du citoyen.
Sur le plan formel, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de relecture entre les auteurs étant donné que des chapitres renvoient régulièrement à d’autres mais il y a un problème avec les bibliographies : des références sont mal agencées alphabétiquement mais surtout, il manque énormément de références appelées dans les textes et qui ne sont pas reprises en bibliographie (notamment un chapitre dont aucune des références ne corresponde à la bibliographie finale) : un erratum en ligne pourrait-il être envisagé ? Ce n’est pas tant pour pinailler que justement pour creuser plus avant les passionnantes références convoquées. Un glossaire aurait été un plus également.
Ces réserves formelles mises à part, nous avons là une belle réflexion sur l’enseignement de la discipline avec un choix éditorial d’un partenaire proche des enseignants qui, espérons-le, aidera à sa diffusion. A quand une réflexion complémentaire plus ciblée sur le premier degré ?
En complément, on pourra visionner l’interview de Caroline Leininger-Frézal qui présente l’ouvrage.