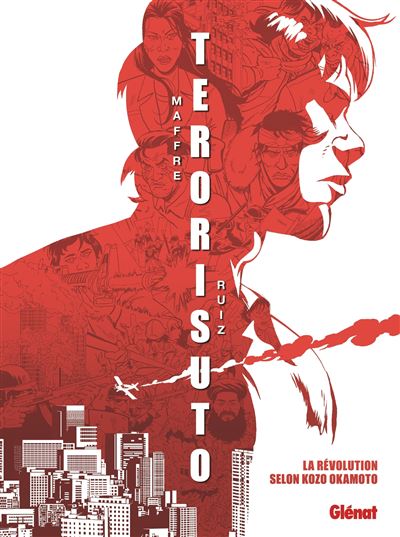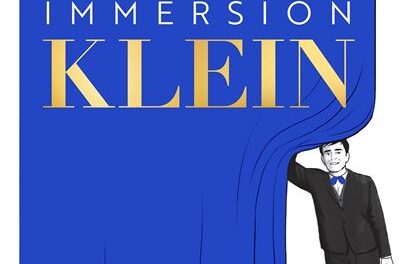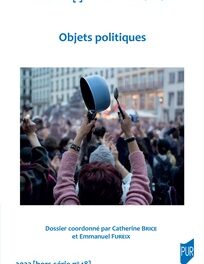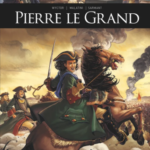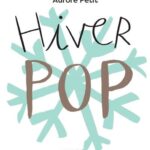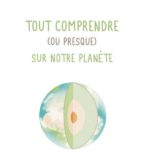Les mouvements issus de « Mai 1968 » en Europe et la forte politisation d’une partie de la jeunesse étudiante, s’emparant de différentes doctrines politiques issues du marxisme et de l’anarchisme, ont été largement étudiés par les historiens. Les « années de plomb » en Italie, avec les Brigades rouges ou Prima Linea, la mouvance autonome italienne ou la Fraction Armée Rouge en Allemagne et leurs usages de la violence ont également été le sujet de films, de pièces de théâtre ou de bandes dessinées. Par exemple, le groupe Action Directe en France a inspiré une bande dessinée récente très réussie : l’Escamoteur de Philippe Collin et Sébastien Goethals. Souvent, dans les œuvres de fiction notamment, l’attention va être concentrée sur certains aspects comme la lutte armée contre l’État, ou des groupes d’extrême droite ; ainsi que sur les minorités de militants qui vont s’engager dans une démarche terroriste et vers des attentats. Toutefois, si ces expériences politiques sont très documentées pour les pays européens, elles sont quasiment ignorées lorsqu’il s’agit du Japon, à l’exception peut-être du documentaire de Koji Wakamatsu, « United Red Army » sorti en 2008.
Par son existence même, cette bande dessinée suscite l’envie d’en savoir plus sur l’extrême gauche japonaise, bien sûr dans une démarche comparative avec d’autres mouvements révolutionnaires de par le monde. Néanmoins, plusieurs travers guettent ces récits concernant l’usage, le recours à la violence et à des actions terroristes : une description morale à charge (qui ne permet pas d’interprétations et d’avoir une démarche explicative), une attention à la partie « spectaculaire » et donc à une sorte d’exaltation de la violence (qui est un danger encore plus important dans un projet artistique (bande dessinée, films…) puisque les ressorts de la dramaturgie vont reposer sur ces violences). Enfin, une démarche téléologique, non dépourvue d’a priori idéologiques, va guider la présentation des trajectoires de ces acteurs comme une sorte de fuite en avant inéluctable. Une radicalisation d’une partie de l’extrême gauche, qui « s’engage » dans la lutte armée, qui inexorablement va échouer à gagner la sympathie de la population et donc « doit » s’enferrer dans une surenchère de violences ; pour aboutir à un terrorisme quasi absurde tant les buts recherchés ont été oubliés en cours de route.
Le scénario, dès les premières pages, captive le lecteur, et l’entraîne avec lui malgré des personnages inconnus pour des lecteurs européens et une myriade d’informations sur ces groupes politiques, ainsi que la situation politique au Japon et au niveau international. Des trouvailles scénaristiques nous laissent plutôt dubitatif, comme cet « intermède sentimental » concernant le frère du narrateur Takeshi Okamoto, qui après un détournement d’avion, rejoint la Corée du Nord. Le choix du narrateur Kozo Okamoto est également intrigant. En effet, il permet d’avoir pour le scénariste un rôle « d’observateur embarqué » auprès des acteurs de premier plan, mais en participant tout de même à l’attentat de l’aéroport de Lod (Tel-Aviv). Il installe alors une voix-off, qui commente, explique les évènements et détaille les ellipses dans le récit. Parfois, celui-ci s’emballe et cette voix-off s’excuse : « J’ai voulu aller trop vite… toutes mes excuses ! » (p.40). Les différents groupes politiques d’extrême gauche sont évoqués dans un bel organigramme (p.22) ; néanmoins, on n’évite pas le topoï sur les scissions et les réorganisations au sein de ces groupes. Le récit est très clair quant aux regroupements entre « Le groupe de lutte contre le traité de sécurité conjoint de Keishin » et la Faction Armée Rouge qui vont prendre le nom d’Armée Rouge Unifiée sous la direction de Tsuneo Mori et Hiroko Nagata. Ils se retirent dans la montagne, et là une purge drastique a lieu il y aura 14 morts dans un groupe de 29 militants et militantes ! Ensuite, l’Armée Rouge Unifiée deviendra l’Armée Rouge Japonaise.
Le scénariste, Frédéric Maffre, a donc choisi un narrateur, Kozo Okamoto, qu’il définit lui-même dans l’entretien en post-face avec Aurélien Ducoudray (le directeur de la collection Karma), comme « une sorte de Forrest Gump, portant un regard oblique sur ces évènements ». Comme lecteur, cela induit une position ambiguë, il est difficile de rire avec un second degré, on est plutôt embarrassé (il nous semble que l’effet « Forrest Gump » ne fonctionne pas vraiment). Plusieurs personnages sont aussi décrits comme « très naïfs », peu au courant des enjeux politiques et géopolitiques, comme le mari de Fusako Shigenobu, Tsuyoshi Okudaira, et d’autres militants au cours du récit, cela nous apparaît peu vraisemblable.
Les parti-pris esthétiques et scénaristiques nous ont dérangés tout au long de cette bande dessinée. Les personnages sont dessinés en s’inspirant d’une certaine culture « manga », et surtout, leurs visages expriment très souvent des expressions de colère, de violence, et apparaissent presque comme des caricatures. Les couleurs très vives et les nombreuses scènes de violence, entraînent une certaine surcharge visuelle. Parfois, apparaissent des comportements des personnages eux aussi ultra-violents et caricaturaux. Si ce traitement esthétique et scénaristique fonctionne pour des mangas ou certains comics, il nous est apparu quelque peu déplacé par rapport à un récit issu « d’histoires authentiques et dramatiques ».
Nous exprimons ici notre ressenti par rapport au traitement graphique de cette histoire, et sûrement d’autres lecteurs n’auront pas le même avis. Il n’en reste pas moins que cette bande dessinée permet d’aborder un sujet complexe et méconnu et qu’elle réussit à donner envie d’approfondir un aspect méconnu de l’histoire politique du Japon.