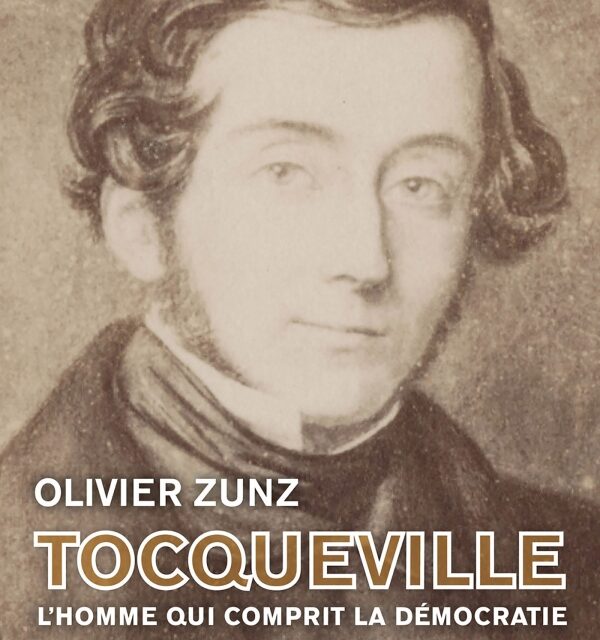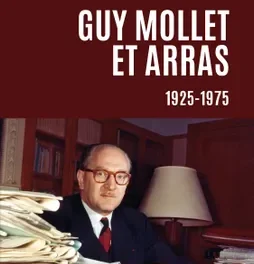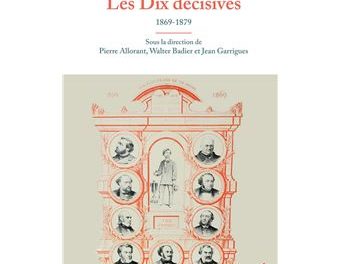Historien américain spécialiste de l’histoire urbaine des Etats-Unis et du développement de la philanthropie, Olivier Zunz est aussi un acteur reconnu des études tocquevilliennes. Comme d’autres historiens chevronnés parvenus au stade de la synthèse de leurs travaux, ce professeur émérite à l’Université de Virginie s’est tourné naturellement vers la biographie pour rendre compte de plusieurs décennies d’études du grand intellectuel libéral. L’ensemble, qui adopte la forme très classique et chronologique de la biographie, permet de brosser le portrait d’un « libéral d’un nouveau genre », observateur des progrès et écueils de la démocratie moderne et des tensions entre liberté et égalité.
Un héritage aristocratique embarrassant
Alexis de Tocqueville naît sous le Premier Empire, en 1805. Il est issu d’une famille aristocratique dont les possessions se distribuent entre la Bretagne, la Normandie et les Yvelines. De par sa mère, en particulier, Tocqueville est lié aux grandes familles Malesherbes et Rosanbo, fidèles aux Bourbons (l’arrière-grand-père, ministre sous Louis XVI, avait défendu le roi à son procès). Cet héritage aristocratique et légitimiste, s’il lui a donné ses entrées dans le monde sous la Restauration, fut aussi un embarras dont il chercha à se dissocier toute sa vie, et qui lui joua des tours quand il s’agît de s’engager en politique. Tocqueville prit d’ailleurs vite l’habitude ne s’attacher de trop près à aucun régime ni aucun parti, sachant comme le pouvoir était versatile en France depuis la Révolution.
La même prudence le guide ainsi après 1830 et l’avènement de la Monarchie de Juillet. Pris entre Bourbons et Orléans, il préfère ne pas choisir. Comme il est de surcroît coincé dans une carrière judiciaire qui l’ennuie, il porte ses regards vers un horizon moins étouffant et part pour les Etats-Unis avec son ami et collègue Gustave de Beaumont. Les deux jeunes gens ne partent pas au hasard néanmoins : ils y voient une étape dans un véritable plan de carrière, projetant chacun de ramener de leur voyage un livre sur lequel bâtir leur notoriété. C’est ainsi sous le prétexte d’aller visiter le système pénitentiaire américain et d’en rapporter des observations pour une éventuelle réforme en France, que Tocqueville et Beaumont demandent, et obtiennent, leur congé en 1831.
La traversée d’une Amérique en transition
Les Etats-Unis constituent un horizon sous la Restauration. Beaucoup y trouvent un contre-modèle révolutionnaire. Washington incarne ainsi une sorte d’anti-Napoléon, général victorieux, mais humble et ayant refusé le césarisme. A droite comme à gauche, on trouvait donc des admirateurs du Nouveau Monde. Le plus connu est alors Chateaubriand et ses célèbres romans américains comme Atala. L’écrivain, qui se trouve être un cousin de Tocqueville, a également publié en 1827 un récit de son voyage aux Etats-Unis réalisé trente ans auparavant, et livre au public français l’imaginaire de l’Amérique romantique.
Entre mai 1831 et février 1832, les deux Français s’embarquent pour un voyage de neuf mois et demi. Ils traversent une Amérique en pleine transition politique : l’élection d’Andrew Jackson a dynamité l’équilibre bipartisan qui faisait le jeu démocratique américain depuis l’indépendance. Ancien général, d’origine modeste et ne faisant pas partie du sérail politique des pères fondateurs, Jackson se fait le défenseur populiste du « common man » de la frontière contre les vieilles élites fédéralistes du Nord-Est, au sein du Parti démocrate qu’il contribue à fonder. Face à leurs opposants réunis autour de John Quincy Adams et du parti national-républicain issu de l’éclatement de l’ancien parti républicain-démocrate, les partisans de Jackson défendent la liberté des Etats et une Amérique des petits propriétaires indépendants à la conquête de nouvelles terres, contre les nouvelles élites industrielles développant banques, usines et chemins de fer. Autour de ce complexe bipartisme se structure un nouvel équilibre politique, opposant liberté des Etats et fédéralisme, pouvoir du président et du congrès, société esclavagiste et agrarienne du Sud et industrie du Nord. Si on a pu critiquer la vision idéalisée de Tocqueville d’une démocratie américaine pacifiée et fonctionnant bien, O. Zunz rappelle ici comme ces analyses relèvent déjà les tensions intrinsèques à la société américaine et qui éclateront dans les années 1860 entre le Sud et le Nord.
Arrivés à New-York, Beaumont et Tocqueville sont introduits au sein des élites politico-économiques de la ville. Volant de recommandations en recommandations, leur voyage est tributaire d’un certain nombre de contingences et de rencontres qui « fabriquent » leur itinéraire au fil de l’eau. Peu curieux des milieux populaires, « captifs » (p. 57) des milieux aisés qu’ils fréquentent, ils se coupent d’un certain nombre d’informations. S’il est parfois difficile pour le lecteur peu familier d’histoire américaine de s’y retrouver dans la complexité des clivages politiques et des dynamiques sociales des Etats-Unis, c’est ainsi un des grands mérites du récit d’O. Zunz que de mettre systématiquement en lumière les angles morts des voyageurs. C’est le cas notamment de la religion qui, bien que son rapport avec la démocratie ait frappé Tocqueville, a semble-t-il largement été mal comprise par le Français. Voyant dans le protestantisme américain une sorte de « foi dénaturée » (p. 102) et superficielle, Tocqueville rate ainsi le dynamisme des églises évangélistes qui attirent de larges franges de la société américaine des années 1820-1830. Comparant la religion américaine avec le catholicisme français rangé du côté des forces contre-révolutionnaires, le libéral est donc un peu prompt à voir le protestantisme comme s’accommodant fort bien de la démocratie et de la liberté, et évoluant dans une sphère totalement autonome du politique.
Parti de New-York pour la région des Grands Lacs, Tocqueville découvre la société atypique des confins coloniaux. Sa rencontre des Amérindiens le conforte partiellement dans l’image héritée du romantisme et du « bon sauvage » issu des romans américains de Chateaubriand. Il est également confronté pour la première fois à la question des inégalités raciales qui viendront prendre place dans son analyse. Puis, la Nouvelle-Angleterre lui permet de parfaire ses connaissances du fonctionnement constitutionnel et politique des Etats-Unis. Mais là encore, sa vision est biaisée par ses rencontres : l’historien Jared Sparks et le juriste John C. Spencer lui livrent ainsi une vision idéalisée de la politique américaine, et de surcroît orientée avant tout par le modèle de la Nouvelle-Angleterre. Tocqueville y découvre ainsi la force de l’autonomie locale, dont il fait le « point de départ » de la liberté politique aux Etats-Unis.
Le voyage de Beaumont et Tocqueville doit ensuite s’accélérer, les autorités françaises attendant leur retour et leur rapport sur le système pénitencier. Visitant quelques prisons, et en particulier l’Eastern State Penitientiary de Philadelphie, ils partent ensuite pour l’Ouest où ils découvrent le fourmillement fébrile de la Frontière mais également les déplacements forcés des Indiens. Ils terminent ensuite par les Etats du Sud, avant de repartir pour la France début 1832.
Une pensée en gestation dans les années 1830
Le voyage de Tocqueville est évidemment la première pierre de sa grande œuvre sur la démocratie en Amérique. Mais pour l’heure, les deux Français ont encore à produire leur rapport sur les prisons qui les occupe un moment : ils plaident ainsi pour une réforme s’inspirant de certains modèles américains, en particulier l’importance du religieux et de l’isolement des détenus, devant permettre le repentir puis la réinsertion. Tocqueville ressent aussi le besoin d’élargir la comparaison, et se rend en Angleterre où il découvre un modèle aristocratique ouvert aux enrichis et où égalité de droit coexiste avec inégalité sociale (il oppose alors démocratie politique et démocratie sociale). Ce nouveau voyage lui permet de parfaire son triangle théorique, et d’accoucher enfin du premier volume sur la démocratie en Amérique en 1833. Articulé autour de l’affinité entre religion et démocratie, de l’opposition entre gouvernement central et administration locale, et sur la force de l’associatif et des groupements d’intérêts, sa description de « l’état social » américain lui permet, en creux, d’adresser une critique au régime de Juillet dont il s’est depuis le début tenu à l’écart. Les résistances aux progrès, jugés inévitables, de l’égalité en France sont largement dus selon lui à la confrontation répétée de la répression d’un côté et des forces révolutionnaires de l’autre, chacun se nourrissant l’une de l’autre et bloquant tout changement. Comme il l’avait lu chez Guizot, Tocqueville postulait que la bourgeoisie française, soutien historique de l’absolutisme contre l’aristocratie, n’avait conquis l’égalité que « dans l’impuissance », et ne seraient ainsi pas suffisamment éduquée à l’exercice de la liberté.
La certitude qu’il tirait de son voyage aux Etats-Unis, au contraire, était que liberté et égalité pouvaient être compatibles, pour peu que la première s’exerce sans licence, comme une vertu morale et exigeante et un « effort personnel et exigeant en vue d’atteindre de grandes choses » (p. 232), aidée en cela par la religion. Des contre-pouvoirs nombreux, en particulier la liberté d’association et l’autonomie locale, permettaient de leur côté d’éviter que l’égalité (terme pris comme synonyme à démocratie) ne fasse sombrer le régime dans une « tyrannie de la majorité », dont ses interlocuteurs américains voyaient un avatar chez Andrew Jackson. A rebours de la tradition française, Tocqueville prônait ainsi une alliance du local et du national : manière pour lui de résoudre le problème d’une démocratie que peu de contemporains voyaient compatibles avec le fonctionnement d’un grand Etat.
La publication de ce premier volume de La démocratie en Amérique en 1835, dans un contexte de tensions entre la France et les Etats-Unis, est un grand succès qui lui ouvre, par l’entremise de Chateaubriand et Royer-Collard la bonne société littéraire des salons parisiens. Néanmoins, la réception de l’ouvrage est contrastée, à gauche comme à droite. Chez les défenseurs de la Monarchie de Juillet qui lisent en creux la critique adressée au régime, comme Guizot ou Louis de Carné, on critique notamment l’exportation d’un modèle américain jugé incompatible à la France, où les classes inférieures n’avaient pas de « frontière » pour se moraliser.
En 1839, enfin, Tocqueville accouche laborieusement du deuxième volume. Passé « de la description à l’invention » (p. 231), l’ouvrage est plus abstrait et plus théorique, lui occasionnant une réception bien plus confidentielle et critique. De plus, le « moment américain » semblait passé et, à gauche notamment, on se tournait vers d’autres modèles.
De la théorie à l’action : les années 1840
Après le succès du premier volume et cette période d’observation et d’intense construction théorique, Tocqueville brûlait de se frotter davantage au pouvoir. Il profite ainsi des crises politiques et dissolutions de 1837 et 1839 pour se présenter à la députation dans son département de la Manche. Il est élu lors de sa deuxième tentative dans la circonscription de Valognes, qui englobe le château de Tocqueville où il s’est installé.
Il est cependant peu confortable à l’Assemblée face aux blocages politiques et du fait de son isolement : s’entêtant à garder une position indépendante difficile à tenir, il s’y fait au début peu d’alliés, tout en entretenant une position de crête sur les réformes à tenir. Se plaçant à gauche et en opposition à la droite de Guizot ou de Molé, il est pris entre l’opposition dynastique d’Odilon Barrot et Adolphe Thiers qu’il juge centralisateur et illibéral. Il s’engage néanmoins dans un certain nombre de sujets sensibles, en utilisant notamment le journal Le Commerce qu’il rachète et dont il se sert comme tribune. Si la bibliographie mobilisée par l’auteur sur la Monarchie de Juillet ne semble pas de première jeunesse, les clivages politiques et basculement de majorités sont bien décrits, et permettent de suivre le positionnement de celui qui se décrit lui-même comme « philosophe-observateur » (p. 230).
Le cœur des débats dans ces années 1840 est bien évidemment la question du suffrage, dont la base censitaire paraissait de plus en plus restreinte : moins de 250 000 électeurs pour 35 millions de Français. Tocqueville, partisan comme on le sait de l’égalité politique mais se méfiant d’une tyrannie de la majorité inévitable dans un pays peu habitué à l’exercice de cette liberté, refuse l’élargissement du suffrage, préférant des réformes de fonctionnement. Il dénonce ainsi vivement la corruption et le clientélisme, qu’il observe scandalisé.
Son autre engagement porte sur le rôle de la religion, dont il a théorisé l’adaptation avec la démocratie. Tout à l’utilitarisme typique de cette époque, Tocqueville veut « séculariser le christianisme » et « faire sortir [ses] maximes » pour « les faire pénétrer dans la sphère pratique des lois ». Il revient dès lors à son premier projet en défendant une réforme du système pénitentiaire inspiré du modèle qu’il a observé en Pennsylvanie d’isolement et d’encadrement des prisonniers par des prêtres. Il prolonge ensuite son raisonnement politique sur la religion en s’impliquant dans la première « guerre scolaire », un peu oubliée aujourd’hui, qui fait rage au début des années 1840. Elle oppose le clergé catholique aux membres de l’Université sur la question de la liberté de l’enseignement. Assumant une posture libérale classique, il se montre partisan d’un contrôle de l’Etat sur l’instruction tout en valorisant la concurrence des deux systèmes comme porteuse de qualité et de dialogue entre Etat et religion. Il dénonce ainsi les positions outrées du camp laïc comme clérical, refusant le monopole de l’un ou de l’autre. Cette position médiane lui vaut de fortes attaques de la gauche et, plus douloureux, la rupture avec son ami Beaumont.
Par ailleurs, la question du paupérisme le convertit progressivement, à la fin du régime, vers la question de la charité publique et de l’aide sociale d’Etat, d’abord dans le département de la Manche où il participe à la prise en charge des enfants trouvés, puis à l’échelle nationale en nouant un dialogue, certes superficiel, avec les socialistes comme avec les catholiques sociaux. Toujours fin observateur, il prédit que la propriété sera le prochain « grand champ de bataille » politique (p. 260).
L’auteur nous livre enfin un beau chapitre sur les ambiguïtés, moins connues, de Tocqueville vis-à-vis de la question coloniale et de l’impérialisme. Son voyage aux Etats-Unis l’a fait observer de près les inégalités raciales le conduisant à être un farouche partisan de l’abolition de l’esclavage. Mais si le sort des Indiens, confronté aux déportations et vols de terres, l’a choqué aux Etats-Unis, il demeure défenseur de la conquête coloniale en Algérie : il y voit, pour peu que les militaires laissent la place aux civils, une vraie opportunité de construire une « frontière » française, un front pionnier porté par des individus qui y apprendraient l’égalité et la liberté.
La révolution et le pouvoir
Quand la révolution éclate en février 1848, Tocqueville se tient à nouveau d’instinct en retrait. Il y voit la malédiction française se répéter : révolution, réforme manquée, despotisme. Néanmoins, il se laisse tenter par l’opportunité et retrouve son siège de député lors des premières élections au suffrage universel masculin. La IIe République a l’histoire tragique que l’on connaît : dès le mois de mai le beau consensus de février s’effrite, avant de disparaître sur les barricades de juin.
Tocqueville, républicain du lendemain rallié aux perspectives ouvertes par la révolution, ne décolère pas contre les socialistes dont l’idéologie était fondée selon lui sur l’idée erronée que « la société était fondée sur l’injustice » (p. 308). Un mouvement jugé « matérialiste » et anti-démocratique, effaçant la propriété et donc l’autonomie individuelle, l’Etat devenant « maître, précepteur et pédagogue » (p. 310). Tocqueville critique le pouvoir centralisateur de l’Etat dont les masses dépendraient, ce despotisme doux dont il a décrit les caractéristiques dans un passage célèbre du deuxième volume de La démocratie en Amérique : « Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? ».
Tocqueville s’implique dans la commission chargée de rédiger la constitution. Il y défend son modèle américain de pouvoirs et contre-pouvoirs, assorti d’un exécutif autonome et du bicamérisme. Il se montre satisfait de l’élection du président au suffrage universel, mais se montre d’une grande prescience sur clause du mandat unique comme porteur d’un risque de coup d’Etat…
Nommé brièvement ministre des Affaires étrangères en 1849, il ne peut exploiter ses relations avec les Etats-Unis du fait de la crise diplomatique entre les deux pays. Tocqueville saute lors du remaniement du 31 octobre, et poursuit son travail à l’Assemblée. Le coup d’Etat de 1851 ne le surprend guère, et vient conforter sa déception du pouvoir et sa certitude que la réforme démocratique est impossible en France. Les dernières années de sa vie, marquées par une santé fragile et des accès de tuberculose, le voient se retirer de la vie publique : la grande rupture intellectuelle de sa vie fut ainsi de constater l’incompatibilité entre la théorie et sa mise en pratique. Il se consacre alors à la rédaction de son dernier grand livre, L’Ancien régime et la Révolution, dans lequel il tente, à l’instar de nombre de ses contemporains, d’expliquer la Révolution française. Il y exploite toutes ses idées développées par cette nouvelle science politique qu’il aura contribué à fonder. Alexis de Tocqueville s’éteint finalement le 16 avril 1859.
Olivier Zunz livre donc une biographie dense et inégalement pédagogique, mais sans aucun doute appelée à devenir l’ouvrage de référence sur Tocqueville. Il a épluché consciencieusement l’ensemble du corpus des œuvres de l’intellectuel (ouvrages, discours, correspondances…), collecté dans les années 1950 par la Commission nationale pour la publication des œuvres d’Alexis de Tocqueville et édités chez Gallimard en 32 volumes. Ce travail minutieux, accompagné d’un précieux index, permet de dresser une synthèse très complète des travaux et des combats de Tocqueville, du premier voyage en Amérique à la lutte pour l’abolitionnisme, en passant par des éléments moins connus comme l’engagement pour la conquête coloniale en Algérie ou les prises de positions sur la liberté de l’enseignement. Cette biographie servira à n’en pas douter l’histoire politique et intellectuelle du premier XIXe siècle.