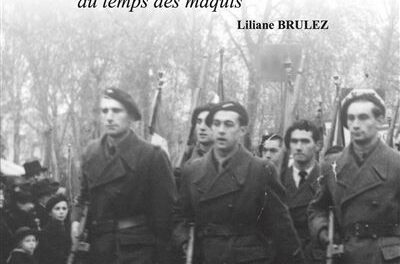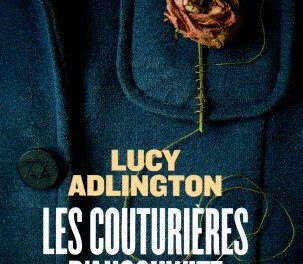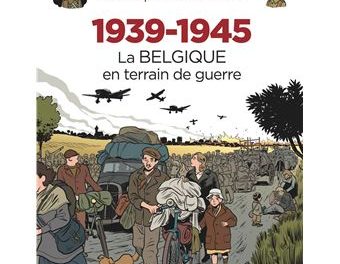Le moment des années 1930 où les puissances « ont cessé de se parler »
Étudier ce moment particulier, c’est l’ambition de cet ouvrage très dense et très riche. Entre l’automne 1932 et l’été 1933, Hitler arrive au pouvoir, les troupes japonaises franchissent les Grande Muraille de Chine, quand la Grande Bretagne se replie sur son immense empire.
Peut-on comparer la situation actuelle avec celle d’alors?
On fait souvent découler de manière mécanique la montée des régimes autoritaires des difficultés économiques, selon le schéma d’un trio infernal nationalisme / autoritarisme / mécontentement social. Cette crise économique a pourtant mené au pouvoir en France et aux États-Unis des gouvernements de centre gauche, sociaux-démocrates. De plus, les régimes autoritaires étaient, pour la plupart, déjà en place au moment de la crise. La comparaison selon Paul Jankowski serait plus judicieuse avec celle du tournant des années 1900 et ses flux transnationaux de personnes, de biens et de capitaux.
Comment expliquer les origines de la Seconde Guerre mondiale?
L’auteur rappelle en introduction les différents courants de pensée ayant proposé des interprétations de l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Il remet en cause la proposition de l’école réaliste, qui envisage l’idée d’un équilibre naturel, résultant d’un processus incessant de rééquilibrage dans un monde multipolaire ou bipolaire. Les alliances conclues pendant la Première Guerre mondiale disparaissent dès la paix signée et ne sont pas remplacées. Le monde tripolaire de l’entre-deux-guerres serait alors plus dangereux que celui, bipolaire, d’après 1945. Pour Jankowski, il ne peut s’agir d’un monde tripolaire, dans la mesure où les pôles ne cessent de varier en nombre et en poids. Pour les libéraux, c’est un monde interdépendant dans lequel les États-nations finiront par surmonter leurs jalousies. On éviterait l’apocalypse non par l’équilibre des forces mais par l’allégement de la souveraineté absolue des États-nations. Le président américain Wilson se fait le chantre de cette théorie, quand, à la même époque, le marxisme prôné par Lénine établit que le progrès du capitalisme entraînera la dissolution de l’État-nation. Tous deux verront leurs illusions s’envoler de leur vivant, ironise Jankowski. « Les puissances qui ont sanctuarisé la sécurité collective à Genève refusent de l’appliquer en Mandchourie » et elle « finit par expirer sous les provocations italiennes et allemandes en Afrique et en Europe ».
L’auteur insiste sur la grande variété de formes des motivations des dirigeants dans les années 1930. Des visions historiques diverses se côtoient ou s’affrontent : races et espace pour Allemands et Japonais, grandeur retrouvée pour l’Italie; liberté des mers pour l’empire britannique, quand Soviétiques, Français et Polonais s’inquiètent de leur sécurité. La vision de la guerre et de la paix dépend aussi des pays : Britanniques et Français envisagent une guerre plus longue mais moins féroce, alors qu’Allemands et Soviétiques signent des pactes mais considèrent la paix comme temporaire et se préparent à une guerre d’annihilation.
Pour les réalistes, ce sont la puissance, la sécurité ou l’autonomie qui expliquent les comportements sur la scène internationale. Pour les historiens, l’évolution des visions et des politiques étrangères sont centrales dans la compréhension de ces événements, sans oublier leur caractère pluriel et transitoire. Ce qui caractérise avant tout l’entre-deux-guerres, c’est le sentiment de vulnérabilité des nations, moins contre un oppresseur ou un ennemi clairement identifié que contre un monde vu comme hostile, dont les agents interviennent à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est aussi le moment où l’opinion publique s’invite sur l’échiquier. A peu près ignorée des diplomates à Vienne en 1815, elle ne peut plus être mise de côté à Versailles en 1919. La volonté de comprendre la Seconde Guerre mondiale principalement par le prisme de la Première laisse de côté le déclenchement du conflit par à-coups entre 1937 et 1941. Ce dernier apparaît alors comme un agglomérat de conflits nationaux et régionaux manquant de liens entre eux. Les clauses du Traité de Versailles jugées humiliantes par les Allemands avaient de facto disparu avant le déclenchement de la guerre par Hitler en 1939. Voir, avec l’histoire économique, la Grande Dépression comme facteur de l’émergence des nationalismes de droite visant à installer des régimes autoritaires et expansionnistes n’est pas non plus une solution satisfaisante. En effet, cela n’explique ni le maintien au pouvoir de ces régimes ni le fait qu’ils se soient intensifiés dans les régimes les plus revanchards (Allemagne, Japon) qui se sont pourtant remis plus rapidement que d’autres de la crise économique. On ne peut pas davantage suivre l’histoire psychosociale qui voit dans la guerre les effets des brutalités subies par 70 millions de combattants vingt ans plus tôt, alors que le retour de chaque pays vers la paix a été différent et que l’on a observé au contraire un développement du pacifisme.
Le monde actuel serait donc « apolaire » selon les mots de Richard Haas (A World in Disarray, 2017). Aucune dépression de même ampleur ne paralyse l’économie mondiale, mais d’autres crises émergent (crise environnementale, prolifération nucléaire, jungle du cyberespace…). « L’ordre censé succéder à la Guerre Froide est aussi chimérique que celui censé succéder à la Grande Guerre », explique Paul Jankowski, avant de conclure : « Rien n’était gravé dans le marbre. Les futurs belligérants auraient pu, au cours de la décennie, faire des choix différents. Ils ne l’ont pas fait ».
Prologue : Genève et Shanghai, 2 février 1932
64 nations, membres ou non de la SDN, sont invitées à Genève en 1932 pour « poursuivre la réduction des armements nationaux au point le plus bas compatible avec la sécurité nationale », vœu fondateur de l’organisation. Six ans plus tôt, le trio Streseman/Briand/Chamberlain attirait sur la ville les yeux du monde entier et promettait la paix. L’ambiance a bien changé au début des années 1930 et la crainte domine désormais. L’armée japonaise a envahi la Mandchourie ; la Bolivie et le Paraguay s’affrontent pour la région du Chaco. La séance s’ouvre devant une nuée de journalistes et de spectateurs, alors qu’au même moment, Shanghai et Nankin sont bombardées. De nombreux mouvements présentent des pétitions (6 millions de signataires!) en faveur de la paix mais ces mouvements sont très hétérogènes et ne présentent pas vraiment de front uni. Certains proposent de créer une « armée de la paix » (sans armes!) pour s’interposer entre Chinois et Japonais. Mais si la sécurité collective est une notion suffisamment large (et vague) pour que tout le monde y consente, « l’heure de la préférence nationale semble sonner partout ». Les nouvelles d’Extrême-Orient paraissent annonciatrices de dangers plus immédiats. Mi mai, le Premier ministre japonais et le président français Paul Doumer sont assassinés, et à la fin du mois le ministre allemand de la guerre (hostile aux SA) est poussé à la démission par des généraux nationalistes. Walter Lippman du Herald Tribune réalise que le désarmement ne s’obtiendra pas par des déclarations solennelles ni des promesses, et qu’il faut mettre fin à ces « querelles imbéciles » : mais comment ? Les chantres de la paix de 1926 étaient aussi viscéralement attachés à leur patrie respective. « Les drapeaux déployés à Genève pour célébrer une union mondiale apparaissent soudain comme les vestiges vivaces du tribalisme » conclut Paul Jankowski.
Les années de la sauterelle
C’est le nom imagé donné au premier chapitre, pour rappeler la situation du début des années 1930, qui rappelle les sinistres souvenirs de la Grande Guerre et de ses privations. 
Le monde regarde les souffrances de l’Allemagne. Couverture du journal satirique hebdomadaire allemand Simplicissimus, 31 août 1931 (le journal a été numérisé depuis l’année de sa création en 1896 jusqu’à 1945).
Les bolchéviques ont profité du chaos dû à la guerre pour prendre pouvoir mais Staline dès le début des années 1930 utilise la mémoire de la guerre pour justifier ses exactions, en pointant du doigts les adversaires et complices (associés aux Allemands). Pas d’unité non plus dans le camp des vainqueurs : les Français se considèrent comme les plus touchés (deux fois plus de pertes que les Britanniques, dix fois plus que les Américains) et les Italiens se sentent floués par le traité de Versailles. Les relations internationales sont empoisonnées par la question de la dette, du désarmement ou de la révision du traité de Versailles. Vainqueurs comme vaincus s’estiment lésés par la paix. A l’automne 1932, le bilan est catastrophique : depuis 1929 le commerce a diminué de près de deux tiers, la production industrielle de plus d’un quart en Europe (de moitié en Amérique du Nord !) et on compte 25 millions de chômeurs. Les explications fleurissent et tout le monde s’accuse mutuellement (l’interventionnisme américain ou au contraire les aventuriers de Wall Street, les réparations allemandes ou la course aux armements, l’instabilité monétaire ou le difficile rétablissement de l’étalon-or). Dans ce contexte, l’idéal de l’auto-suffisance fait de plus en plus d’adeptes : Keynes s’en fait le chantre aux Etats-Unis, elle prend la forme d’une autarcie coercitive en URSS et de l’idéologie du Lebensraum chez les nazis (Hitler voit dans la conquête de l’espace nord-américain par les Etats-Unis au XIXe siècle un modèle). L’illusion territoriale, qui veut que la prospérité nécessite davantage de terres, se retrouve également au Japon. Enfin, la survie de l’identité nationale nécessite l’exclusion des étrangers ou nouveaux venus, y compris dans les régimes démocratiques, à Paris comme à New York, où la présence de chômeurs et d’étrangers est dénoncée de manière virulente dans la presse.
L’automne 1932 à Tokyo, Rome, Berlin, Moscou, New York, Paris, Londres, Varsovie et Budapest (chp 2 à 7)
Le Japon connaît une période de relative instabilité politique, la coalition au pouvoir est très critiquée alors que le pays fait face à un mécontentement croissant dû aux difficultés extrêmes auxquelles sont confrontées les populations rurales. Le prince Saionji, 93 ans, est le dernier des Genro, les conseillers de l’empereur Meiji. Qui pourra le remplacer ? La voie de l’occidentalisation choisie en 1868 est désormais vivement critiquée et plusieurs figures publiques en faveur de cette politique sont successivement assassinées au début de la décennie 1930 par de jeunes hommes issus de la classe ouvrière dont ils portent les revendications. Ils souhaitent un nouveau régime, moins conciliant avec l’Occident et la SDN, avec un retour aux valeurs traditionnelles, surtout militaires, en opposition aux partis et aux financiers. Ils appartiennent pour certains à des sociétés secrètes, dont le nombre explose à la fin des années 1920. L’expansion territoriale va devenir un élément central, notamment en Mandchourie. Si la Chine en reste théoriquement maîtresse, la région est en fait aux mains de chefs de guerre locaux, et voit s’affronter les intérêts russes (protection de la ligne de chemin de fer de Chine orientale au nord) et surtout japonais. Infrastructures (ferroviaires, hospitalières, scolaires) en Mandchourie du Sud, extraction minière, agriculture céréalière : le Japon exploite massivement la province et représente près d’un tiers des investissements dans la région en 1931. L’occupation japonaise en septembre 1932 suite à un incident habilement mis en scène est l’aboutissement de tentatives menées dès 1927. Si le gouvernement tente de préserver les relations avec le partenaire économique qu’est la Chine, le poids croissant des militaires impose une tendance belliqueuse, avec en ligne de mire l’éventuelle implantation de bases militaires contre l’Union Soviétique et la Chine, dans le cadre d’une restauration vigoureuse de la voie impériale. Nationalisme et xénophobie se développent dans la presse. La guerre en Mandchourie apparaît comme une longue escarmouche en comparaison avec les lourdes pertes japonaise du siège de Port-Arthur au début du siècle et exalte la valeur des volontaires du corps de pacification du Mandchoukouo. Des rassemblements patriotiques saluent le retour du général de l’armée du Guandong début septembre, cette même armée qui laisse derrière elle sur le sol chinois des bandes de brigands armés et des campagnes livrées au pillage.
A Moscou, des manifestations « spontanées » sont savamment orchestrées par le pouvoir, pour saluer la mémoire de Lénine comme pour réclamer « l’exécution de mercenaires bourgeois », mais « le peuple soviétique est-il heureux? » demande le représentant américain à Riga. La collectivisation des campagnes a fait des ravages, dix millions de paysans ont été chassés de leurs terres, la famine et la maladie font en 1933 entre 4 et 9 millions de victimes et les autorités peinent à masquer ces chiffres affolants. Dans l’entourage de Staline même, des cabales naissent mais la répression est féroce. L’Union soviétique engagée dans un processus accéléré d’industrialisation et de modernisation doit triompher ou périr : c’est la naissance du nationalisme soviétique. L’étranger est accusé de vouloir saboter l’appareil productif et d’agiter les nationalismes locaux dans les républiques socialistes. Les unités fabriquant des tracteurs peuvent se transformer en usines de munitions et de chars très rapidement, l’URSS se modernise et s’arme massivement pour faire face à des potentielles hostilités. En effet, la Pravda dénonce la France et la Pologne comme pays les plus antisoviétiques au monde en 1932 (la menace japonaise n’est pourtant pas oubliée mais l’URSS préfère pour le moment la négociation).
New York, 8 novembre 1932 : les électeurs sont appelés aux urnes, Hoover est massivement critiqué pour sa gestion de la crise, ce dont profite un Roosevelt à la ligne politique mouvante mais à la personnalité plus éclatante. 
Le monde aux yeux des Etats-Unis, caricature du New York American, 5 juil. 1933 (numérisée par la NY Public Library)
Paris et Londres se recueillent le 11 novembre à 11h du matin. Quelques incidents éclatent à Paris (des vétérans pacifistes se heurtent à des militants de l’Action Française, des communistes affrontent la police dans le bois de Vincennes). La société française est particulièrement clivée, entre une gauche en majorité acquise au désarmement et au pacifisme, et une droite campée sur des positions nationalistes et défensives. La menace allemande inquiète et la France ne parvient pas à maintenir une coalition solide. Il a déjà fallu céder sur plusieurs points du traité de Versailles (réévaluation des réparations en 1924 et 1928 avant leur abandon de facto en 1932, évacuation précoce des têtes de ponts sur le Rhin). Les antagonismes ont été un temps réduits au silence pendant la Grande guerre, mais ils sont ravivés par la situation des années 1920-1930. Pierre Renouvin, premier grand historien français à avoir étudié la guerre en s’appuyant sur des archives officielles, déclare en 1931 « que les arguments émis depuis l’étranger sur la responsabilité sont inaudibles en France ». Si « personne n’accuse la France d’être la seule responsable du déclenchement de la guerre en 1914, nombreux sont ceux qui refusent de tenir l’Allemagne pour l’unique coupable » précise Paul Jankowski. Les funérailles d’Aristide Briand, chantre de la paix, rassemblent en mars 1932 les pacifistes et les représentants des 55 nations de la SDN. L’événement ne peut toutefois faire oublier les débordements nationalistes récents au Trocadéro, lors d’une conférence internationale des groupes pacifistes organisée par Edouard Herriot. A Londres, le climat est moins perturbé, sur le plan politique du moins, car la situation économique n’est pas brillante. Les observateurs locaux parlent d’apathie. L’essentiel de la vie politique est tourné vers la relance économique et financière. Le réarmement allemand commence toutefois à inquiéter de ce côté aussi de la Manche et certains journaux comme le Morning Post mettent « en garde contre la politique de l’autruche des assemblées à Genève susceptible de réarmer le monde plutôt que de le désarmer ». Churchill ne dit pas autre chose quand il accuse les membres de la SDN de crédulité.
A Varsovie, l’après-guerre est compliqué, le comité national polonais à Paris (entre autre) a participé aux discussions assurant à la Pologne une place à la table des vainqueurs, mais en oubliant la popularité du maréchal Pilsudski. La situation de la Haute-Silésie est particulièrement épineuse, l’influence allemande s’y fait ressentir depuis le XVIIIè siècle et la région est une « Ruhr miniature » convoitée. La modification des frontières positionne des villes très germanisées comme Poznan ou Dantzig sur le territoire polonais. Cette dernière est particulièrement hostile à la polonisation et est désormais menacée par le développement d’un port rival : Gdynia, premier port polonais sur la Baltique en 1932. Mêmes tensions du côté de Vilnius, annexée par les Polonais en 1920, ou en Galicie, où les séparatistes ukrainiens souhaitent leur indépendance de la Pologne. La Prusse orientale, province allemande séparée du reste du pays, agite le spectre d’une invasion polonaise à partir du printemps 1932, malgré les tentatives d’apaisement des libéraux, centristes et socialistes allemands. Pilsudski tient le pouvoir depuis son coup d’Etat de 1926 mais n’a pas établi de doctrine, ce pragmatique gouverne dans l’ombre. Il n’hésite pas à affirmer que l’alliance avec la France n’est pas gravée dans le marbre et renvoie son ministre des affaires étrangères Zaleski, trop proche des Français et de la SDN. Le nouveau est loin d’être francophile et ne cache pas son admiration pour Mussolini. Un pacte de non-agression avec l’URSS est ratifié dans les semaines suivantes (mais le Quai d’Orsay est en train de négocier la même chose). Les nouvelles frontières issues de la Première Guerre mondiale suscitent beaucoup de craintes et d’instabilité, y compris chez les nouveaux états d’Europe centrale, mosaïques ethniques, géographiques et historiques. La SDN est plus que jamais remise en cause.
Portes entrouvertes (chp 8) aussitôt refermées (chp 9) : conférence sur le désarmement et position à adopter face à l’invasion japonaise de la Mandchourie
Début décembre 1932, des hommes d’Etat de cinq puissances (France, Grande Bretagne, Etats-Unis, Italie et Allemagne) sont réunis sous l’égide du Premier ministre MacDonald dans un hôtel dominant le lac de Genève pour tenter de relancer la conférence sur le désarmement, alors au point mort de l’autre côté de la ville. Les Allemands acceptent de revenir à la table des négociations (quittée avec fracas en juillet) contre l’obtention d’un droit d’égalité à l’armement pour leur pays. Français et Britanniques soutiennent fermement la SDN pour sauvegarder leurs intérêts respectifs, mais il n’en va pas de même pour chacune des 57 autres nations. Les experts examinent depuis l’automne 1925, avec une infime minutie, les distinctions entre les armes (243 réunions pour la seule année 1927 !). La France s’inquiète particulièrement des demande allemandes, plus que la Grande Bretagne tournée vers son empire maritime. La proposition de « Gleichberechtigung » allemande verrait le désarmement des grandes puissances au niveau de celui imposé par le Traité de Versailles à l’Allemagne. C’est notamment pour cette raison que la France propose que la SDN se dote de sa propre force armée. Côté américain, Hoover, tout en soutenant l’importance du désarmement en Europe, affirme lors de son discours d’acceptation de l’investiture républicaine à Philadelphie en août l’importance de posséder une armée et une marine « capables d’empêcher toute invasion du sol américain » (contrairement aux ratios convenus avec la Grande Bretagne et le Japon). L’Allemagne, elle, n’a pas attendu pas le feu vert de la SDN pour contourner un certain nombre des interdictions du Traité de Versailles : près d’un million de membres du Stahlhelm et de la SA sont considérés comme réservistes à l’été 1932. L’état-major français est au courant, mais les politiques ne veulent pas ébruiter ce type de révélation. La conférence sur le désarmement voit même arriver à Genève une délégation soviétique (alors que l’URSS n’est pas membre de la SDN). Ses propositions de désarmement général suscitent l’hilarité, mais les autres puissances ignorent l’ampleur réelle de l’augmentation des dépenses militaires de l’Union Soviétique. Début 1933, quand commence le deuxième plan quinquennal, l’URSS possède 10 000 chars (contre 73 en 1927 !) et a déjà élaboré une stratégie qui sera utilisée par les Allemands sous le terme de « Blitzkrieg » dix ans plus tard.
Le 13 décembre, deux jours après la déclaration de Genève sur les armes, le gouvernement Herriot tombe, sur la question du paiement de la dette américaine de la Grande Guerre. La France a déjà cédé sur les réparations en juillet à Lausanne, ce qui annule de fait la quasi totalité de la dette de l’Allemagne, et s’est vu imposer à Genève le réarmement allemand (pour le moment théorique). Herriot souhaite que la France honore le paiement de sa dette aux Américains (pour sauvegarder de bonnes relations avec les Etats-Unis) mais comment le faire si les Allemands sont exonérés du paiement de la leur? 
Caricature britannique du Punch, déc. 1932, sur les dettes de guerre.
Une conférence économique mondiale est en préparation, elle devrait se réunir à Londres sous l’égide de la SDN mais « le désarmement économique sera sans doute aussi difficile à mettre en place que le désarmement lui-même », par manque de confiance généralisé.
Le 6 décembre, les petites nations, à l’instigation du représentant tchécoslovaque Benes, ont demandé à la SDN la condamnation des actions du Japon en Chine. Les grandes puissances bottent en touche, peu soucieuses de se trouver contraintes à prendre des sanctions ou pire, à intervenir. Le gouvernement de Nankin avait déjà exposé sa situation devant le Conseil de la SDN en septembre 1931, en invoquant l’article 11 de la charte, afin de trouver une solution. Le Japon refuse la médiation. Le rapport de Lord Lytton est rendu public en octobre dénonce les responsabilités dans les deux camps (dont le chaos rampant en Chine) mais condamne l’invasion japonaise en Mandchourie : les Japonais peuvent rester mais le Mandchoukouo doit disparaître. Le rapport est très mal interprété et encore plus mal reçu dans un Japon où les nationalismes sont exacerbés. En 1927, le gouvernement nationaliste du Guomindang à Nankin avait mis fin à sa coopération avec les Soviétiques. Deux ans plus tard, les troupes chinoises de Mandchourie, loyales à Nankin, avaient tenté sans succès de s’emparer de la voie de chemin de fer de l’Est chinois, encore en partie contrôlée par les Soviétiques (héritage de la Russie tsariste). Pour les Japonais, cela pouvait être l’occasion de chasser définitivement le Guomindang de Mandchourie. Cette ligne de chemin de fer qui relie le nord de la Mandchourie au sud-est de la Sibérie, a son siège à Harbin, et est convoitée par tous. En février 1932, les Japonais prennent Harbin. Les Soviétiques ne peuvent pas rester les bras croisés, malgré le souvenir de la cuisante défaite de 1905, et entrent dans la province de Rehe début 1933 mais préfèrent proposer un pacte de non-agression (Molotov invoque une « politique prudente et raisonnée » !). L’URSS n’est en fait pas encore capable de soutenir une guerre d’ampleur contre une autre puissance mais intensifie sa modernisation militaire en 1932 (création d’une flotte du Pacifique, construction d’usines d’aviation en Sibérie, envoi de bataillons au Kamchatka). En face, le Japon oscille entre bellicisme des officiers et pragmatisme des politiques mais ne ferme pas la porte aux négociations. Il sait pourtant que la SDN ne fera rien contre lui. Les Etats-Unis ont des intérêts à protéger aux Philippines, tout comme les Français en Indochine. Les grandes puissances, en vertu de la doctrine Stinson, condamnent mais ne souhaitent surtout pas intervenir. La SDN est devenue « un théatre de l’absurde ». Le 24 février 1933, les délégués de la SDN écoutent les plaidoiries chinoises et japonaises et doivent se prononcer sur l’acceptation du rapport Lytton. 42 délégués votent pour, seul le Japonais s’y oppose. Il annonce que le Japon ne peut plus coopérer avec la SDN et quitte la salle. Le président belge suspend immédiatement la séance, pour ôter tout caractère symbolique à ce geste.
Berlin, janvier 1933 : le Reich sous le regard de l’étranger
C’est finalement cet épisode, le mieux connu, qui fait l’objet du chapitre 10, mais de manière originale : moins pour montrer l’accession d’Hitler au pouvoir que pour révéler l’attitude des politiques à son encontre. Le puissant ministre de la guerre von Schleicher n’a pas confiance en Hindenburg, incapable selon lui d’intégrer les nazis à une coalition autoritaire qu’il pourrait diriger dans l’ombre. Il présente dès décembre 1932 un discours social. Un mois plus tôt, les élections ont mis un terme à l’ascension des nazis, dont le parti est en faillite. On voit même des SA tendre des sébiles sur le Kurfürstendamm ! Toutefois, il reste le premier parti d’Allemagne, fort de 12 millions d’électeurs. Von Schleicher manoeuvre pour faire entrer Hitler dans un gouvernement à double tête puis tente de rallier des nazis schismatiques (Gregor Strasser) : les deux tentatives sont des échecs. Von Papen, chancelier évincé, réussit là où Schleicher a échoué et pense manipuler Hitler en lui donnant la tête d’un « gouvernement de concentration nationale » en majorité composé de nationalistes et de conservateurs. 
Caricature du Punch, 8 févr. 1933, sur l’arrivée d’Hitler à la chancellerie.
A l’étranger, si l’on s’étonne de la nomination d’un « petit peintre en bâtiment autrichien », la presse est bien en peine d’expliquer ce que cela change. Quelques voix en France et en Pologne manifestent leurs craintes, Louise Weiss s’inquiète de « la démagogie raciste et des attaques contre les juifs et les communistes » dans son hebdomadaire L’Europe Nouvelle. Mais dans l’ensemble, la nouvelle Allemagne n’inquiète pas plus que l’ancienne : « le nazisme est un germanisme. Le danger reste le même ». L’ambassadeur André François-Poncet est perplexe, il a saisi qu’Hitler ne serait pas aussi facile à manipuler que ne le pensent von Papen et les autres conservateurs, mais s’il voit dans les premières mesures des nazis des similitudes avec celles des fascistes dix ans avant, il pense que les Allemands ne se laisseront pas faire. Il voit de la fenêtre de son ambassade le grand dôme du Reichstag brûler la nuit du 27 février, une semaine avant les élections prévues. Les communistes sont immédiatement dénoncés et leurs chefs arrêtés. Le 5 mars, les nazis gagnent 2 millions de voix supplémentaires par rapport à juillet 1932. S’ils n’obtiennent pas la majorité absolue, ils dirigent une coalition qui leur donne la majorité au Reichstag, ce qu’aucun gouvernement n’avait réussi depuis 1930. Les députés se réunissent fin mars pour renoncer à leurs fonctions au profit d’Hitler, seuls les sociaux-démocrates votent contre. Les vagues de persécutions s’intensifient contre les opposants et contre les Juifs. La presse étrangère relaie les événements parfois avec retard, avec des points de vue extrêmement variés (la presse conservatrice s’inquiète surtout des populations susceptibles de fuir l’Allemagne). Les diplomates s’accordent dans l’ensemble sur la constance de la politique extérieure de l’Allemagne, qui ne serait pas menaçante pour ses voisins. Hitler a tout fait pour les en persuader et demande même de nouveaux efforts pour faire avancer la question du désarmement à Genève ! Toutefois, les ambassadeurs français et britannique ont lu Mein Kampf et doutent de la sincérité d’Hitler. Les Soviétiques s’y intéressent aussi et en commandent une traduction commentée, mais le Politburo dissimule son contenu à la presse et au grand public. Certains groupes politiques conservateurs, en France et en Belgique, voient dans le nazisme un rempart contre le bolchévisme. L’Italie fasciste, sans surprise, est extrêmement favorable au nouveau régime allemand.
Complices involontaires (chp 11) et recul des Etats-Unis (chp 12)
Si l’opinion publique en dehors de l’Allemagne et de certaines régions où vivent des Allemands ne soutient pas massivement le troisième Reich, elle ne penche pas pour autant en faveur d’une intervention ou d’une guerre préventive. Ce que Paul Jankowski nomme « une sorte d’accommodement hostile » se met en place. Très peu connaissent ou ont lu Mein Kampf. Les traductions commencent à paraître dans le monde dans les années 1940. Les craintes se concentrent en Europe centrale et orientale sur la menace d’invasion. L’ambassadeur d’Allemagne en Grande Bretagne constate toutefois en mai que l’attitude des Britanniques à l’encontre de son pays s’est nettement refroidie. Aux Etats-Unis, 1 million de personnes se rassemblent au nom des Juifs allemands le 27 mars. Dans les cinémas parisiens, des sifflets et des huées accompagnent les actualités où l’on voit Hitler et ses partisans. Mais « personne ne semble séduit par l’idée d’entreprendre des actions agressives ». Bertrand de Jouvenel écrit même avec clairvoyance dans La République (journal le plus proche de Daladier) qu’Hitler va remilitariser la Rhénanie avant de se tourner vers l’Est, mais sa conclusion est de conclure un accord avec les Allemands. Blum alerte également mais toujours en vue d’un désarmement général.
Depuis 1922, Allemagne et Union Soviétique se sont rapprochées à Rapallo. Des wagons apportent à Riga les lingots d’or à destination de Berlin (dont des restes du trésor tsariste) et l’URSS est devenue le premier marché d’exportation allemand (matières premières contre produits finis). Mais des négociations secrètes concernent aussi les affaires militaires : entrainement de pilotes allemands sont entrainés loin du regard de la SDN, fabrication d’avions et de gaz toxique… Les Soviétiques préfèrent une Allemagne à l’écart du concert européen car ils redoutent avant tout une hégémonie française ou une coalition occidentale (surtout si cette dernière peut encourage l’expansion japonaise en Extrême-Orient). Le Général Hans von Seekt, créateur de la Reichswehr, ne craint pas le paradoxe : il lance la coopération militaire avec l’URSS tout en réprimant les révoltes communistes de 1923 ! Les Soviétiques mettent du temps à réagir et commencent à élargir leur politique de pactes de non-agression, notamment avec deux pays considérés comme des menaces par le troisième Reich : la France et la Pologne. Des industriels et des banquiers interpellent Hitler en lui rappelant que les commandes soviétiques représentent un tiers des exportations allemandes et font vivre des centaines de milliers de travailleurs. « L’intérêt défie l’idéologie », mais après la nomination du nouveau chancelier, la collaboration militaire avec l’URSS cesse. « Le Reich défie désormais ouvertement Versailles et n’a désormais plus peur de produire ses chars et son matériel sur son sol ». Toutefois, Hitler pratique le compromis et les ministres des Affaires étrangères des deux pays s’accordent pour étendre le traité de 1922. Le pacte germano-soviétique de 1939 se comprend mieux à la lumière de ces événements.
Côté italien, si la presse applaudit à l’avènement du troisième Reich, Mussolini est beaucoup plus sceptique. Il refuse les demandes de visites d’Hitler, a trouvé Mein Kampf « indigeste » et la campagne nazie anti-juive peu judicieuse. C’est surtout la possibilité de l’Anschluss autrichien qui inquiète l’Italie, peu soucieuse de voir émerger à sa porte un titan germanique. Mussolini soutient activement le nouveau chancelier du pays, Engelbert Dollfuss, nationaliste de droite opposé aux communistes comme aux nazis. Il se rapproche également du Hongrois Gömbös, à qui il fait parvenir des armes, violant ainsi les traités de Saint Germain et de Trianon. L’affaire fuite dans la presse, le scandale éclate. Français et Britanniques préfèreraient régler l’affaire sans publicité quand les nazis autrichiens y voient l’occasion de montrer que seul l’Anschluss protègera l’Autriche. La pression redescend, l’Italie continue à chercher des partenaires et propose même un pacte à quatre, avec la Grande Bretagne, la France et l’Allemagne ! La Pologne s’en émeut et le manifeste ostensiblement. Des soldats polonais débarquent même à Dantzig, des manifestants brisent les vitres de l’ambassade allemande à Varsovie. En avril, des rumeurs de guerre préventive de la Pologne contre l’Allemagne se diffusent. Hitler se veut rassurant et rencontre l’ambassadeur de Pologne en avril, chacun fait assaut d’amabilités et un pacte de non-agression officiel est signé huit mois plus tard. Dans les Balkans et dans le reste de l’Europe centrale, l’agitation n’est pas nouvelle mais aucune nouvelle alliance stable n’émerge.
2 février : un an après l’ouverture de la conférence sur le désarmement, l’Allemagne retourne à Genève pour la reprise des pourparlers généraux qu’elle a quittés en juillet. La France a déjà proposé à plusieurs reprises que tous les pays, dont l’Allemagne, ne soient autorisés à posséder que des milices nationales armées. Elle souhaite également que les 2 millions d’hommes de la SA (englobant aussi le Stahlhelm et la SS) soient considérés comme des effectifs militaires. Reinhard Heydrich intervient en pleine session pour informer « sur le caractère purement civil » des organisations nazies, refuse l’interprète juif qu’on lui propose et fait remplacer le pavillon tricolore de la république de Weimar par un drapeau à croix gammée sur le bâtiment abritant la délégation allemande. L’affaire dure quelques heures seulement mais fait une forte impression. Les Allemands n’étaient déjà pas vraiment bienvenus à Genève et parfois accueillis à jets de pierres ! Fin mai, Hitler menace de quitter la SDN si la conférence de Genève est ajournée sans lui donner satisfaction. « Le même mélange de condamnation et d’inaction accueille désormais chacune nouvelle ambition allemande », conclut Paul Jankowski. « Il pourrait accueillir de la même manière celles de Mussolini s’il venait à envahir l’Éthiopie, comme il en a l’intention ».
Aux États-Unis, le New Deal de Roosevelt doit faire remonter le moral des Américains et les Européens ne s’attendent pas à l’avalanche de mesures prises par le nouveau gouvernement. Il détache le dollar de l’or, bloque les aides aux débiteurs, conserve les barrières douanières et relance la construction navale. La nouvelle équipe ne connaît pas bien la théorie monétaire mais penche pour les expérimentations et la planification. La réponse se trouve à l’intérieur des frontières du pays, et non à l’extérieur. Les observateurs étrangers sont choqués par ces mesures, alors que doit s’ouvrir à Londres en juin la conférence économique mondiale. On craint qu’elle ne prenne le même tournant que celle de Genève sur le désarmement, car les sujets qu’elle doit traiter sont indissociables : barrières commerciales, instabilité monétaire, dettes de guerre non honorées et cessation des crédits étrangers. 168 délégués issus de 66 pays doivent s’y retrouver pour trouver des solutions. Le discours inaugural du roi George V est filmé et retransmis dans le monde entier. Comme à Genève, chaque pays est venu avec ses réclamations et ses objectifs, bien difficiles à concilier avec ceux des voisins. La conférence est finalement ajournée fin juillet, sans grand résultat. Cela ne sonne pourtant pas le glas des espoirs de relance économique, les puissances retrouvent peu à peu de la stabilité, surtout au Japon. Les pays les plus fermement accrochés à l’étalon-or finissent pourtant par l’abandonner : il n’existe plus en 1936.
Dans les démocraties occidentales, résume Paul Jankowski, « la majorité de l’opinion progressiste se déclarait favorable à la sécurité collective, au libre-échange sur toutes les mers du globe ou à la protection contre les persécutions en théorie » mais personne ne voulait s’engager dans les faits de manière active pour les défendre si ces libertés étaient attaquées. Trois puissances prédatrices – Italie, Japon, Allemagne – vont « tester les limites d’un trio de puissances passives – la Grande Bretagne, les États-Unis et la France » durant la décennie 1930. « Le spectre du chaos international se met en marche ».
Ironie du sort, la fresque sur la paix de l’Hôtel National de Genève, inaugurée par Aristide Briand en 1922, se décroche du mur et se brise au sol alors que la conférence sur le désarmement vient à nouveau de se réunir à l’automne 1933. La conférence se poursuit, mais les ministres des Affaires étrangères n’y participent plus.
Ce livre-somme offre un regard particulièrement intéressant sur le début de la décennie 1930, sans se centrer uniquement sur les problématiques européennes. Cette mise en perspective très riche et documentée n’oublie pas quelques anecdotes qui rendent la lecture encore plus agréable. L’aspect foisonnant des connaissances à maîtriser pour bien comprendre la situation des différents pays (y compris les plus petits) en fait un ouvrage à destination principalement des étudiants et des amateurs d’histoire éclairés. Quelques cartes et peut-être une chronologie auraient toutefois été bienvenues dans le petit encart central (qui présente d’intéressantes caricatures de la presse de l’époque).