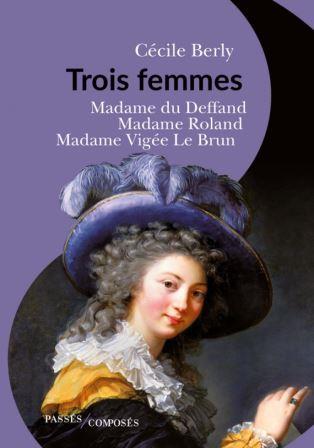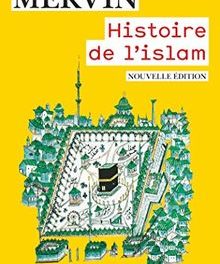Spécialiste du XVIIIe siècle, Cécile Berly a déjà publié plusieurs ouvrages sur Marie-Antoinette. Elle a également présenté et annoté la correspondance de Madame de Pompadour. Ici, l’auteur choisit de réunir trois grandes plumes issues de trois milieux et de trois temps différents du XVIIIe : une aristocrate Mme du Deffand, une bourgeoise Mme Roland et une artiste Mme Vigée Le Brun. Pourquoi cette lecture croisée ? L’historienne a voulu rapprocher ces héroïnes car elles ne sont pas vues comme des épistolières. Elles ne cherchent pas à être publiées, à devenir des femmes de lettres comme on l’entend à l’époque, mais l’écriture leur a permis de se construire et de se raconter. Mme de Sévigné est bien sûr leur modèle.
Très à la mode, la lettre est le prolongement des conversations de salons. Souvent rédigée sur le petit meuble appelé « bonheur du jour » dans l’intimité de la chambre, elle exprime l’idéalisme, les souhaits, les révoltes des femmes de leur époque. Elle matérialise leur présence sur la scène littéraire et permet de comprendre la construction de l’intime au long du siècle. Écrire ne signifie pas la volonté de se faire publier. Ces auteurs seront reconnues autrement au XIXe siècle notamment par Sainte-Beuve.
Mme du Deffand (1696 – 1780) est le bel esprit à la Française. Baignée de culture aristocratique propre à l’Ancien Régime, elle rompt l’ennui par l’écrit, symbole d’un monde révolu où la pratique épistolaire est reine. Elle rédige en continuité avec ce qui a été dit dans son salon, rue Saint-Dominique au couvent Saint-Joseph, et ce qu’elle écrit. Ce lieu où sont lues les lettres, est une véritable institution littéraire en France et en Europe, en concurrence avec celui de Mme Geoffrin. Mme du Deffand correspond avec les plus grands scientifiques comme Voltaire, l’ami fidèle, qui apprécie la qualité littéraire de sa correspondante. Elle reçoit les hommes des Lumières (Montesquieu, d’Alambert) qui l’ennuient profondément car elle ne goutte pas leur goût des libertés et leur volonté de changer une société qu’elle incarne. Elle hait Émilie du Châtelet qui lui a « volé » son philosophe. Elle qui déteste la nature, n’éprouve pas les émois rousseauistes. Vers cinquante ans, Mme du Deffand commence à perdre la vue. Ouvrir son salon lui permet d’assouvir un besoin d’activités et de mouvement. Elle exige du bruit, du déjeuner jusqu’à tard dans la nuit : des visites, des lectures, des sorties à l’opéra. La salonnière crée ce qu’elle appelle « son petit tourbillon ». La perte progressive de la vue, active une peur d’être abandonnée et de rester seule. L’épistolière persuade alors sa nièce, Julie de l’Espinasse de devenir sa dame de compagnie. Cette dernière a la faculté de savoir s’effacer tout en contribuant au rayonnement du précieux salon. Appréciée de tous, elle est reçue à l’Académie française, une victoire pour sa tante. Entrainée par d’Alambert qui ne supporte plus les positions de Mme du Deffand, « la muse des encyclopédistes » s’émancipe pour fonder son propre salon philosophique, une trahison bien amère pour une vieille femme aveugle et prisonnière de son fauteuil. Il lui reste ses lectures et ses lettres qu’elle ne cessera d’écrire, même à la fin de sa vie, avec son amour épistolaire de 20 ans son cadet, Horace Walpole, un écrivain anglais.
Issue de la petite bourgeoisie marchande, Mme Roland (1754 – 1793) devient une plume politique qui se cache derrière le nom de son mari. Enfant précoce, elle est nourrie de philosophie, de culture antique lisant Plutarque à huit ans, de sciences enseignées par des précepteurs vite dépassés. Ses lettres relèvent de l’intime avec son futur mari, Jean-Marie Roland de la Platière, de 20 ans son aîné. On est là dans un roman à la Rousseau. Pour cette femme qui aime se raconter, la lettre est l’exaltation, le sentiment et l’action. Tout passe par l’écrit chez Mme Roland alors qu’elle est peu loquace au quotidien. L’écriture épistolaire a forgé sa capacité à exposer clairement sa pensée, à savoir argumenter en toute circonstance. Un thème revient dans sa correspondance de jeunesse : l’envie et le besoin d’étudier toujours plus. Une fois mariés, le partage des rôles est clair : M Roland incarne l’homme public et il signe les écrits de sa femme, maîtresse de l’espace privé. Un contrat social existe entre les époux qui scellent leurs choix de vie. Mme Roland est sur tous les fronts. Femme d’intérieur zélée, mère rousseauiste, elle assiste son époux dans tous ses travaux au point de devenir sa plume, même quand il dirige le Dictionnaire des Manufactures ou correspond avec Brissot, futur journaliste du Patriote. Puis s’opère une coupure dès 1789 avec les événements révolutionnaires. Mme Roland espère que ses lettres seront un point d’appui, une matière première pour des discours politiques à diffuser. La lettre n’est pas un objectif d’émancipation mais un moyen d’obtenir une individualité au service de son engagement politique. L’épistolière se montre rapidement en faveur des révolutionnaires et pour la République. Écrire une lettre devient un combat collectif, un forum, une tribune dont le but est la circulation de l’information. Installés à Paris en février 1791, le couple Roland, partisan des Girondins, reçoit « une société de pensée » proche des Jacobins. Quand Jean-Marie Roland devient ministre de l’Intérieur en mars 1792, sa femme entre en conflit avec Robespierre par le verbe au sujet de la déclaration de guerre. Elle n’hésite pas non plus à condamner les massacres de septembre. Plus exaltée que son mari, en fuite après le 2 juin 1793, Mme Roland se laisse arrêter. La prison lui donne l’occasion de « tonner », d’hurler contre cette Révolution alors dominée par l’arbitraire. Toutes les lettres qu’elle compose sont « autant de talismans capables d’infléchir le cours de l’Histoire ». Elles sont adressées à l’Assemblée Nationale, à Robespierre, à sa fille. Elles montrent une sorte d’élan vital et de fulgurance avant son exécution, le 8 novembre 1793.
Peintre officiel de Marie-Antoinette, Mme Vigée Le Brun (1755 – 1842) est plus connue pour ses portraits que par ses écrits. Venant d’une famille d’artistes, la jeune femme bénéficie d’une solide formation chez le peintre Doyen, un ami de son père puis auprès de l’académicien Briard qui réside au Louvre. Parce qu’elle est femme, l’étude du nu lui est interdite mais par ses relations, elle fréquente des collections prestigieuses comme celle du duc d’Orléans. Au contact des plus grands artistes, elle se forge un style bientôt louangé et payé fort cher. Joseph Vernet lui conseille d’œuvrer selon sa personnalité. Par ses liens avec la famille royale, l’ascension de Mme Vigée Le Brun est fulgurante. Elle devient à la mode par son immense talent. Elle renouvelle « l’image de soi ». Le modèle est traduit avec ressemblance, débarrassé de ses imperfections et libéré des contraintes. Peindre une souveraine en paysanne sans perruque, sans maquillage et sans robe à panier semble totalement incongru à l’époque et même subversif. Mais grâce à son art, elle affiche une indépendance financière exceptionnelle, mariée cependant à un marchand de tableaux, Jean-Baptiste Pierre Le Brun. La protection de la reine lui vaut son élection à l’Académie royale de peinture, de sculpture et d’architecture en mai 1783, le point d’orgue du cursus honorum artistique. Royaliste convaincue et trop liée à Marie-Antoinette, elle part en émigration début octobre 1789. Mme Vigée Le Brun goûte ainsi à la liberté. Toujours dans le mouvement, elle peint des paysages en découvrant l’Italie et ses montagnes. Sa « lettre tableau » adressée à Hubert Robert montre ses émois artistiques quand elle découvre Florence, puis Rome. Dans cette capitale des arts, l’artiste s’épuise à peindre des commandes qui affluent venant d’une clientèle étrangère. Là, elle réalise son autoportrait commandé par le Grand-Duc de Toscane. Gracieuse et ambitieuse, elle fixe le spectateur qui distingue une ressemblance avec les portraits qu’elle a fait de Marie-Antoinette, un hommage et l’affirmation d’une réussite. Son voyage en Europe la conduit à Vienne où une société d’Ancien Régime se reconstitue puis en Russie, appelée par Catherine II qui admire la France. De retour dans son cher pays, Mme Vigée Le Brun constate les changements profonds de la société française et décide de continuer à voyager. Consciente que sa belle carrière est derrière elle, l’artiste peint des paysages en plein air, activité qui renvoie à son goût de la liberté et de la solitude. Pendant ses périples, elle se met en écriture et rédige un journal sous forme de lettres, réunies en Souvenirs. Ainsi, l’épistolière fait voyager son lecteur. Comme dans un tableau, l’écriture peint et décrit son époque. Elle devient un moyen de peindre autrement.
Avec un style précis et enlevé, ce livre passionnant traduit l’époque de ces épistolières et cherche à comprendre la place de l’écriture pour ces femmes si différentes. Il serait anachronique de questionner le féminisme de ces plumes « qui donnent à lire un XVIIIe au féminin » sans chercher la place que devraient avoir les femmes dans la société. C’est en cela que le livre de Cécile Berly s’inscrit dans la recherche actuelle.