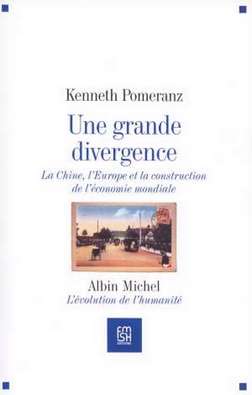
Beaucoup de nos élèves, ou de nos contemporains, semblent ancrés dans la certitude que l’Inde du XVIIIe, l’Égypte (on songe à l’époque de Méhémet Ali) ou la Chine des Qing ne pouvaient atteindre le niveau de développement des Européens de l’époque. Le livre que voici s’attache justement à faire un sort aux stéréotypes bien ancrés à travers une comparaison entre la Grande-Bretagne, voire l’Europe, et la Chine, en particulier la région de Shanghai.
De façon significative, en octobre 2009, l’historien Michel Margairaz (Paris I), présentant les problématiques de l’histoire économique du monde britannique « La puissance économique et financière britannique dans le monde », colloque Paris I, octobre 2009 http://crhxix.univ-paris1.fr/IMG/mp3/02_Michel.mp3., évoquait la sortie imminente de cette traduction de Pomeranz, aussitôt après avoir souligné l’importance, en leur temps, des travaux de David Landes ou d’Eric Hobsbawm. « Le livre de Pomeranz va sortir », disait Michel Margairaz. C’est chose faite.
Pomeranz, la Global et la World History
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kenneth Pomeranz enseigne à l’université de Californie. C’est un spécialiste de la Chine. Ses recherches s’inscrivent de façon claire dans le courant de la Global History ou World History. La traduction de cet ouvrage fondamental paraissait d’autant plus nécessaire qu’il avait fait couler beaucoup d’encre parmi les historiens, ce qui, de l’avis de beaucoup, et notamment de Philippe Minard, auteur de la postface à l’édition française, indique un ouvrage important. Atout fondamental chez l’auteur, il a accès à l’historiographie en langues chinoise et japonaise, ce qui n’est pas l’apanage de tous. C’est bien l’un des points forts de la Global history que de mettre en contact les recherches poursuivies ailleurs et de dépasser un paradigme ethnocentrique loin d’avoir complètement disparu. Ironie du sort, Pomeranz s’amuse d’être aujourd’hui identifié en Chine comme le chef de file d’une école californienne dont il récuse lui-même l’existence.
De la Chine à l’industrialisation de l’Angleterre
Ce qu’implique cet ouvrage dépasse la simple histoire économique de la Chine. Il s’agit d’ailleurs plutôt d’histoire comparée autour d’une problématique claire. Alors qu’on s’est longtemps demandé pourquoi la Chine, ou d’autres pays, ne sont pas industrialisés au XIXe siècle, Pomeranz retourne la question en se demandant pourquoi l’Angleterre a fait mieux que la Chine.
Pour beaucoup de chercheurs, et la remarque peut s’étendre à une bonne partie du public cultivé occidental, la cause est plus ou moins d’origine culturelle et institutionnelle, comme l’avait déjà développé Max Weber avec son éthique protestante. En outre, les chercheurs en histoire économique se sont souvent frottés à la question du rôle des institutions dans la croissance ou dans la stagnation économiques. On sait l’influence, dans ce débat, des recherches de Douglas North et de l’école dite « institutionnaliste ». D’ailleurs, ceux qui se sont intéressés un peu à l’histoire économique de la Grèce antique, ont pu y constater le rôle prêté aux institutions. Mais ce qui paraît simple à comprendre à l’échelle de la Grèce antique l’est moins lorsqu’il s’agit de comparer l’industrialisation de l’Angleterre à la non-industrialisation de la Chine impériale. Autrement formulé, Pomeranz récuse pour la Chine des Qing ce que d’autres soulignent pour la Grèce des cités.
Europe-Asie, Europe-Chine : l’absurdité des échelles de comparaison
Pomeranz relève l’absurdité des échelles de comparaison. Lorsqu’il s’agit d’évoquer l’industrialisation de l’Europe, il faut bien reconnaître que l’espace industrialisé au XVIIIe puis au XIXe siècles est relativement exigu et qu’il est comparable, par sa taille, à des régions chinoises comme la basse-vallée du Yangzi. Or, et c’est justement là que Pomeranz démonte méthodiquement une grande partie des idées reçues chez ses prédécesseurs, tout indique que les habitants de cette région chinoise connaissaient des conditions d’existence comparables à celles de l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. L’auteur se plaît par ailleurs à rappeler le vœu d’une société savante galloise, qui souhaitait en 1753, que la Grande-Bretagne devînt aussi prospère que la Chine.
L’ouvrage reprend donc l’ensemble des grandes problématiques de l’industrialisation et de la question du développement. On y retrouve par exemple les débats sur la proto-industrialisation ou sur l’existence éventuelle d’une révolution agricole préludant à l’industrialisation.
Colonisation et hectares fantômes
Pomeranz revisite également la question du rôle de la colonisation ou de l’esclavage dans l’industrialisation. Même si l’auteur rappelle le paradigme de la fameuse thèse d’Eric WilliamsEric Williams (Port-of-Spain, 1911-1981), historien et premier ministre de Trinidad-and-Tobago (1956-1981), auteur de Capitalism and Slavery, 1944., il ne s’agit pas de revenir aux théories selon lesquelles l’argent de la colonisation et de l’esclavage aurait financé l’industrialisation. On sait aujourd’hui que le capitalisme n’a pas systématiquement profité de la colonisation (Marseille, 1984) et que les négriers ont davantage investi dans le « bling-bling » plutôt que dans l’investissement productif industriel (e. g. O’Brien, 1982 ; Pétré-Grenouilleau, 1996). Qu’on n’attende pas Pomeranz sur le terrain de Williams. Pour lui, si l’Angleterre a fait mieux que la Chine, c’est d’abord parce qu’elle disposait de cette ressource peu coûteuse qu’était le charbon. Ensuite, si la colonisation et l’esclavage sont de nouveau convoqués, ce n’est pas sur la question de l’accumulation et du réinvestissement du capital. Il s’agit en fait de souligner qu’une partie des contraintes spatiales et environnementales britanniques a été externalisée via le système de production esclavagiste et les hectares fantômes (ghost hectares) que représentaient les économies extérieures pour une Angleterre maîtresse des mers. Pomeranz insiste donc sur l’espace et le coût environnemental économisés par la possession d’un empire. L’Angleterre fut ainsi dispensée d’espace agricole par l’accès facilité aux ressources du monde extérieur, colonisé ou non.
Un titre traduit mais curieusement plus vrai que l’original
Très stimulant, l’ouvrage est au cœur de plusieurs des problématiques de nos cours, qu’il s’agisse de l’âge industriel, du développement actuel des Sud ou de la colonisation. Il demande cependant un petit effort de lecture dans la mesure où les textes de ce type sont malaisées à traduire et y perdent de leur fluidité, de leur vie et de leur force démonstrative. La traduction elle-même relève de choix mais, outre des chiffres adaptés systématiquement au système métrique, le parti pris pour la bibliographie générale semble avoir été pris de renvoyer systématiquement aux éditions françaises des textes cités, sachant qu’il existe un décalage avec la publication d’une traduction en anglais comme celle de la thèse de Braudel.
On a également ajouté un supplément bibliographique actualisant la bibliographie, qui, dans l’ouvrage original, est datée de 2000.
Cette traduction française présente paradoxalement un titre plus conforme aux vœux de l’auteur puisque c’est par erreur que l’édition originale avait été intitulée « The Great Divergence » alors que l’auteur souhaitait « A Great Divergence ». L’ouvrage est par ailleurs doté d’un appareil de notes commodément disposées au bas des pages, d’un double-index, de cartes et d’annexes imposantes qui permettent d’alléger la lecture en réservant les détails aux annexes. La première partie est axée sur les étonnantes ressemblances entre Europe et Asie. La seconde aborde la consommation et la fameuse main (in)visible d’Adam Smith. C’est à cette occasion que les thèses de Williams sont rappeléesUne erreur de l’éditeur a amené la mention d’un Eric Wilson (op. cit., p. 284). Il s’agit de toute évidence de Williams. Le genre d’erreur difficilement repérable à la relecture.. Si les deux premières parties comportent introductions et conclusions, la troisième s’en passe. Elle fonde une argumentation sur le dépassement par les Européens, de Smith et Malthus. Il s’agit de comparer les tensions écologiques des deux mondes, notamment la question de la déforestation et celle de l’abolition par la Grande-Bretagne, des limites spatiales qui la bridaient. L’ouvrage s’achève sur six annexes : la capacité de transport terrestre par tête en Allemagne et en Inde du Nord vers 1800, les quantités de fumier utilisé dans l’agriculture de la Chine du Nord et de l’Europe à la fin du XVIIIe siècle, l’estimation de la couverture forestière et des disponibilités en combustible en France, dans le Lingnan et dans le Shandong vers 1750-1850, l’estimation des surfaces fantômes fournies par divers produits d’importation à la Grande-Bretagne (sucre, bois, coton), les revenus potentiels des travailleuses du textile dans le bas-Yangzi (1750-1840) et la production de soins et de coton dans cette région et dans l’ensemble de la Chine vers 1750 avec comparaisons au Royaume-Uni, France et Allemagne.
Du culturalisme classique à la divergence
L’une des faiblesses de l’argumentation est propre à la démarche de la Global/World History du fait de la nécessité de recourir fréquemment à des travaux de seconde main. A plusieurs reprises, même s’il a par ailleurs affirmé et démontré des faits intangibles, l’auteur se risque volontiers à fonder une partie de l’argumentation sur le caractère probable des choses plutôt que sur des faits avérés. Cette faiblesse n’est que partielle. Pomeranz démontre de façon magistrale que les Chinois de la basse-vallée du Yangzi vivaient au XVIIIe aussi bien que les Anglais des régions industrialisées. Faisant un sort à la question des institutions, laquelle avait beaucoup intéressé Braudel et d’autres, il avance que celles-ci étaient aussi respectueuses de la propriété que pouvaient l’être les institutions britanniques. Pomeranz récuse donc l’opinion communément admise selon laquelle le poids des traditions culturelles ajoutées au cadre juridique qui en est l’expression expliqueraient l’absence d’industrialisation.
La divergence se serait donc produite au moment où les Anglais s’engagèrent dans l’exploitation systématique du charbon en externalisant une partie de leurs besoins en espace productif. Les Chinois durent au contraire répondre au défi malthusien par l’intensification du travail d’où une baisse de la productivité par tête. Alors que la Grande-Bretagne devenait industrielle, la Chine se faisait industrieuse.
Peut-on utiliser Pomeranz dans nos cours ?
Grincheux et réactionnaires se ligueront pour nous expliquer qu’il est impossible de transposer de tels ouvrages dans notre travail quotidien. Or, rien n’empêche dans une problématique de terminale L-ES sur le développement, d’intégrer succinctement cette thèse à coté de Rostow et de Samir Amin lorsqu’on pose la question des causes du sous-développement et des écoles qui ont tenté de l’expliquer. La même remarque vaut pour l’industrialisation. Il paraît nécessaire de rappeler dans un cours de quatrième ou de seconde, que rien n’est irrémédiable au moment où se produit le décollage industriel de l’Angleterre. Alors que la volonté d’ouverture historiographique affichée naguère en France parait aujourd’hui oubliée, Pomeranz apporte de l’air au lectorat francophone. La traduction de son ouvrage-phare va permettre de diffuser les termes d’un débat déjà connu en terre anglophone et en Chine, tout en nous initiant à une bibliographie japonaise ou chinoise. La question est d’autant plus actuelle que, sauf à fantasmer sur la décroissance, nous rêvons aujourd’hui de taux de croissance ridiculement bas par rapport à ce qu’a pu atteindre la Chine dans la dernière décennie. En 2010, la divergence parait devoir s’estomper sur le long terme, en un temps où les salariés chinois revendiquent de meilleures salaires pour consommer encore plus.
© Clionautes




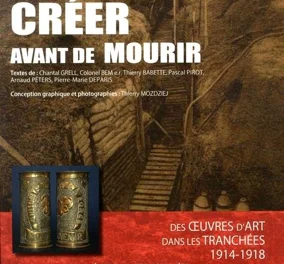









Trackbacks / Pingbacks