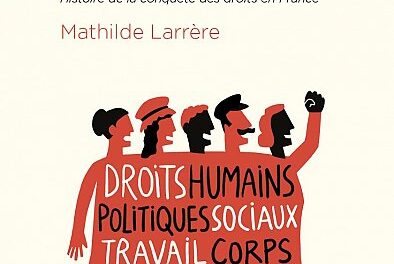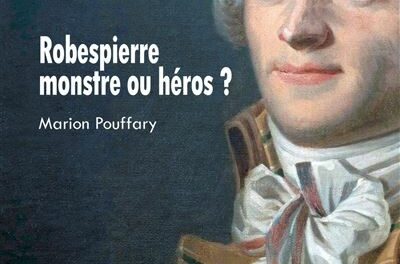En tenant entre ses mains cette Histoire populaire de la France, on pense immanquablement à l’ouvrage que Howard Zinn avait écrit en 1980 sur son pays : Une Histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours (Agone, 2002). On pense également à celui de Michelle Zancarini-Fournel, Les Luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours (La Découverte, 2016).
Pourtant, dans un fort volume d’un peu plus de huit cents pages, Gérard Noiriel ne fait pas le récit des classes populaires en tant que dominés, une énième « histoire vue d’en-bas », mais celui de la domination exercées sur elles, qu’il définit comme étant « l’ensemble des relations de pouvoir qui lient les hommes entre eux ». Cela évite l’écueil de faire une relation doloriste ou compassionnelle de la période qu’il appréhende. Dans le même temps, Gérard Noiriel revendique clairement ses influences intellectuelles, comme celle de Pierre Bourdieu, Norbert Elias, mais aussi ses propres origines, très modestes.
C’est pourquoi il part de l’époque où l’État tend à s’affirmer sur la société, au XIVe s., jusqu’à aujourd’hui. Le dernier chapitre est en effet une analyse de la première année de pouvoir de l’actuel président de la République, éclairée par une considération préalable de sept siècles, qui ne perçoit la société française qu’au travers des classes moyennes : les « démunis » (pour reprendre un terme qu’il utilise) ne sont désignés que comme une source de problèmes qu’il faut régler, dont on ne voit jamais ce qu’ils pourraient apporter au pays.
En prenant la domination comme angle d’approche, Gérard Noiriel montre comment se sont progressivement construits les outils sur laquelle elle repose (les structures de la domination), que ce soient l’impôt, une force publique (l’armée et la police), une administration de plus en plus intrusive, sans oublier celle de l’idée du sentiment national, les formes d’exclusion (le mendiant) voire de servitude (l’indigène au travers du Code noir), etc., qui ont eu entre autres conséquences d’aider à l’émergence de l’individu face aux collectivités. Il montre ce que cela, à chaque nouvelle étape franchie, a provoqué comme formes de refus, des manifestations aux émeutes, plus ou moins spontanées dont les modalités d’action ont évolué face aux formes de domination auxquelles elles se heurtaient (et continuent de combattre). On peut d’ailleurs voir ces résistances comme des tentatives de bâtir, consolider, recréer le collectif en train de se déliter. Mais Gérard Noiriel analyse aussi les moments où les dominés ont pu exercer une véritable influence sur l’ensemble de la société, comme au lendemain de la Libération, en imposant une recomposition du pays sur la base d’un réel approfondissement démocratique.
Parmi les nombreux thèmes qu’il aborde, celui de l’immigration tient évidemment une place prééminente, puisqu’il y a consacré une grande partie de son travail. Il montre ainsi comment le massacre d’Aigues-Mortes, en 1893, est un moment fondateur puisque se met notamment en place tout un vocabulaire encore utilisé aujourd’hui : intégration (qu’on appelait plutôt « assimilation » à cette époque), clandestins, etc. Ces mots s’appliquaient alors aux Italiens (avant les Polonais et autres), mais on les retrouve aujourd’hui dans le discours médiatique et politique. Gérard Noiriel montre d’ailleurs comment cette construction est le fait d’une élite insoucieuse des réalités (les rapports préfectoraux montrent pourtant que les Italiens s’intègrent facilement à la société française), repris par le corps politique (à qui l’électorat pourrait reprocher l’inaction), et surtout comment elle est finalement intégré par ceux auxquelles elle s’applique. De fait, les migrants finissent par se regrouper entre eux, ce qui permet en retour de justifier la méfiance dont on les entoure.
À cela, il relie la question nationale, alors très vive, à ce point qu’on est d’abord perçu que comme ressortissant d’un pays : on est qualifié d’Italien, par opposition au Français. On voit alors comment l’État apporte un lien à ceux qu’il administre, et comment l’identité est utilisée pour détourner l’attention d’autres questions pourtant plus préoccupantes, comme la question sociale, les inégalités, etc.
Il ne faudra pas se laisser impressionner par la taille du volume. L’écriture est très accessible, Gérard Noiriel ayant poussé le soin de placer les notes en fin d’ouvrage pour faciliter encore la lisibilité. On y gagnera d’accéder à des clés de compréhension de la société actuelle, sans céder au pessimisme qui pousserait à l’inaction. À sa manière, cette Histoire populaire est un livre de combat, ainsi que Bourdieu envisageait la sociologie.