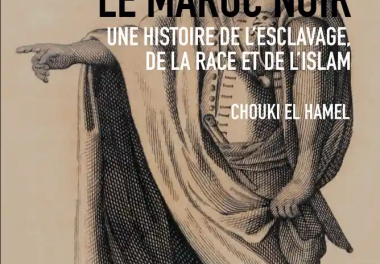Ces deux ouvrages du même auteur sont de nature assez différente, bien qu’ils soient extraits d’un corpus d’archives identique. Le 1e livre est le résultat d’une thèse, fortement concentrée, alors que le 2nd, plus rapide et plus accessible, illustre un aspect social peu connu de la vie quotidienne au Siècle d’Or. De plus, il est illustré par 22 dessins d’Alexis de Kermoal, dont l’esthétique, sans plagier de grands prédécesseurs, n’est pas sans évoquer Juan Miró. Il ne s’agit pas d’un commentaire de dessins, et les dessins ne sont pas là pour orner le texte : les deux se suffisent à eux-mêmes, tout en renvoyant à une tonalité commune. Dans le texte le plus court, la relation triangulaire inégalitaire entre les maîtres, les domestiques et les esclaves permet d’étudier la nature des liens de dépendance et de domination. Les esclaves se caractérisent par une absence de personnalité juridique, à la différence des domestiques, qui en disposent, en dépit d’une justice peu douce aux pauvres. Les esclaves sont de facto étrangers à la cité, d’origines africaines – noirs ou maures – quand les domestiques sont souvent élevés (criados : apprentis, pages, orphelins…) chez les maîtres, et appartiennent à leur maison, au point qu’ils sont souvent au centre des violences qui opposent les factions (bandos) rivales à Trujillo. L’examen porte d’abord sur les prix de la servitude, l’esclave est à la portée de « familles à revenus moyens » (p.7), puis les salaires des domestiques, en fait constitués surtout d’arriérés dûs par les maîtres, et enfin sur la figure des maîtres – surtout des nobles, puis des ecclésiastiques et quelques institutions, surtout conventuelles (p.23), mais pas d’artisans selon les sources utilisées. Ces groupes sociaux ne sont pas hermétiquement constitués, et même les esclaves peuvent bénéficier d’affranchissement. Ainsi, les relations de entre maîtres et esclaves, entre esclaves et domestiques et entre domestiques et maîtres répondent à des logiques économiques, sociales et culturelles. Le fait que la région de Trujillo soit en étroite liaison avec l’Amérique (Cortès est natif de Medellin et Pizarro de Trujillo), village proche de Trujillo) modifie ces relations. Cependant, pour en comprendre la nature, on ne peut que conseiller la lecture du 2e livre de Salinero : Trujillo d’Espagne et les Indes.
S’il est peu fréquent de proposer des lectures préalables à un livre auquel on souhaite le plus grand bien, toutefois je ne peux que recommander certaines lectures pour mettre ce livre en valeur car il y a ici de très nombreux éléments nouveaux à propos des relations qu’entretiennent les deux rives de l’Empire hispanique dans les années 1530 et 1630. Pour apprécier ces apports, on peut s’appuyer sur une courte synthèse (Jean-Paul Berthe dans l’Encyclopedia Universalis, article « Conquistador », T.6, p.640-641, Paris, 1990), ou sur la dernière biographie de Pizarro (Bernard Lavallé, Pizarro, 2004 : voir le compte-rendu dans Clionautes). Elles aideront sûrement le néophyte, parfois désorienté par le foisonnement des entreprises, des conquêtes, des liens familiaux et des ambitions personnelles. Quant aux dimensions anthropologiques complexes de l’Amérique latine, la dilatation du temps et l’immensité des espaces vécus, il suffit de (re)lire le chef d’œuvre du prix Nobel de littérature 1982, Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude, 1967. Cette double dimension historique et psychologique acquise, le lecteur entre de plain-pied dans le Trujillo de Salinero.
La méthode adoptée est doublement originale. D’une part, elle fonde sa logique sur un corpus de documents tiré des archives notariales au lieu de se concentrer sur les archives de Séville comme le font d’habitude les historiens américanistes. Bien sûr, les références aux célèbres Archives des Indes apparaissent, pour la Casa de Contratación (organisme économique qui gère les relations de la Couronne avec l’Outre-Mer), le Consulat (le Consulado : organisation des marchands, à laquelle le Couronne octroie un pouvoir croissant) et le Conseil des Indes (organisme politique). De même, Séville est encore au cœur des relations avec les Indes, par son monopole d’enregistrement, d’embarquement et de commerce transatlantique, même si l’auteur nuance : « le monopole sévillan n’est pas un véritable monopole » (p.10). D’autre part, l’originalité de cette approche réside aussi dans une quête en amont du mirage sévillan, par les échos que la conquête américaine produit sur une des zones les plus actives de la Péninsule, d’où sont partis de nombreux aventuriers, qui, une fois de retour dans la métropole, sont qualifiés d’indianos ou de peruleros par leurs compatriotes d’Estrémadure. Peu à peu, ces termes se diffusent et sont attribués à ceux dont on croit que la fortune provient des Indes, pour enfin, ne plus être réellement signifiant.
A cet égard, il faut le rappeler, cette région est l’une des plus belles d’Espagne, et elle fut longtemps l’une des plus pauvres. Au XVIe siècle, elle est aux avant-postes de la conquête, comme le travail pionnier de J. Lockhart l’a démontré (The Men of Cajarmaca, Austin, 1972). Cet auteur a isolé les 168 individus ayant participé avec Francisco Pizarro à la capture de l’Inca Atahualpa à Cajamarca en 1532 : 17 provenaient de Trujillo et de ses environs. L’événement est fondateur car la troupe obtient une rançon colossale, à l’image des pratiques de la guerre de Reconquête, équivalant à un demi siècle de production européenne de métaux précieux (p.44). Néanmoins, l’essentiel du travail de G. Salinero ne réside pas dans ces faits déjà largement connus, mais dans sa manière de traiter des conséquences de l’événement.
Dans les trois parties, consacrées au départ vers l’Amérique, aux liaisons entre la péninsule et les Indes, et à la question du retour, l’auteur évite les stéréotypes et les explications rapides ; il recourt à des schémas plus ancrés dans les mentalités du temps, moins économistes. Pour lui, si la troupe de Francisco Pizarro est bien à l’origine de l’accélération de l’ébranlement migratoire, on note par la suite environ 2 000 départs : les 17 auraient fait école. L’impact de la migration dépasse le seul migrant, au moins deux, trois personnes y participent indirectement, par les garanties et par le financement, ou encore sentimentalement, par les liens de parenté, d’amitié et de clientèle. Ce sont ainsi des milliers d’habitants de la région de Trujillo qui se trouvent intéressées par ces migrations. En outre, 10 et 20% des indianos reviennent à Trujillo. Les émigrants sont principalement des hommes, jeunes, célibataires, et le plus souvent des cadets qui ont emprunté et obtenu le soutien de leurs proches pour acquitter les frais de voyage : une cinquantaine de ducats, soit une décennie d’économie pour un paysan moyen (p.66), la licence d’émigration délivrée par les autorités s’y ajoute. A cause de la nature des sources notariales, la sociologie du départ est déformée ; l’élément paysan est sous-représenté au profit de la noblesse cadette, celle des segundones (Orellana, Pizarro) et du clergé. Parmi ces cadets, les combattants sont nombreux et se succèdent tout au long du siècle, comme ce Martin de Meneses, connu pour avoir brisé la résistance de Tupac Amaru dans les années 1570, comme Martin de Olmo, son compagnon de Trujillo. Tous les deux poursuivent une belle carrière (p.92-93), multiplient les fondations dans leur patrie d’origine où ils soutiennent les parents demeurés au pays. Ils fondent aussi des majorats dans la Péninsule pour garantir leur patrimoine, devenu ainsi insaisissable. Des missionnaires sont présents mais, généralement, ils ne passent pas devant le notaire pour aller évangéliser. Malgré cela, 44 clercs migrants sont identifiés, dont Geronimo de Loayza – toujours de Trujillo – dont le cursus culmine à l’archevêché de Los Reyes, l’actuelle Lima.
Très longtemps ces départs ont été imputés à la seule répulsion de la région, trop pauvre, qui écartaient les cadets. Sans nier cet aspect, Salinero met en cause ce schéma et il préfère insister sur le « localisme » des contemporains, sur l’importance des solidarités et des réseaux qui structurent l’émigration : on quitte l’Estrémadure surtout parce qu’un frère, un ami, ou un patron arrive à vous convaincre et qu’il vous soutient dans cette entreprise, quand bien même celui-ci demeure en contact avec le pays, voire quand il n’y est pas déjà revenu ! Au XVIe siècle, les habitants de Trujillo se trouvent « ailleurs en groupe », le plus gros contingent se rend au Pérou et plus de 60% des émigrés de Trujillo ont Los Reyes et Cuzco pour destination.
La deuxième partie insiste sur les liens tissés entre les Indes et la région de Trujillo qui bouleversent l’économie locale, métamorphosée par les flux démographiques et par les transferts économiques : « à lui seul, ce groupe [des 17] reçoit officiellement plus de 200 000 pesos d’or qui approchent les cent millions de maravédis » (p.114) lors de la séquestration de Cajamarca. En Amérique, de nombreux émigrés-conquérants reçoivent en plus des encomiendas : des Indiens sont confiés – encomendados – à ces colons – les encomenderos, qui se chargent, en théorie du moins, de l’instruction religieuse et civique des Indiens. En contrepartie, ils obtiennent des Indiens des prestations en nature ou en argent. Ce modèle qui reproduit des schémas de la « Reconquista » se trouve appliqué aux Indes. Par ce biais, les émigrés-conquérants dépendent de la Monarchie et conservent des contacts avec la Péninsule, du moins quand ils « réussissent » l’aventure américaine. En effet, le premier aspect de la relation Indes-Métropole n’est pas placé sous le signe de la richesse mais sous celui du manque : c’est « la rançon de l’absence » nous rappelle l’auteur. Cette relations concerne d’abord les femmes et les enfants. Les femmes restent seules en Estrémadure, vivent dans l’attente de nouvelles et dans la crainte de disparitions trop fréquentes. Quand elles sont abandonnées, elles doivent survivre économiquement et moralement, tout en évitant que leur honneur (la honra) soit mis en cause. On sait que l’adultère, la bigamie et l’homosexualité guettent les émigrants (parmi ceux-ci, en moyenne 7 hommes pour 1 femme). Dès lors, protectrice, la monarchie exige le consentement des femmes au départ des maris. Cependant, cette exigence est facilement contournée, et l’absence de l’époux laisse alors sur place une femme, et souvent aussi, une mère et des filles, qui restent juridiquement mineures. D’où, l’importance de l’utilisation des archives notariales répète G. Salinero, qui trouve deux applications à ces sources dans de remarquables chapitres sur le jeu des procurations, ce qui, dans le même temps, relativise la thèse de l’abandon total des femmes. Ces documents constituent un mode d’organisation de l’homme absent. Par le jeu des patronymes, une véritable enquête est entreprise pour débusquer les mandataires, les profiteurs, les disparus… Le chapitre consacré à l’anthroponymie procède d’une réflexion passionnante sur le problème de l’identité, question toujours complexe dans le cas de migrations, que cette identité soit transmise, usurpée, clandestine ou officielle. Le patronyme et le prénom énoncent tout un système d’appartenance, à un ou plusieurs groupes. Dans l’Espagne du XVIe siècle, le passage de un à deux patronymes (le nom du père et celui de la mère) est alors en train de s’effectuer. Or, étrangement, les patronymes des descendants des conquistadors (Orellana, Pizarro…) demeurent uniques, surtout pour ceux qui héritent d’un prestigieux majorat (le particulier réserve à l’un de ses héritiers une partie du patrimoine familial que la couronne garantit inaliénable). La répétition des noms reflèterait aussi la dilatation d’une pratique régionale (l’Estrémadure) à un espace beaucoup plus vaste par l’exportation des patronymes (p.162). Bien d’autres éléments de cette démonstration réussissent à convaincre le lecteur de l’importance de la dynamique des flux entretenus entre les deux rives – flux d’information, avec l’importance des charges notariales (qui notent et donc, qui officialisent) ou flux de secrétaires et d’écrivains publics dans un monde peu alphabétisé. Dans le cas de l’écrivain aux Indes, le parcours de Francisco del Amarilla (p.177-178) illustre le poids et l’étendue des réseaux formés à Trujillo. En cas de décès de l’émigrant, la « caisse des biens des défunts » à Séville réalise des recherches, renforçant le poids de l’écrit, même si l’information tenue d’un compatriote est toujours plus sûre que celle d’une administration qu’on pense lente et tatillonne.
La 3e partie traite du retour des Indes et des héritiers. Trujillo d’Estrémadure est transformé par l’argent américain ; le centre de la ville s’est déplacé, de la ville haute de la vieille noblesse de la « Reconquête » vers la ville basse, autour d’une nouvelle place où sont édifiés un hôtel de ville et des palais pour les peruleros. Chacun s’efforce d’avoir pignon « sur place » et d’apposer sur la façade le blason familial, ce que l’auteur sous-titre : « les Indes au balcon ». Des fortunes sont consacrées à l’achat de terrains et à l’édification de casas principales. L’immobilier joue un rôle important dans les patrimoines des héritiers, mais la terre et surtout les juros (titres de rentes perçus sur les revenus de l’Etat, viagers ou transmissibles) et les censos (titres de rente vendus par un particulier, ou une communauté) en constituent des pièces maîtresses, dont les montants atteignent des sommes faramineuses. Pourtant, le rapport de ces valeurs mobilières tend à décliner quand la monarchie de Philippe III et Philippe IV diffère de plus en plus souvent le paiement des intérêts de la dette publique, spoliant ainsi les épargnants. Le lien économique entre l’héritier et le monarque se trouve maintenu par ce genre de patrimoine, investi dans les finances royales et par la constitution des majorats : la permission du monarque participe aux stratégies patrimoniales des héritiers. Afin d’affiner ces trajectoires, deux cas opposés de lignages très proches sont étudiés avec une grande précision dans deux chapitres : celui des héritiers de Pizarro, qui assistent au déclin de leur fortune et de leur patrimoine malgré une lointaine protection royale, et celui des Orellana, dont la gestion paraît sage, vertueuse prudente, et respectueuse d’une stratégie clientélaire, tant en Amérique qu’en Estrémadure.
L’intégration de ces héritiers à la société péninsulaire se fait au prix de leur adhésion aux valeurs dominantes et de leur acceptation de la monarchie, dussent-ils voir fondre leurs investissements. En sens inverse, la monarchie n’abandonne pas totalement ces descendants : Philippe IV attribue le marquisat de la Conquista à Juan Pizarro, arrière petit-fils du conquistador.
Alain Hugon C.R.H.Q /Université de Caen Basse-Normandie