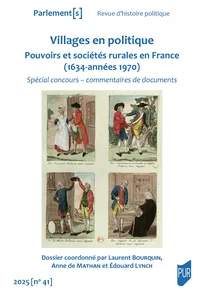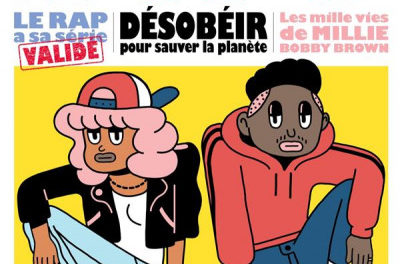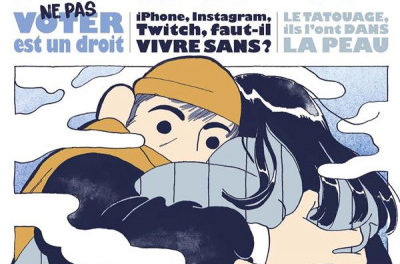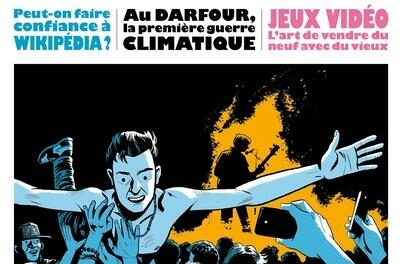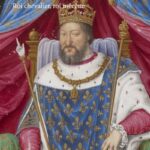La revue Parlement[s] n° 41 a pour thème : Villages en politique : Pouvoirs et sociétés rurales en France (1634-années 1970) (Spécial concours – Études de documents). Ce quarante-et-unième dossier est coordonné par Laurent Bourquin, Anne de Mathan et Edouard Lynch. Exceptionnellement, le dossier ne se compose pas de deux éléments distincts mais d’une seule divisée par siècle : 5 documents pour le XVIIe siècle, 5 pour le XVIIIe, 4 pour le XIXe et 7 pour le XXe (avec la contribution de 21 chercheurs différents, jeunes ou confirmées). Les sections [Sources] et [Lectures], une fois n’est pas coutume, ont été supprimées dans ce numéro, spécial concours.
En guise d’introduction, parmi les nombreuses métamorphoses que les campagnes françaises ont connues depuis le XVIIe siècle, la politisation est l’une des plus spectaculaires. Ce numéro spécial en prend la mesure. La plupart des pouvoirs sont appréhendés ici : celui de l’État, des seigneurs de l’Ancien Régime, des Églises, des notables et des élus des régimes autoritaires et démocratiques issus de la Révolution, des communautés rurales elles-mêmes et des nombreux acteurs, institutionnels ou informels, qui participent à la « mise en politique » des campagnes. Ce recueil rassemble une vingtaine de sources – textes et images – commentées par des historiennes et historiens spécialistes de ces questions. Comment s’organisent et évoluent, sur la longue durée et à différentes échelles, les multiples modes de domination du sol et des hommes ? Quelles sont les craintes et les attentes des villageois, leurs colères et leurs formes d’adhésion ? Comment agissent-ils, comment s’informent-ils dans des sociétés rurales qui s’alphabétisent, se médiatisent et s’intègrent au sein de l’État nation ? Telles sont les questions auxquelles ces études de cas proposent de répondre. Ce numéro s’inscrit dans le cadre des programmes d’agrégation 2025-2026 en histoire moderne et en histoire contemporaine. Ces documents et leurs commentaires seront aussi très utiles aux collègues de l’enseignement secondaire, qui pourront s’en inspirer dans le cadre de leurs cours.
XVIIe siècle
I-1/ Le pouvoir des Croquants (1636) « Ordonnance des paysans du Poictou » : (p. 23-35)
Brice Evain (Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Caen-Normandie, HisTeMé)
Source : « Ordonnance des paysans du Poictou » (1636), AN, U 793, f. 88v-89v
En préparant la guerre contre les Habsbourg, le roi de France Louis XIII étoffe le réseau des intendants et légifère sur les tailles. Cette politique se traduit par un renforcement du pouvoir royal sur les sociétés rurales. Elle est traitée dans l’article de Brice Evain sur « l’Ordonnance des Paysans du Poictou » de 1636 qui permet d’analyser les mots et les gestes des révoltes antifiscales des « années Richelieu ».
I-2/ Le régime seigneurial en Nouvelle-France (1663-1672) : Deux arrêts de Louis XIV concernant le défrichement et la colonisation du Canada : (p. 37-48)
Éva Guillorel (Maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2, Tempora)
Sources : Arrêts du Conseil d’État sur la révocation des concessions non défrichées au Canada, 21 mars 1663 et 4 juin 1672, Archives nationales d’outre-mer (ANOM). Textes reproduits d’après : Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’État du roi concernant le Canada, Québec, 1854, vol. 1, p. 33 et 70-71.
En Nouvelle-France (au Canada français), Éva Guillorel commente deux arrêts de Louis XIV (1663 et 1672) obligeant les colons à défricher les terres qui leur ont été confiées : ils témoignent des difficultés rencontrées par la couronne pour transposer et imposer son autorité outre-Atlantique.
I-3/ La théâtralisation territorialisée du pouvoir aux Antilles (1667) : Deux gravures d’une habitation sucrière : (p. 49-60)
Soizic Croguennec (Université Toulouse II (Framespa)
Source : Gravures de Leclerc Sébastien, l’Ancien (1637-1714) dessinateur et graveur français.
C’est au cours du second XVIIe siècle que la question coloniale s’impose dans la sphère politique. Soizic Croguennec montre ainsi, à travers deux estampes de 1664, que l’habitation aux Antilles est conçue comme un lieu de pouvoir fondé sur la domination des esclaves au profit de la production sucrière.
I-4/ Le paysan, le seigneur et l’intendant (1697) : Lettre de l’intendant de Moulins au chancelier : (p. 61-73)
Isabelle Brian (Professeure à l’université de Lorraine-Nancy, membre du Centre de recherches universitaires lorrain d’histoire – EA 3945 – et de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine)
Source : Archives départementales de l’Allier, Registre brouillard de correspondance de l’intendant de la généralité de Moulins Le Vayer, 1 A J 204 (2), registre non folioté.
L’article d’Isabelle Brian reprend le thème du renforcement du pouvoir royal sur les sociétés rurales, deux générations plus tard (1697), où l’intendant de Moulins se trouve en position arbitrale, bien embarrassé pour apaiser le violent conflit qui oppose un seigneur à l’un de ses tenanciers mécontents.
I-5/ Les pouvoirs d’un seigneur vus par lui-même (1715) : Extraits du Mémorial du baron de Savignac : (p. 75-89)
Caroline Le Mao (Professeure d’histoire moderne à l’Université Bordeaux Montaigne, CEMMC)
Source : Archives départementales de la Gironde, 8J 48.
L’article de Caroline Le Mao, qui commente des extraits du Mémorial du baron de Savignac (1715), permet de comprendre comment ce micro-pouvoir seigneurial s’exerce à la fois sur la terre et sur les hommes. En effet, le pouvoir seigneurial – son assise juridique, sa symbolique et ses modalités pratiques – est en effet au cœur de l’Ancien Régime.
XVIIIe siècle
II-6/ Définir le pouvoir seigneurial : Procès-verbal d’expertise d’une baronnie de Guyenne en 1762 : (p. 93-104)
Stéphanie Lachaud (ATER et doctorante, Université de Bordeaux 3)
Source : Archives familiales de Lur Saluces, 11e liasse, 18e dossier, 21 septembre 1762.
L’article de Stéphanie Lachaud sur la définition du pouvoir seigneurial à partir de l’expertise judiciaire d’une baronnie de Guyenne en 1762, montre que si les châtelains ne sont plus tout-à-fait seigneurs en leurs fiefs face à la monarchie, leur emprise sur le monde paysan se maintient en matière de police et de basse justice, voire s’accroît par la gestion minutieuse des exploitations agricoles et des droits seigneuriaux.
II-7/ Le pouvoir dès l’enfance : réflexions autour d’un conflit de personnes au village. Journal d’un maître d’école d’Île de France, Silly-en-Multien (1787) : (p. 105-118)
Côme Simien (Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, IHMC-IHRF / UMR 8066)
Source : Bernet Jacques (éd.), Journal d’un maître d’école d’Île-de-France (1771-1792), Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2000, p. 151-153.
Au sein du tiers-état, l’échelle micro-historique et l’attention sociologique aux rapports de domination entre les individus permettent d’observer comment un conflit en apparence anodin vise à la pérennisation, d’une génération à l’autre, de la notabilité assise sur le pouvoir économique, comme le montre Côme Simien à partir du journal d’un maître d’école, contraint par un laboureur de réserver au fils de celui-ci la place privilégiée d’enfant de chœur à Silly en 1787.
II-8/ La satire au service de la contestation paysanne (1789) : Quatre estampes anonymes au début de la Révolution française : (p. 121-131)
Pascal Dupuy (Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Rouen Normandie, GRhis)
Source : Musée Carnavalet (Paris) et Bibliothèque nationale de France (Paris), ainsi que sur gallica.bnf.fr : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6947732h.r=DE%20VINCK%20 3908?rk=64378;0
Une fois le marché politique ouvert en 1789, Pascal Dupuy explore comment le langage des estampes satiriques confirme les doléances paysannes et l’esprit de contestation contre la seigneurie, les privilèges et les impôts royaux.
II-9/ L’élection des premiers maires : Deux procès-verbaux d’élection municipale à Ris (Essonne) en 1790 : (p. 133-145)
Serge Bianchi (Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université Rennes 2, Tempora)
Source : Procès-verbal de l’élection du citoyen Raby comme maire de Ris, 24 mars 1790, cité par BIANCHI Serge et GOSSET Xavier (dir.), Naissance d’une démocratie électorale. L’Essonne au milieu du XIXe siècle. Élections et votes dans l’espace essonnien de la Première à la Seconde République, Malherbes, CRHRE, 2000, p. 100-101.
Pour autant, l’unanimité n’existe pas et si les Français s’emparent assez volontiers des nouvelles institutions et des pratiques qui s’y élaborent dans un processus de politisation rapide, c’est parfois à fronts renversés, pour servir la Contre-Révolution. Ainsi, dans le cas d’un conflit au long cours, généré autour de la première élection municipale dans le Bassin parisien, et tranché – c’est le cas de le dire – en 1794, Serge Bianchi présente deux partis aux prises : celui du changement incarné par les artisans du village et celui de la tradition défendue par le seigneur et le curé.
II-10/ Défendre son clergé (1791) : Pétition des habitants de la « commune de la paroisse de Plouguin ») : (p. 147-160)
Solenn Mabo (Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université Rennes 2, Tempora)
Source : Archives départementales du Finistère, série L, police des cultes (18 L 17).
Enfin, dans les campagnes léonardes du Finistère réfractaires à 90 %, Solenn Mabo révèle comment les habitants de Plouguin arguent de la liberté de conscience récemment proclamée dans la Déclaration des droits de l’Homme et usent de la pétition pour s’opposer au curé constitutionnel.
XIXe siècle
III-11/ L’arbre qui cache la forêt : la rébellion d’Autrans dans le Vercors en 1848 : Rapport du substitut du procureur de Lasalsette au procureur général (9 avril 1848) : (p. 163-175)
Gilles Della-Vedova (Chercheur associé au Laboratoire d’études rurales, Université Lumière Lyon 2)
Source : Archives départementales de l’Isère, 2U293, Rapports sur la situation morale, politique et judiciaire reçue des procureurs près les tribunaux, Tribunal de Grenoble.
Si l’histoire politique n’est pas au cœur de la question de contemporaine, le double processus de nationalisation et de démocratisation qui s’opère à partir de la Révolution française bouleverse de manière durable le quotidien des campagnes, dans le contrôle croissant exercé sur l’organisation de la vie collective au village, ou dans les retombées toujours plus visibles des politiques mises en œuvre au niveau national. Ainsi, les grandes crises politiques du XIXe siècle impliquent de manière décisive les masses paysannes, obligeant les administrateurs à en décoder les logiques, ouvrant un vaste champ historiographique autour de la politisation des campagnes. La Deuxième République en constitue une sorte de cas d’école, dans la foulée des travaux de Maurice Agulhon, depuis l’expérience inédite de l’exercice du suffrage universel masculin, tant à l’échelle nationale que locale, jusqu’à la résistance inattendue au coup d’État du 2 décembre 1851 qui irrigue de nombreux espaces ruraux. Mais, comme le souligne le texte analysé par Gilles Della-Vedova, ces dynamiques politiques doivent se lire non seulement à l’aune des réalités paysannes, celles des exigences économiques, ici la forêt, mais aussi à travers les logiques d’organisation et de pouvoir au sein de la collectivité paysanne, qui structurent les formes de réponses aux « agressions » extérieures.
III-12/ L’âne chargé de reliques – Contestation des sphères d’autorités au village. Placard et lettre du maire de Marnand (Rhône) (1866) : (p. 177-189)
Gaëlle Charcosset (Laboratoire d’études rurales)
Source : Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon Uv1373
L’article de Gaëlle Charcosset montre l’interaction croissante entre les dynamiques locales et nationales s’observe également, au ras du clocher, dans les affrontements entre « clans » villageois, dans le contrôle des positions de domination, de la mairie ou de l’autel.
III-13/ Représenter politiquement les campagnes en dehors des partis : L’autre politique de d’Édouard Lecouteux (1868)) : (p. 191-202)
Chloé Gaboriaux (Université de Lyon, Sciences Po Lyon, Triangle / UMR 5206)
Lecouteux Édouard, « Le parti de l’agriculture », Journal d’agriculture pratique, 19 novembre 1868, p. 641-642.
Comme le démontre l’article de Chloé Gaboriaux, les enjeux économiques se déploient aussi à l’échelle nationale, dans la volonté des notables et des grands propriétaires d’organiser et de structurer les intérêts agricoles, avec la tentative, inaboutie, des notables agromanes de constituer un « grand parti de l’agriculture ».
III-14/ Croire en la politique : Extrait d’August Strindberg, Parmi les paysans français (1885-1886) : (p. 203-217)
Laurent Le Gall (Université de Brest – Centre de recherche bretonne et celtique)
Strindberg August, Parmi les paysans français, Arles, Actes Sud, 1988 [1889], p. 95-98.
Avec l’article de Laurent Le Gall, nous observons que le monde paysan devient aussi un objet d’investigation et d’enquêtes, scientifiques ou littéraires, pour en percer les logiques et les mystères, y compris dans son rapport à la politique, comme s’y emploie August Strindberg dans son « voyage » fin de siècle, qui décrit avec finesse la manière dont les paysans s’approprient les mécanismes du vote et des débats nationaux.
XXe siècle
IV-15/ Requiem pour un prince en son village (1919) : Discours prononcé par un maire aux obsèques de Pierre d’Arenberg à Menetou-Salon (Cher) : (p. 221-234)
Bertrand Goujon (Maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine à l’Université de Reims Champagne-Ardenne / CERHiC, EA-2616)
Source : Discours prononcé par Alfred Baraudon, maire de Quantilly et conseiller d’arrondissement de Saint-Martin d’Auxigny, lors des obsèques de Pierre d’Arenberg à Menetou-Salon (Cher) le 8 août 1919, reproduit dans le Journal du Cher, 10 août 1919.
Avec l’article de Bertrand Goujon, nous voyons que l’enracinement du régime républicain accélère aussi la perte d’influence des notables traditionnels, à l’image du prince d’Arenberg, dont les obsèques sculptent le vain mausolée d’un modèle de domination notabiliaire, que solde définitivement la Première Guerre mondiale.
IV-16/ « Ils ont des droits sur nous » : un usage politique du soldat laboureur : Profession de foi de Jules de Terssac (1919) : (p. 235-246)
Antoine Cintas (Doctorant en histoire à l’Université Lyon 2 – LER)
Source : « Aux électeurs de l’Ariège », Jules de Terssac, Chambre des députés, douzième législature, session de 1920, Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1919, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, 1920, p. 74-75.
Si l’historiographie a eu longtemps tendance à les oublier, les ruraux et les agriculteurs continuent d’être des cibles mais aussi des acteurs de l’action politique, plus que jamais engagés dans la transformation qui s’accélère de la société rurale, en particulier durant l’entre-deux-guerres. L’ampleur des sacrifices, dans les tranchées ainsi qu’à l’arrière, les place au cœur des affrontements électoraux, comme lors du scrutin de novembre 1919, où la chambre bleu horizon a de forts accents agrariens, avec la multiplication des candidats « agricoles », dont Antoine Cintas propose un exemple parmi beaucoup d’autres.
IV-17/ « Contre l’office du blé ! » L’enjeu du vote paysan lors des élections du Front Populaire : Affiche du centre de propagande des républicains nationaux, sd [1935-1936], d’André Galland : (p. 249-259)
Édouard Lynch (Université Lyon 2 – LER)
Source : Affiche du centre de propagande des républicains nationaux, sd [1935-1936], d’André Galland.
Ces mobilisations rappellent l’enjeu nouveau que constitue le vote paysan dans les luttes politiques du Front populaire, que se disputent conservateurs, agrariens et forces de gauche, par le verbe ainsi que par l’image, par exemple avec l’affiche de propagande présentée par Edouard Lynch, qui exacerbe les stéréotypes de la représentation paysanne dans la lutte politique.
IV-18/ Une « réunion strictement corporative » perturbée par des « énergumènes » ? Compte rendu de l’interruption d’un rassemblement des Comités de défense paysanne par des militants socialistes et communistes dans le Journal de Rouen (1937) : (p. 261-273)
Louis Poupineau (Doctorant en Histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l’art : Histoire à l’Université Clermont Auvergne)
Source : « À Étrépagny, une cinquantaine de perturbateurs tentent en vain de troubler une réunion de défense paysanne », Journal de Rouen, no 67, 8 mars 1937, p. 4.
Mais les électeurs agricoles ne sont pas seulement une classe objet : les années trente, à la faveur de la grande crise agricole qui déstabilise en profondeur les campagnes, suscitent des formes de mobilisation largement inédites, avec l’émergence et la structuration de forces partisanes qui revendiquent leur dimension proprement paysanne. À ce jeu, les comités de défense paysanne d’Henry Dorgères s’imposent, arguant du monopole d’une parole paysanne mise en scène dans des réunions publiques, sur le modèle de celle analysée par Louis Poupineau, rappelant l’importance de la médiatisation dans la visibilité du monde paysan et l’édification d’un modèle protestataire.
IV-19/ « La terre vous parle » : Enquête de la Jeunesse Agricole Catholique / Féminine sur « l’avenir des jeunes ruraux » dans le Jura et motion présentée au préfet du Jura en 1954 : (p. 275-288)
Claire Bailly Alemu (Doctorante en histoire à l’Université Lyon 2 – LER)
Source : Dossier « Association de la jeunesse rurale du Jura », Archives départementales du Jura, 7 W 79.
Les fédérations jacistes se veulent tout à la fois les observatrices, les actrices et les porte-parole d’un monde qui change, comme en témoigne l’enquête menée par la fédération du Jura décryptée par Claire Bailly Alemu.
IV-20/ « Modernisation » agricole et syndicalisme : Michel Debatisse, La révolution silencieuse. Le combat des paysans, 1963 : (p. 289-301)
Alain Chatriot (Professeur des Universités Centre d’histoire de Sciences Po)
Source : Michel Debatisse, La révolution silencieuse. Le combat des paysans, Paris, Calmann-Lévy, 1963, 275 p., préface de François Bloch-Lainé, p. 15-17.
La Seconde Guerre mondiale constitue un basculement sans précédent dans l’évolution des sociétés rurales, qui sont bousculées par l’urbanisation, l’industrialisation et la révolution agricole. Elles parviennent à s’y adapter, comme l’illustre le rôle de la Jeunesse agricole catholique, fondée dès 1929, mais qui monte en puissance dans l’après-guerre, à la fois pour incarner une nouvelle classe dirigeante, définitivement émancipée des notables ruraux, à travers la figure de Michel Debatisse, icône et théoricien de la révolution silencieuse et pour prendre la mesure « au ras du sol » des transformations qui affectent le monde des campagnes.
IV-21/ La politique sur le Causse : Le Larzac au milieu des années 1970 dans le journal de 20 heures d’Antenne 2 : (p. 303-315)
Alexis Vrignon (Maître de conférences à l’Université d’Orléans)
Reportage diffusé au Journal de 20 heures d’Antenne 2 le 14 mars 1975
Si la frange modernisatrice des agriculteurs parvient, dans les années 1960, à élaborer un modèle pertinent et efficace de collaboration avec les pouvoirs publics, les recompositions sociales et professionnelles des campagnes génèrent d’autres enjeux et d’autres luttes, dont celle, emblématique, du Larzac, qui repose, sous des formes inédites, la place et le rôle des espaces ruraux et des agriculteurs dans la nation, comme le décrit l’article d’Alexis Vrignon.