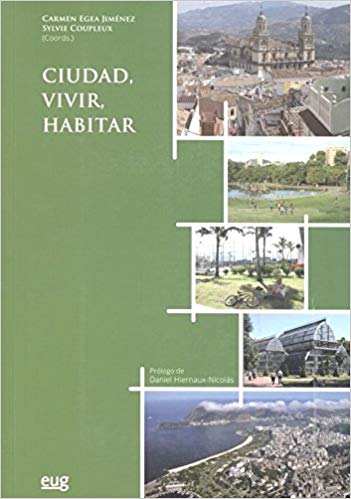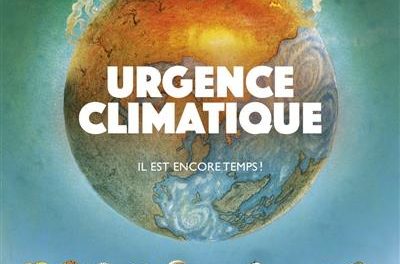Sylvie Coupleux-Vanmeirhaeghe est maître de conférence en Géographie et enseigne à l’Université d’Artois (Arras). Elle est directrice du Groupement d’Intérêt Scientifique Habitat Solidaire et Durable. Sa thèse soutenue en 1994 portait sur les migrations dans l’aire centrale du Nord-Pas-de-Calais. Carmen Egea Jiménez est professeure de Géographie humaine à l’Université de Grenade. Sa thèse, soutenue en 1996, portait sur l’évolution spatio-temporelle de la population de la province de Jaén entre 1900 et 1991. Ses recherches actuelles s’intéressent au droit à la ville, aux espaces publics et à la vulnérabilité sociale urbaine.
Le présent ouvrage est double. Les articles y sont d’un côté en français et de l’autre en espagnol. « L’idée de ce livre, nous dit Sylvie Coupleux, est née lors d’une journée d’étude organisée à l’Université d’Artois en mai 2015 ». La journée avait pour intitulé : Ville, Habitat, Habiter. Les différentes contributions de la journée renvoyèrent « l’image d’une ville humaine et solidaire rendre compte en apportant sa pierre aux ouvrages évoquant ce qu’on nomme les villes justes, aimables, inclusives, créatives ou pacifiques. C’est cette même image que le livre veut Le présent ouvrage rassemble 12 textes de géographes, sociologues, biologistes ou professionnels de l’habitat venant de France, d’Espagne, du Mexique et du Brésil.
L’ouvrage est ouvert par un prologue rédigé par Daniel Hiernaux-Nicolas, géographe et sociologue, professeur à l’Université autonome de Querétaro au Mexique. Son introduction dresse un tableau épistémologique et historiographique sur la « bonne vie » en ville, concept développé en 1986 par Yi-Fu Tuan dans The Good Life. Le géographe s’interrogeait alors sur les conditions du bien-être individuel et social, sans limite dans le temps ni dans l’espace. Hiernaux-Nicolas situe, avec le débat qui oppose David Harvey, le marxiste, à Simon Springer, l’anarchiste, sur la façon dont on peut « changer le monde » et accéder au « bien vivre », l’axe dans lequel entendent s’inscrire les auteurs du présent ouvrage. C’est évidemment la solution « anarchiste » qui est privilégiée, celle bien connue de Hiernaux-Nicolas, s’appuyant sur la politique du bottom-up. Il écrit : « Les auteurs de ce livre se posent en défenseurs du travail par le bas sans pour autant se situer dans une des positions idéologiques proposées ci-dessus. Ils exposent des expériences concrètes construites par des communautés ou s’interrogent sur les petits groupes » (p.12).
Les 12 articles sont classés selon trois parties. La première a pour but de rappeler aux lecteurs les bases théoriques « pour comprendre la ville comme espace de vie ». La deuxième partie donnent des exemples d’actions menées sur des lieux de vie et contribuant à modifier les rapports sociaux. La troisième partie s’intéresse à la sociabilité recréée autour des espaces verts publics. Dans les deux cas, la micro-échelle socio-spatiale est envisagée comme un moyen de vaincre la crise des espaces publics urbains.
De la citadinité au buen-vivir
Les deux premiers textes destinés à définir le contexte épistémologique du bien-vivre en ville sont le fruit trois contributeurs mexicains et d’un contributeur espagnol. Les premiers, à partir de l’exemple de Xalapa, capitale de l’État de Veracruz au Mexique et agglomération de plus de 400 000 habitants, tentent d’aborder les concepts de « droit à la ville », « citadinité » et « civilité ». Ils prennent l’exemple d’une protestation sociale, du type du mouvement des Indignés qui eut lieu à Madrid et un peu partout en Espagne en 2011. Entre janvier 2016 et avril 2017, à l’initiative de travailleurs de l’éducation qui réclamaient le paiement de primes non versées, des membres de l’enseignement puis du secteur de la santé, des retraités ont bloqué la ville par des manifestations silencieuses, des marches pacifiques. La répression policière fut très violente.
Le cas de l’indignation des classes populaires contre l’État est analysé par les trois auteurs, tous les trois étudiants en histoire, biologie et sociologie à l’Université de Veracruz à Xalapa, comme un « contexte-type » qui leur permet définir les contours de la citadinité, « condition qui permet aux citadins de jouir de droits politiques et sociaux » (p.28). Pour eux, la ville est le « contexte dans lequel nous créons des liens avec la famille, les amis, les voisins, l’école et les autorités ». Le cas de Xalapa montre, d’après eux, que les « taux de désavantage ou de vulnérabilité, génèrent différentes formes d’indignation menant à la contestation sociale ». Ce premier texte s’il soulève de véritables problèmes sociaux ne me semble pas suffisamment développer en quoi ces problèmes sociaux affectent ou sont reliés à une quelconque revendication d’un « droit à la ville ». L’analyse fournie, si elle est très – voire trop – technique est essentiellement sociale mais fort peu spatiale. N’est pas analysée, par exemple, les méthodes de blocage de la ville ni même les lieux investis par les Indignés mexicains.
Le second texte de cette première partie est dû à un géographe de l’Université de Grenade. Il s’intéresse à la notion de Buen Vivir et aux conditions de villes plus habitables et durables. L’approche est très critique sur la notion de « durabilité urbaine » que l’auteur dénonce comme une réduction à une « préoccupation superficielle, bienpensante, politiquement correcte ». Les politiques de durabilité urbaine, déclinées à travers un métalangage (walkability, éco-villages, écoquartier, smart-transportation…), décidées principalement par les édiles, intensifient des pratiques spatiales axées sur le consumérisme, l’individualisme et le gaspillage. L’auteur souhaite montrer que l’on peut envisager la ville durable à l’intérieur d’un nouveau cadre de réflexions, moins élitiste et moins homogénéisateur.
Francisco Javier Toro Sanchez introduit alors l’exemple du Buen Vivir andin, émergé au début des années 2010 en Équateur et en Bolivie. Pour les Aymara, peuple indigène de la Bolivie, le Buen Vivir dérive du terme suma qamana et désignerait un état de plénitude dû à la coexistence des individus avec la Nature et la Terre Mère « Pacha Mama ». Pour le peuple quechua équatorien, il s’agirait d’un dérivé du terme sumak kawsay et signifierait une vie en adéquation avec tout ce qui existe dans la nature. Cette notion du Buen Vivir écarte donc toute idée de « développement ». Elle constituerait un paradigme sur lequel édifier une nouvelle économie du bonheur en se basant sur l’interaction sociale, le sens de l’appartenance à une communauté et sur le lien avec la nature. Elle suppose un genre de vie moins attaché à l’accumulation excessive d’objets de consommation, au privé mais davantage tourné vers la collectivité.
L’auteur montre que la ville a toujours été, chez les urbanistes et notamment chez Cerda (en 1867 avec l’extension de Barcelone) ou Soria (en 1886 avec la Cité Linéale à Madrid), conçue comme une utopie du Buen Vivir. Les mêmes interrogations qui ont conduit la réflexion de ces urbanistes restent quasi identiques aujourd’hui, à la différence près c’est que les décisions qui en ont découlé ont été top-down. « Habiter la ville », pour Toro Sanchez et d’après le Buen Vivir, serait « participer activement aux systèmes productifs qui pourvoient quotidiennement au métabolisme urbain » (p.50).
Cohésion sociale et projets urbains
Dans cette deuxième partie, cinq exemples (deux en France et trois en Espagne) montrent des projets urbains plus ou moins réussis qui se sont attachés à créer des conditions de cohabitation sociale intergénérationnelle ou interethnique. Un premier exemple un îlot intergénérationnel à Arras, l’îlot Bon Secours, au cœur du quartier de la préfecture. Cet exemple est mis en perspectives avec des exemples quasi similaires mis en place au Québec. Ce premier exemple ne donne une vision que très partielle et ne s’intéresse qu’aux actions menées mais pas au vécu des habitants. Il aurait été très intéressant d’avoir un compte-rendu d’entretiens ou de sondages menés auprès des occupants de cet îlot.
Un autre exemple est une résidence universitaire, Flora Tristan dans le Polygone Sud de Séville. Ce quartier est répertorié comme un « bidonville vertical » dans lequel chômage, drogue, insécurité sont très forts. La résidence universitaire met au service des jeunes du quartier des étudiants pensionnaires, attirés par les logements accessibles, pour assurer du soutien scolaire. Les nombreux témoignages des habitants du quartier recueillis par l’auteure montre combien la cohésion sociale dans ce quartier a été renforcée. Enfin, l’auteure un phénomène très intéressant qu’il impute à ce qu’il appelle la « présence légère », c’est-à-dire une présence non marquée ni remarquée. Ainsi note-t-elle : « le fait que les garçons et les filles qui passent devant la Résidence voient les universitaires en train d’étudier fait que les jeunes du quartier se posent des questions qu’ils ne se posaient pas avant et reproduisent des comportements de ceux-ci, se produisant peu à peu et silencieusement une modification du quartier et de ses habitants » (p.95).
Un peu à contre-emploi, le dernier article s’intéresse au contexte de vulnérabilité des villes frontalières entre le Brésil et la Guyane Française.
La « Nature en ville », bien-être et sociabilité publique
L’expression « Nature en ville » est une expression introduite en 2010 dans le plan « Restaurer et valoriser la Nature en ville » lancé par l’ex-secrétaire d’Etat à l’écologie, Chantal Jouanno. À l’échelle locale, les collectivités territoriales sont chargées de prendre en compte cette thématique dans la gestion de la cité.
Dans un premier article, Laurène Wiesztort, géographe, montre combien la nature au cœur de la ville peut être un facteur sanitaire et de bien-être. Cette dernière une notion qui peut s’exprimer, d’après l’ONU, à partir de critères qu’elle définit en 2012. Ainsi les dimensions du bien-être sont le revenu, l’emploi, le logement, l’accès aux services, la santé, l’éducation et la qualité de l’environnement (pollution, accès aux espaces verts). L’auteure met en avant certaines recherches, comme celle de Quin Li, chercheur-médecin japonais, qui en 2010 exposait le fait qu’une promenade au cœur d’un espace boisé avait des bienfaits immunitaires remarquables, notamment l’augmentation des cellules tueuses naturelles. La « nature en ville » est donc nécessaire physiologiquement pour les individus comme elle l’est psychologiquement. L’auteure montre qu’elle constitue la clé d’une conception d’un cadre de vie urbain agréable pour les citadins en s’appuyant sur des recherches biologiques comme celles de Dearbon et Clark en 2010. Ainsi, les bâtiments, les routes et les pavés emmagasinent de l’énergie pendant la journée et la libèrent sous forme de chaleur durant la nuit. Les températures moyennes et les températures de surface des sols urbains sont ainsi plus élevées que celles des zones avoisinantes. Le végétal s’impose comme un matériau de confort pour concevoir des bâtiments et des villes durables.
Trois exemples, enfin, pris en France et au Brésil, font la démonstration que les espaces verts urbains sont des espaces de sociabilité importants. Christine Wenzl, doctorante en géographie, présente les travaux du philosophe et géographe américain Theodore R. Schatzki sur les pratiques sociales. Ces dernières « permettent que les individus se socialisent, de sorte qu’elles partagent certaines compréhensions générales du monde » (p.157). La mise en place « d’espaces verts urbains publics relève d’un ensemble de pratiques et d’arrangements qui révèle et transmet des valeurs, des conceptions de la société, de la nature, de l’accès à ce qui est public ». S’inscrivent dans ces schémas définis par Schatzki, les projets de jardins familiaux, de jardins partagés ou encore de jardins urbains. Paulo Cesar da Costa Gomes et Leticia Parente Ribeiro s’intéressent à la sociabilité dans les grands parcs urbains de Rio : la Quinta da Boa Vista, le Parc de Flamengo et le Parc de Maureira. Corinne Luxembourg, François Moullé et Dalila Messaoudi étudient les pratiques genrées des espaces publics à Gennevilliers. La place des femmes dans la ville en dit long sur l’habiter dans cette ville. À Gennevilliers, le logement est bien l’espace traditionnellement dédié aux femmes. Les auteurs s’appuient des cartes mentales, des entretiens de rue et des cartographies/photographies inspirées de l’œuvre de Gérard Fromanger. La méthodologie consiste à cartographie sur la photographie des hommes et des femmes. Les trois méthodologies déployées sur le terrain s’avèrent très intéressantes et absolument instructives. Les auteurs discutent leurs résultats à la lumière de la psychologie spatiale développée par Abraham Moles. Ainsi concluent-ils que l’espace public de Gennevilliers pourrait se décliner de la manière suivante : certains lieux sont considérés comme des excroissances du domaine privé (lieu fortement approprié par les femmes) ; à l’opposé, les abords des cafés rassemblent un groupe d’hommes et excluent les femmes par des remarques, des attitudes exclusives.
Globalement, comme tout ouvrage qui tente de regrouper une série d’articles issus de communications diverses celui-ci donne l’impression d’une très grande inégalité de l’ensemble. Même si l’intérêt est manifeste, l’effort d’harmonisation n’a pas été poussé à son maximum et certains manquent, par exemple, de fond dans l’apport théorique ou, plus clairement, de méthodologie précise et pertinente.