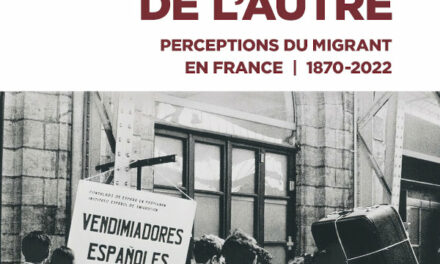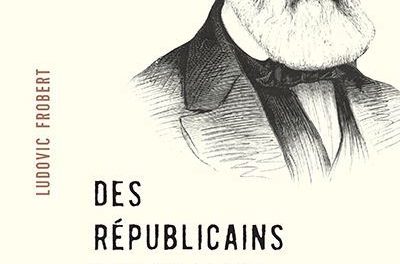Bien réhabilité déjà par les nombreux renouvellements historiographiques qui ont touché la période, la modernité des innovations politiques de ce souverain ne sont plus à prouver. Entre 1848 et 1852 en tant que premier président de la République, puis entre 1852 et 1870 comme empereur, Louis-Napoléon Bonaparte invente bel et bien de nouvelles pratiques de pouvoir. On a pu le redécouvrir récemment dans L’invention de la présidence de la RépubliqueLa recension sera bientôt disponible sur ce site de Maxime Michelet (Passé Composé, 2022) : on peut ici l’approfondir par l’observation minutieuse de l’empereur en déplacement, rencontre entre un Homme, incarnation de la souveraineté nationale, et son Peuple, idéalisé et enchâssé dans le cérémonial.
Rémi Dalisson, professeur à l’Université de Rouen, historien du culturel et du politique, poursuit dans son nouveau livre ses investigations sur les pratiques commémoratives et mémorielles en s’attaquant au règne de Napoléon III.
Anatomie du voyage politique
Au fil de l’ouvrage, l’auteur nous décrit la scénographie huilée qui préside aux voyages politiques de Louis-Napoléon Bonaparte. Un rituel lentement mûri dans le laboratoire de la IIe République, qui culmine à l’automne 1852 en préparation au rétablissement de l’empire, avant de se poursuivre, dans une grande continuité, jusqu’à la fin du règne : en tout, une centaine de voyages, 5000 kilomètres parcourus et 80 départements traversés.
Ces voyages s’articulent autour de quatre pivots essentiels. Le déplacement, d’abord, qui n’a rien d’anodin car il participe déjà lui-même d’une manifestation du pouvoir : en calèche, en bateau, ou à cheval, chaque moyen de transport se veut significatif. Mais c’est surtout le train qui résume le mieux la propagande de Louis-Napoléon, qui se veut champion d’une « modernité » en cours d’invention. Véritable « empereur-ferroviaire », il inaugure des lignes (Compiègne-Noyon, Paris-Tonnerre, mais surtout Paris-Marseille) et des gares (à Paris, Caen, Cherbourg, Nice…), rencontre les ingénieurs et techniciens du progrès, et traverse le pays à 100 km/h pour arriver là où le peuple l’attend, comme à Lyon en 1856, un jour à peine après que la ville ait connue des inondations dévastatrices.
Le voyage politique demande aussi une préparation, qui mobilise, à l’instar des élections, tout l’appareil administratif : préfets, sous-préfets, maires et police encadrent, embellissent, mobilisent voire répriment en amont de l’arrivée de l’empereur, tandis que la presse fait monter le suspense et l’attente. « Quand le souverain arrive en ville, il est déjà en terrain conquis, ou du moins c’est ce qu’il doit ressentir » (p. 86). On arrête les éventuels opposants, et l’on couvre les villes de drapeaux, bannières et surtout de ces arcs de triomphe que l’on retrouve partout, ornés des initiales de l’empereur ou des « 7,5 millions de voix » du plébiscite. La foule réunie doit répondre à des critères de quantité et de qualité, et pour cela les communes dressent parfois des listes nominatives d’ouvriers et de paysans qui doivent composer les délégations représentatives. Sans compter les notables et autorités locales, les représentants de l’instruction publique, de la justice, de l’Eglise ou de l’armée, les personnalités de la science et de l’économie, les associations de secours mutuels, les sapeurs-pompiers… La rencontre avec cette société idéale de l’ordre et du travail, est rythmée par un emploi du temps invariable : à l’arrivée l’annonce, les gestes de soumission les discours et les défilés ; les visites ensuite : hôpitaux, écoles, casernes… ; enfin les loisirs, dîners, fêtes et bals, spectacles et feux d’artifice.
La mémoire de la visite clôt enfin l’évènement qui perdure dans les innombrables médailles gravées, les aménagements inaugurés ou les textes composés par des thuriféraires de circonstance.
Un imaginaire de la Nation
Les déplacements de Napoléon III répondent à divers objectifs qui oscillent entre la contingence politique, sa volonté de répondre à l’actualité et des visées plus idéologiques. On trouve ainsi en vrac des voyages manifestant le faste impérial, comme le mariage de 1853, la charité, avec les inondations de 1856, l’exposition de sa personne après l’attentat d’Orsini de 1858, la guerre et la diplomatie en Angleterre en 1855 ou l’Italie en 1859, l’expansion de la France dans les Alpes en 1860 ou en Algérie en 1865… Il ne s’interdit pas non plus les lieux qui lui sont plus hostiles, comme le Sud-est républicain en 1852.
Mais derrière la dimension accidentelle de ces déplacements, une vision de plus long terme se dessine, qui raconte une « géographie idéale » et un imaginaire de la Nation. Une France modernisée et pacifiée, prospère et besogneuse, qu’il borne par ses frontières « naturelles », des Pyrénées au Rhin, et des Alpes à la Manche. L’empereur se projette aussi vers cette « plus grande France » impériale, au Maghreb ou en Cochinchine. Il opère ainsi deux voyages en Algérie, l’un en 1860, l’autre en 1865, et y déploie son idée de dépasser la dimension coloniale pour construire un véritable royaume arabe associé à la France.
Une « gouvernance populiste »
Pour désigner cette habitude de la politique itinérante, le terme de propagande n’est pas tout à fait adapté, qui réduirait ces voyages à de simples instruments de communication. Bien plus, l’auteur en fait une véritable technique de gouvernement en parlant de « gouvernance populiste ». Le terme de « populisme », délégitimant aujourd’hui, retrouve ainsi toute sa force. En effet, c’est par les voyages politiques que Napoléon III met véritablement en acte cette idéologie selon laquelle « la société est séparée en deux groupes (…), le peuple pur face à l’élite corrompue », peuple devant dès lors s’incarner dans un chef « ontologiquement bon » (p. 16).
L’empereur instaure un dialogue dont il est à l’initiative et dont il est en réalité le seul maître, imposant ses mots et ses thèmes. Le discours prononcé par Louis-Napoléon à Cherbourg en 1850 est ici illustratif : « Plus je parcours la France et plus je m’aperçois qu’on attend beaucoup du gouvernement » (p. 33). La rencontre du chef et de son peuple se veut ainsi la réponse à une « attente », et le voyage politique campe les rapports de pouvoir en un face à face privilégié de l’un et de l’autre.
La démonstration que ces voyages politiques sont davantage que de simples opérations de propagande, se trouve dans le volontarisme qu’ils mettent en scène : « Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin de fer à compléter », déclare Louis-Napoléon à Bordeaux en 1850. Ces voyages accompagnent une appropriation et une véritable « conquête » du territoire par le progrès et la modernité, se voulant l’occasion d’aménagements importants. C’est ici que l’on comprend le mieux la dialectique pouvoir – peuple manifestée par le voyage politique : la visite du souverain est l’occasion pour les communes de rivaliser de dépenses pour l’accueillir au mieux, débloquant des crédits exceptionnels et bénéficiant des largesses de l’Etat, ou plutôt de la Maison de l’Empereur.
Si Napoléon III hérite des pratiques des rois d’Ancien Régime et, plus encore, de la façon de gouverner de son oncle qui se voulait déjà cet Homme-peuple incarnant la souveraineté nationale, c’est bien lui qui invente cette « itinérance populiste ». Une innovation dont l’auteur suit la postérité dans le boulangisme des années 1880 et, plus encore, dans le pouvoir pétainiste qu’il a déjà bien étudié dans son ouvrage sur les fêtes sous Vichy (Les fêtes du Maréchal, CNRS, 2015).
Une étude fine des sources
Une telle étude se trouve vite confrontée à la question des sources. Si l’historien ne peut sonder ni les reins, ni les cœurs, comment analyser l’influence et la portée de ces voyages politiques ? Comment dépasser les sources produites par le pouvoir, de surcroît dans le cadre d’un régime autoritaire ? Rémi Dalisson « dissèque » ainsi son riche corpus composé autant de coupures de presse, de rapports administratifs, de récits que d’images (tableaux et médailles commémoratives). Il y traque l’affluence des spectateurs (livrant ainsi de précieuses statistiques en fin d’ouvrage), et les signaux faibles de la contestation, mille expressions subversives qui, déjà depuis le Premier Empire, cherchent à contourner la censure : « cris, murmures, chants, sifflets, absences, manifestations, graffitis, refus d’illuminer ou conduites étranges » (p.200).
Dans la richesse des sources analysées et passées en revue par l’auteur, on regrettera les trop rares renvois à des références précises qui auraient permis de faire de cet ouvrage un véritable outil de travail. Il s’agit sans doute d’un choix éditorial pour un livre qui se veut, comme le soin dans l’écriture en témoigne, ouvert à un large public.