Ce livre est annoncé comme une somme ; l’artifice galvaudé de marketing n’en est pas un. Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri nous offrent un livre immense, décisif pour qui veut comprendre les arcanes sinistres de la guerre à l’Est et tout particulièrement pourquoi Barbarossa et son échec ont été la matrice des pires exactions envers l’humanité, dont les conséquences géopolitiques sur le temps long sont tout aussi essentielles.
Ce compte-rendu a été pensé non comme un simple résumé mais comme un outil de travail potentiel. La profondeur des 956 pages est réelle et aussi ai-je fait le choix d’une approche détaillée pour combler nos lacunes, immenses, autour de cette question. Si l’histoire bataille est à l’honneur, ce n’est pas celle qui fut, à juste titre, critiquée pour ses approches strictement militaires dans les années 1960-1970, dans la droite ligne de l’école des Annales. Ce terrain honni a été trop longtemps déserté et ce livre permet de saisir l’importance capitale de l’étude du phénomène guerrier dans les études historiques.
Introduction
Ce moment si important pour définir tout objet d’étude permet à Jean Lopez, dans un style clair et soigné, de poser trois bases fondamentales. Tout d’abord la nature extrême de la guerre à l’Est, et ce dès le jour de l’invasion. Cette guerre idéologique absolue peut être analysée, et c’est le second point clé, grâce à l’abondance de sources et d’études, allemandes mais aussi russes. C’est aussi toute la force de cet ouvrage que de permettre au public français de profiter de travaux rarement traduits, particulièrement pour les Russes. Sources de première main, carnets personnels, rapports militaires, analyses postérieure, une masse considérable de sources a été brassée pour construire cette somme unique. Enfin Barbarossa est étudiée dans le temps long, ne se limitant pas au cycle strictement militaire. Des relations anciennes entre Allemagne et Russie, en passant par la Première guerre mondiale, les bouleversements révolutionnaires, la monté nazie au cours des années 30 à laquelle répond la poussée stalinienne, c’est bien le temps long qui est permet une juste mise en perspective, jusqu’aux temps de la guerre froide.
Vers des Indes brumeuses
La démonstration de Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri vise à montrer comment Barbarossa, contrairement à ce qui est parfois toujours présenté ici ou là, trouve ses racines non point dans Mein Kampf mais dans une construction lente beaucoup plus ancienne. Ce qui ressort essentiellement est cette idée de glissement chez Hitler, glissement connu dès un dîner rue de Bendler le 3 février 1933 auprès de militaires de premier plan qui deviendront les architectes et exécutants de l’invasion et de ses malheurs, von Leeb, von Bock, von Rundstedt par exemple. Lors de ce dîner chez le général von Hammerstein, officier majeur de l’armée allemande, sont évoqués par Hitler l’invasion mais aussi la destruction désirée de l’URSS et l’anéantissement du marxisme, seul le sol pouvant être germanisé. Que les auditeurs le croient ou non, personne ne s’oppose au discours. Mais ceci va plus loin car Staline, profitant d’une source en la personne de la fille de Hammerstein, Helga, amoureuse d’un Juif polonais au service du NKVD. L’invasion de 1941 est donc tout sauf une surprise, y compris dans son exécution la plus brutale. Mais en réalité le discours d’Hitler puise dans un fond encore plus profond, en 1924 avec Mein Kampf, traduit en russe et connu avant la guerre, et même encore plus loin.
Une guerre rêvée par un homme
Ce chapitre vise à trouver les racines les plus anciennes de l’opération, non tant d’un point de vue opératif que dans sa singularité idéologique visant à la destruction totale de l’adversaire, civils et militaires. Ce glissement est perceptible en suivant le fil sinistre d’un antisémitisme profond d’Hitler, dont les racines sont elles-mêmes complexes. Petit à petit se noud également une haine du marxisme, du bolchevisme, dans le contexte des troubles de l’année 1919 et de ses suites, au cœur de la Bavière et de Munich. L’élément le plus intéressant est souligné par Jean Lopez avec brio : comme la droite traditionnelle allemande, Hitler est dans un premier temps plutôt russophile. La haine se dirige vers le Diktat de Versailles, les Français, les Bolcheviques et, surtout, les Juifs.
Second axe clé, l’expérience tirée de la guerre entre 1914 et 1917. Cette dernière offre une grille de lecture allemande assez biaisée quant à ses conclusions : séries de victoires à l’image de Tannenberg dès 1914, effondrement russe de 1917 où la guerre se joue à grand coup de voiture et de trains, avec une aisance particulière où l’on fait des prisonniers à tour de bras. Surtout c’est la découverte pour de nombreux futurs acteurs, soldats et généraux, d’une Russie qui est pauvre, sous-développée, arriérée, loin d’être celle fantasmée des grands intellectuels russes dont les auteurs trônaient en bonne place sur les étagères des esprits les plus cultivés de l’Allemagne. Jean Lopez montre ainsi comment l’échec du projet colonial de Ludendorf nourrit un fond de pensée clé : en Russie, seule la terre peut être germanisée. Le reste n’est pas assimilable or, ce reste, ce sont les Russes. C’est aussi dans cette perspective qu’il faut comprendre la notion de « raum », littéralement cet « espace vide » qu’il faut remplir. Hitler prend la mesure de cette approche spatiale, de cette nécessité de contrôler des régions clés par leurs ressources comme le Caucase ou l’Ukraine, ce qui impactera fortement le plan de Barbarossa.
Si l’on doit minorer le poids de Haushofer dans la construction nazie, un autre acteur prend une importance décisive dans la construction du mythe judéo-bolchevique : l’extrême droite russe présente à Munich au début des années 1920. Cette association est le legs unique de cette famille politique à Hitler, mais un legs décisif. Ainsi, avant Mein Kampf, Hitler publie un article suggérant en 1924 la possibilité de conquérir la Russie, contre l’approche traditionnelle de la droite allemande, mais plus encore, en 1922, lors de discours enflammés, insiste-t-il sur la nécessité de combattre avec toute la force nécessaire les Juifs, rendus responsable de la révolution de 1917, elle-même à l’origine de purges des élites russes.
C’est ici que l’on retrouve la mise en place d’une logique propre à Mein Kampf, œuvre dont Jean Lopez rappelle, à la suite des travaux de Othmar Plöckinger qu’elle a été, contrairement à ce que l’on dit souvent, lue en profondeur par beaucoup plus de personnes que quelques dizaines de milliers de fanatiques d’Hitler. Or que retenir de cette logique ? D’abord que l’antisémitisme doit être mené à son terme le plus radical, ce qui inclut la destruction du bolchevisme. Cette approche pourrait s’inscrire dans une grille de lecture intentionnaliste et poser question. Pourtant, dans la suite de l’ouvrage Jean Lopez parle plutôt dans le cadre d’avant guerre comme d’une vision quasi utopique, l’extermination de masse relevant de logiques plus tardives et opérationnelles qui seront abordées plus tard. En tout état de cause ces approches ne semblent pas totalement intentionnalistes mais le débat reste ouvert. Ensuite cette invasion répond aussi à une approche spatiale visant à s’assurer des ressources, un espace, donc à des ressorts géopolitiques dans lesquels l’obsession de la faim et de la quête de terre, que l’on retrouve chez Ratzel. Enfin que cette quête doit aussi permettre une sorte de guerre permanente, les auteurs faisant le parallèle avec la « frontière » américaine, pour offrir à des générations d’hommes le lieu pour devenir des guerriers.
L’opposition existe néanmoins chez certains nazis ; ainsi Goebbels n’est pas totalement convaincu, jusqu’à la fin, par ce projet. Dans la droite plus traditionnelle c’est encore plus clair et c’est d’ailleurs là que se trouveront les ultimes personnes à s’opposer à Barbarossa.
Solitudes soviétiques
Les auteurs explorent ici les relations complexes qu’entretiennent Allemagne et pouvoir soviétique au cours des années d’entre deux-guerres. Chose parfois peu mise en avant, le temps est d’abord celui des rapprochements. Le traité de Rapallo de 1922 en est un exemple clé. C’est la reconnaissance officielle des deux vaincus et pestiférés du premier conflit mondial ; ceci rappelle les approches de Bismarck, favorable à un rapprochement avec la Russie, et entretient dans un premier temps la haine et la volonté commune d’ne finir avec la Pologne renaissante. Cependant un premier accroc à ce rapprochement pousse Moscou à se sentir plus seule : le traité de Locarno qui fait entrer l’Allemagne dans la SDN. De là se nourrit petit à petit, au rythme des tensions plus vives avec Londres, la crainte d’un isolement total de Moscou. C’est en 1927 la psychose d’une guerre que l’on pense alors très proche. Ceci a trois effets que Jean Lopez souligne avec force. Tout d’abord les Soviétiques basculent dans une économie de guerre qui offre à l’URSS entre 1928 et 1941 la plus grande armée au monde. Ensuite Staline est convaincu qu’il faut pousser à rompre cet isolement. C’est ainsi que Livitnov devient le personnage clé d’un rapprochement avec les Nazis jusqu’en 1938. Enfin c’est le grand tournant de 1928, l‘écrasement des « koulaks », l’industrialisation massive, autant de clés de compréhension de l’échec de l’opération Barbarossa.
Moins connu et pourtant élément essentiel des opérations militaires de 1941, la Reichswehr et l’Armée Rouge ont entretenu pendant des années une réelle proximité. Il s’agissait pour les cadres soviétiques d’apprendre aux côtés d’officiers expérimentés et d’une école de guerre germanique reconnue, et pour les Allemands vaincus de profiter d’infrastructures en URSS, pour travailler dans les domaines de la guerre chimique ou encore de l’aviation. Ainsi la base de Lipesk a servi aux allemands pour travailler la technique des bombardements en piqués. Nombreux furent les officiers aux commandes de l’opération Barbarossa qui firent des stages en URSS ; Model, Manstein, Hoth pour ne citer qu’eux. De leurs côtés les Soviétiques ne furent pas en reste, à l’image d’un Toukhachevski même si les conséquences furent inégales. Les Allemands purent y accumuler de l’expérience. Mais, de l’autre côté les purges touchèrent 80% des cadres ayant été en Allemagne du fait de Staline à la fin des années 30, rendant l’expérience bien moins profitable. Dans la même logique l’état de guerre civile, larvée, la famine ukrainienne de 1932-33 sont autant de boulets aux pieds du colosse soviétique à la veille de l’invasion. Le rapprochement se délite petit à petit et en 1934 Von Blomberg place l’Armée Rouge sur la liste des ennemis potentiels.
Ce chapitre brosse au final un tableau assez clair d’une dynamique globale d’un rapprochement inattendu en 1939 entre les deux puissances pourtant destinées à s’affronter clairement dans la dialectique hitlérienne. D’un côté Staline ne parvient pas à saisir Hitler, pas plus d’ailleurs que les Occidentaux. Ce dernier use de mensonges, d’artifices, de séduction, décide seul, laisse peu d’indices ce qui pousse à des erreurs d’analyse. Le chef suprême de l’URSS doit faire face à la menace japonaise, de plus en plus claire en 1931 avec la création du Mandchoukouo qui fragilise la Sibérie, et le rapprochement marqué à partir de 1934 entre Berlin et Varsovie. C’est pour l’historien Sergueï Slutch un angle de compréhension fécond. Entre 1934 et 1939, ce rapprochement permet de mettre un coin entre Varsovie et paris, et d’assurer à Hitler une frontière orientale sécurisée tout en menaçant clairement l’URSS d’une attaque. Staline en prend d’ailleurs la mesure avec le rapport Vorochilov dès 1934. Pour la Pologne, qui n’ira jamais jusqu’au bout de la vassalisation voulue par Hitler, l’invasion étant vécue comme forcée par les événements, c’est le double jeu : soutien à Hitler en 1938 dans l’affaire de Sudètes, mais refus de s’allier totalement en rejoignant par exemple le pacte anti-Kominterm de 1936, contrairement au Japon ou à l’Italie. De son côté Hitler échoue dans son plan d’un rapprochement avec le Royaume-Uni, le plus cinglant étant la garantie des frontière polonaises au printemps 1939 après l’invasion de la Tchécoslovaquie en mars, ce qui pousse Berlin vers le plan Blanc actant l’invasion de la Pologne. Jusqu’au bout Hitler a cru pouvoir rallier à la fois Varsovie et Londres pour s’assurer une fenêtre d’invasion sur l’URSS. Un tel cas de figure aurait rendu possible Barbarossa dès 1939, avec des conséquences incalculables pour une URSS plus faible qu’en 1941. Mais pour l’heure Staline peut jouer des divisions du « camp des impérialistes » pour aller dans le sens d’un rapprochement spectaculaire.
Le pacte
L’approche des auteurs est ici assez simple : poser les faits dans un premier temps puis répondre à cette sulfureuse question. À l’heure où sont écrites ces lignes le parlement européen ne vient-il pas de prendre le temps de réfléchir à désigner ce pacte comme capital dans le processus menant au second conflit mondial ?
Dans un premier temps c’est un ménage à trois qui est envisagé au début 1939 : Paris, Londres et Moscou ; c’est l’échec du fait des réticences de Varsovie. Ceci débouche alors sur une approche à trois, Varsovie remplaçant Moscou dans l’équation. Le but reste alors le même, à savoir pousser Hitler à renoncer à une attaque. Dans cette perspective Staline craint que les Baltes laissent les Nazis se rapprocher de Léningrad et, le Vodj préfère donc négocier avec Paris et Londres dans le sens d’une protection mutuelle. Les Occidentaux qui se méfient plus du dictateur soviétique que de Hitler laissent trainer les choses. Le mois de mai 1939 acte une évolution des approches : Hitler finit par renoncer à son rêve de se rapprocher de Londres, prenant enfin la mesure de l’hostilité de Londres. En découle l’invasion assumée de la Pologne et, partant, le rapprochement avec Moscou. Pour Staline le réalisme va de pair avec le cynisme, même s’il ne semble pas comprendre le fossé profond entre les démocraties et le régime Nazi. Quant aux Occidentaux, le rapprochement acté par Ribbentrop et Molotov a tout d’une catastrophe.
Quels sont les gains pour les deux acteurs que tout semble opposer ? Pour Hitler la guerre à l’ouest sera assurée par une URSS neutralisée sur ses arrières. Mais le prix à payer est une méfiance accrue de Japonais se sentant trahis, ce qui rendra impossible la double attaque contre l’URSS au moment de Barbarossa. Dans ce cadre, le Japon et l’URSS signent un pacte de non agression en avril 1941 qui est une catastrophe pour les Allemands, un juste retour de la trahison germanique vu du côté nippon. Le Duce non prévenu, ce dernier refuse également de s’engager face à la Pologne. Pour Staline le prix est aussi un Janus implacable. Au crédit de ce rapprochement la formation d’un glacis de plusieurs centaines de kilomètres avec l’invasion des pays Baltes, ce qui sauve Leningrad à court terme. Mais ceci pousse aussi toutes les petites puissances dans les bras de Berlin ; Finlande, Hongrie, Roumanie ou encore Slovaquie sont en effet effrayées par les appétits de Moscou. Enfin, malgré les apparences de rupture, Staline n’insulte pas l’avenir et garde contact avec Londres, au cas où.
L’invasion de la Pologne est capitale pour comprendre Barbarossa, comme il en est question plus tard dans l’ouvrage. Concernant les faits immédiats de la fin d’été 1939, Staline attend, en quête d’une excuse valable pour ne pas être un agresseur. La réalité est cependant claire et le 17 septembre, au nom des Ukrainiens et des Biélorusses, l’Armée Rouge se lance dans une opération chaotique devant ce qu’il reste de l’armée polonaise. Les contacts entre la Wehrmacht et l’Armée Rouge sont cordiaux. Les Soviétiques sont peu impressionnés, les Allemands voient d’excellents chars mais des hommes indisciplinés et sans imagination. En fait chacun se conforte dans sa supériorité supposée.
L’aventure finlandaise est aussi l’occasion pour Jean Lopez de rappeler des faits assez peu mis en valeur. À la base se retrouve l’idée de Staline de repousser une frontière qui est à 35 km de Leningrad, ce que le Maréchal Mannerheim refuse alors même que le Vodj est prêt au compromis. La guerre s’impose donc comme une évidence le 30 novembre 1939, d’autant que l’adversaire finlandais est totalement sou estimé. Les rapports sérieux laissés de côté, à l’instar de ceux de Voronov, élément que l’on va retrouver à plusieurs reprises avant Barbarossa, pour ne pas déplaire à Staline. Le désastre militaire est total au regard du rapport des forces engagées, ce qui trouve une réponse toute stalinienne dans un vaste mouvement de purges. En janvier le général Timochenko est nommé et le front finlandais est enfin percé. Qu’en retenir ? Pour les Occidentaux c’est bien la preuve de la faiblesse soviétique en dépit des gages territoriaux finalement obtenus par Staline. La Finlande bascule définitivement dans l’orbite allemande, ce qui sera un appui de taille au moment de Barbarossa. Le désastre s’explique autant par Staline que par le manque total de professionnalisme d’une Armée Rouge alors même que l’armée allemand semble au zénith après l’écrasement de la France entre mai et juin 1940. Dans la seconde moitié de l’année 1940 Timochenko, devenu maréchal d’Union soviétique suite à sa victoire, tente de mettre en place une vaste réforme de l’Armée Rouge, sans effet réel sur Barbarossa.
La décision d’attaquer
Nous entrons enfin dans le cœur du sujet. Les chemins explorés ici montrent combien Staline tente par tous les moyens de repousser, à tout le moins, une attaque nazie en s’engageant dans une aide massive du régime nazi. Facilités de transport, restitutions de navires, les approches sont multiples. La collaboration économique est réelle : les Allemands offrent ainsi la possibilité aux soviétiques de rattraper leur retard dans le domaine de l’aviation. Pour Moscou les gains sont évidents lorsque, profitant de l’effondrement français du mois de juin 1940, les pays baltes sont annexés. Mais le plus intéressant reste à venir : la défaite française pousse Staline dans une colère noire, lui qui s’attendait à un conflit destructeur et long entre capitalistes. La méfiance grandit face à Hitler : la clé reste un soutien économique pour éviter tout rapprochement avec Londres. L’expansionnisme vers la Bucovine et la Bessarabie n’est pas poursuivi jusqu’à Ploesti et son pétrole. Ceci aurait privé Berlin d’une ressource rare et précieuse ; en attendant la Roumanie rejoint l’approche finlandaise d’une satellisation nazie.
Dès le 21 juillet 1940 ordre est donné de préparer un plan pour envahir et détruire l’URSS. L’historien explore le flou stratégique de l’été 40. Hitler ne comprend pas l’entêtement de Churchill et le soutien affiché par Roosevelt impose une impasse. La réponse du führer est alors d’attaquer l’URSS pour briser la volonté de Londres de poursuivre la guerre d’où cette demande de plan. Cependant la décision d’attaquer n’interviendra que le 18 décembre. Quant au plan le personnage clé en est Halder, le chef d’état-major adjoint de l’armée de terre, l’OKH. Jean Lopez creuse un sillon majeur : celui de la sous estimation totale des soviétiques, en dehors de l’aviation. L’attaque est envisagée dès l’automne, sans réelle préparation. La géographie la plus basique, celle des distances, est minimisée voire ignorée. Le plan de Halder est simple et s’inscrit dans la tradition de Schlieffen : foncer sur Moscou puis obliquer à 90° vers la Mer noire.
Le 31 juillet 1940 se tient une réunion clé : la campagne est repoussée au moi de mai 1941 et 5 mois sont envisagés pour écraser l’Armée Rouge. Suivant cette approche, plusieurs hypothèses de travail sont formulées, les plans Marcks 1 et 2, le plan Lossberg, le plan Sodenstern dont il est possible de trouver 6 clés communes retenues pour Barbarossa. Une triple poussée, un lieu clé de bataille décisive au-delà du Dniepr, un calendrier délirant, une sous-estimation des soviétiques, le refus de croire que ces derniers pourraient ravager leur terre et le choix d’une logistique routière, alors même que ces espaces sont dépourvus de routes correctes. Finalement c’est le général Paulus qui est choisi pour en tirer une synthèse en appui de Halder au début septembre. Dans le même temps le durcissement se précise face à Moscou avec les rapprochements de la Finlande et de la Roumanie qui posent les bases géographiques de Barbarossa.
Qu’en est-il du poids des opérations en Méditerranée ? Tout d’abord que ce soit du point de vue de Halder ou de Brauchitsch, le chef d’état major de l’OKH, frapper l’URSS n’a pas de sens si le Royaume Uni n’a pas été vaincu. Pour eux la clé est bien le théâtre ouest et ce d’autant plus que l’Italie pourrait bien connaître les pires difficultés en Méditerranée. Ainsi le général Jodl qui devra planifier Barbarossa, privilégie le théâtre méditerranéen pour sécuriser l’Italie, le pétrole du Golfe persique, la Turquie, approches communes au grand amiral Raeder. L’historien pousse l’analyse encore plus loin avec le projet de Ribbentrop visant à inclure l’URSS dans un vaste bloc continental. Dans cette perspective Molotov est convié à Berlin afin de faire pression sur Londres. Mais tous ces faits ne sont rien entre les mains de Hitler et Staline car aucun des deux ne croient à cette approche. Ce dernier persistera à croire que Berlin ne peut se passer de l’aide économique de Moscou tandis que Hitler reste obnubilé par la nécessité de faire plier Londres en attaquant l’URSS.
Au moment de la signature de l’ordre d’attaque du 18 décembre la situation est claire. Halder, mis à part les blindés, brosse un tableau niant toute capacité aux soviétiques de pouvoir espérer résister aux grands encerclements géants, les « kessel », prévus comme autant de batailles décisives, même s’il n’est pas vraiment favorable à l’invasion et que la Wehrmacht n’est pas enthousiaste. C’est donc une combinaison d’un choix stratégique et idéologique de Hitler qui emporte la décision.
De l’art de se tromper
Si la guerre arrive demain
Jean Lopez offre au lecteur de découvrir comment, pour la propagande du régime, le cinéma et la science fiction sont convoqués pour rassurer le peuple soviétique à la veille de la guerre. Ainsi le film dirigé par Efim Dzigan « Si demain la guerre » (1938) et le roman d’anticipation « La première frappe » de Chpanov (1939) sont deux monuments du genre. Quoiqu’il puisse se passer l’URSS est prête et écrasera l’agresseur parce que le projet soviétique est supérieur, tout simplement. C’est donc un pays totalement bercé d’illusion qui va voir déferler sur lui des forces nazies qui ne viennent pas envahir un pays, mais le détruire.
Recette allemande pour une catastrophe
L’historien porte un regard critique sévère sur une approche longtemps admise : Barbarossa aurait échoué de peu. La démonstration est tout autre à l’épreuve des faits et de la recherche. Barbarossa a échoué de beaucoup et les erreurs, dans les deux camps, ont été énormes à tous les niveaux. Contrairement à ce qui a été défendu après la guerre par les généraux d’une Wehrmacht désireuse de faire porter toutes les responsabilités sur Hitler, le plan de Halder de foncer sur Moscou n’avait quasiment aucune chance de réussir. La solution de Hitler était de foncer sur les pays baltes et le Donbass, Moscou étant secondaire à ses yeux. Barbarossa est la synthèse des deux approches et comporte donc un vice initial entre deux visions opposées. Le plan d’Hitler répondait à une approche stratégique cohérente selon Jean Lopez : viser la Baltique afin d’en faire un lac nazi une fois Leningrad tombée. Ainsi le ravitaillement était assuré pour une seconde phase de conquête visant Mourmansk, donc la coupure de l’artère avec les alliés occidentaux, et de Moscou. Hitler cependant ne parviendra pas à prioriser et sera toujours tenté de courir plusieurs objectifs à la fois, comme la recherche de la mainmise sur l’Ukraine. Ceci, en plus des conceptions raciales du Führer expliquent les ambiguïtés d’un plan portant en lui les germes de l’échec.
La réalité opérationnelle, niée pour l’essentiel, est celle d’un cauchemar logistique. Les officiers allemands le savaient depuis la première guerre mondiale et de nombreux rapports, études parues depuis l’été 1940. Mais, la conception culturelle d’une guerre à grand coup de bataille décisives et donc courte fait de la logistique un élément secondaire. Ainsi est-on surpris de découvrir que l’Allemagne a moins de locomotives en 1941 qu’en 1914 ! Ceci ne doit pas poser de problème, la campagne en France l’a démontré. Mais en France les routes étaient excellentes et le théâtre d’opération quatre fois plus petit. On ne voit pas dans la multiplicité des camions pris aux Français un problème, alors même que très vite les pièces détachées viendront à manquer. De la même façon l’équipement reste médiocre : les blindés allemands sont à peine plus nombreux qu’en France et, pour l’essentiel, de faible qualité quant au blindage ou aux canons. Il y a moins d’avions qu’en France, pour un espace quatre fois plus vaste à couvrir. Le renseignement est correct sur 300 km en profondeur, grâce aux reconnaissances aériennes, mais pour le reste, il est très insuffisant.
Le pire est ailleurs : sans tenir compte des leçons du passé, le Soviétique est nié quant à sa capacité à apprendre. Le credo est simple : le judéo-bolchevisme va s’effondrer. Pourquoi tant de certitudes ? Les officiers supérieurs ont connu la guerre de 1914-1918 et ses accélérations finales pour une victoire face à des adversaires au mieux paysans rustres. Les purges de 1937-1938 ont nécessairement décapité l’Armée Rouge et la Finlande a confirmé la nullité des soviétiques face à une petite armée finlandaise.
Se pose la question du poids des opérations dans les Balkans au printemps 1941 comme élément de l’échec de Barbarossa. Les campagnes en Yougoslavie et encore plus en Grèce ont démontré les failles logistiques allemandes, sans que cela ne serve vraiment de leçon. Mais le retard supposé dans le déclenchement de Barbarossa n’est pas établi : la météo n’était pas favorable en mai et, de toute façon, la logistique n’était pas prête. On peut mesurer pour les historiens un impact négatif sur le front ukrainien, frappé par les forces engagés en Grèce par exemple, ce qui empêchera la destruction du front Sud par des troupes amoindries.
Quant aux alliés, ils sont accessoires pour Hitler. La Roumanie est faible, la Hongrie et la Slovaquie se méfient surtout l’une de l’autre, la Finlande joue sa partition. Enfin reste le cas du Japon ; comme signifié plus tôt depuis le pacte germano-soviétique, la méfiance est totale. Qu’importe, cette guerre est celle d’Hitler.
Recette soviétique pour un désastre
Barbarossa est avant tout l’histoire d’un immense échec conduisant à un massacre sans commune mesure. Après avoir exploré les failles allemandes, Jean Lopez nous plonge dans les arcanes soviétiques où Staline est loin de porter, seul, le poids des responsabilités. Tout d’abord le constat est paradoxal : dès les années 1930 l’Armée Rouge est devenue la première armée au monde, en nombre et matériel. Elle dispose du meilleur armement intellectuel, l’art opératif, et objectivement d’un matériel, blindé notamment, supérieur quantitativement et qualitativement aux panzers.
L’approche classique revient à faire porter l’échec aux conséquences des purges de 1937-1938. Il semble que plus que de masse, il s’agit avant tout d’une perte de qualité et d’expérience, ce qui est minimisé par une majeure partie de l’historiographie. Ceci explique pour partir l’effondrement moral dès les premières semaines de l’invasion. Ces purgent ont un effet collatéral majeur : Staline a distillé une peur absolue qui inhibe les officiers, alors que les programmes de modernisation accouchant des T34 pour les blindés, ou de Pe2 pour l’aviation d’assaut, prennent du retard. En effet des hommes de premier plan comme Fock ou Landau restent ainsi pourrir dans les geôles staliniennes de longs mois avant d’être libérés sous la pression de Piotr Kapitsa, futur Nobel. Pourquoi ces purges ? Pourquoi avoir décapité non seulement le commandement mais aussi la recherche de pointe ? L’explication avancée par l’historien est classique : Staline désire avant tout écraser dans l’œuf toute possibilité de sédition. Effet collatéral ces purges maintiennent les observateurs extérieurs, particulièrement les Allemands, dans une représentation biaisée d’une Armée Rouge qui ne demanderait qu’à s’effondrer aux premiers jours de la guerre.
Autre aspect de la catastrophe, la folle explosion des effectifs à partir de 1928 où l’on passe de 585000 hommes à environ 5 millions à la veille de l’invasion. À ceci s’ajoute une croissance exponentielle d’un matériel toujours plus complexe nécessitant une formation accrue alors même que l’encadrement de qualité est fauché par les purges. L’approche stalinienne est ainsi purement idéologique et se coupe de toute culture militaire cohérente. Si les officiers supérieurs conservent un bon potentiel à l’image d’un Joukov, nombreux sont les officiers et sous-officiers à ne pas savoir lire des cartes. Alors même que les Allemands se concentrent sur un noyau d’élite à la recherche de la bataille décisive, les soviétiques sont moyens partout, divisent leurs efforts. Le niveau d’instruction moyen peine à atteindre celui de CE2, ce qui explique l’incapacité à lire une carte ou à utiliser des moyens de transmission corrects. L’idéologie est aussi à la base de la rétribution : un officier de l’Armée Rouge est moins bien payé qu’un ouvrier contremaître. Alors que le matériel disponible est d’excellente qualité, que toute l’industrie est tournée vers la guerre par Staline, la faillite humaine est quasi générale.
Dans la réflexion pour moderniser l’Armée Rouge le maréchal Toukhatchevski, finalement victime des purges de 1937, tient une place majeure. Il est à l’origine de l’accroissement presque délirant de la production de blindés : de 74 chars en 1927, on passe ainsi à 8200 en 1936. L’influence du maréchal se ressent dans l’idée de constituer des corps mécanisés censés emporter la décision sur le champ de bataille. Or là encore le nombre ne fait point la qualité. Les manœuvres de 1936 ressemblent plus à un show selon l’historien, qui explore la piste de trucages généralisés en citant divers témoignages d’officiers d’époque. Autres sources de problèmes à venir, les erreurs de lectures des campagnes espagnole, polonaise ou française. Tout est lu par le prisme idéologique d’un effondrement de soldats capitalistes là où les ouvriers socialistes seront nécessairement meilleurs. À la veille de Barbarossa aucun des chefs de corps mécanisés ne disposent encore de l’expérience et de l’encadrement nécessaire à la guerre moderne, même si les matériels comme les T34 ou KV1 sont supérieurs, et de loin, à ce que les Allemands vont leur opposer au moment de l’invasion.
Quant à l’aviation les paradoxes sont encore plus éclairants. Le ratio est de 1 à 4 en faveur des ailes rouges. Mais, aggravé par les purges entrainement, doctrine et commandement sont totalement défaillants. En Finlande, face à 145 avions, les 1500 ailes rouges font pâle figure et les « Faucons de Staline » perdent 600 des leurs. Les modèles I16 et I153 sont dépassés, les retards sur les Mig3, Lag3 et Yack1 sont trop importants, particulièrement dans le domaine de la motorisation, sous dimensionnée. Peu d’heure de vol, des tactiques dépassée : pour la Luftwaffe c’est un tir au pigeon qui s’annonce. Cependant la base industrielle est là et les Soviétiques, contrairement à ce que pensent les Nazis, apprendront vite.
L’historien revient enfin sur un élément clé de la fin de la guerre et les succès immenses de l’Armée Rouge entre 1944 et 1945. L’art opératif, celui de la bataille en profondeur, par une succession de coups orchestrés pour un effondrement du dispositif adverse sur des centaines de kilomètres. Avec cette approche, héritée de la Première Guerre mondiale, les Soviétiques offrent à l’art de la guerre une contribution révolutionnaire. Pour les Allemands, l’approche est culturelle, quasi génétique à leur vision de la guerre. Il faut percer, vite, écraser avec une violence extrême, pour obtenir une batille décisive et donc une guerre courte. La synthèse de cette pensée débouche sur le char de rupture. Pour les soviétiques la lecture du premier conflit mondial est toute autre. Au regard des capacités industrielles des États, la guerre sera longue. Il faut donc penser une nouvelle articulation, ce que s’évertue à faire Alexander Sviétchine qui invente le concept d’art opératif en 1924 que Gueorgui Isserson résumera à son tour par les mots suivants : « l’opération est une arme de la stratégie, la stratégie est une arme de la politique ». Mais entre la théorie, brillante, et l’application, il y a un gouffre que les purges de Staline n’expliquent pas totalement. L’art opératif est un art de la profondeur qui nécessite, à tout le moins de savoir lire une carte ce qui est rare dans l’Armée Rouge de 1941 …
À la veille de Barbarossa les Soviétiques s’échinent ainsi à penser des plans de batailles irréalistes, basés sur l’offensive et la contre-attaque foudroyante. Même si Isserson explique dès 1940, à la lumière des premières campagnes allemandes, que la guerre à venir sera immédiatement violente et totale, les schémas dominants restent ceux hérités du passé. La guerre verra un moment de mobilisation générale plus ou moins long, comme en 1914, ce qui laissera le temps de monter une contre attaque en profondeur au cœur de l’Allemagne. Si la France et la Pologne ont été vaincues c’est par faillite morale, ce qui va de pair avec le capitalisme. Pire, les officiers supérieurs comme Timochenko ou Joukov se trompent sur quasiment tout : les forces de l’Axe, les lieux d’attaque, le temps de mobilisation, nourris par les délires « gigantomaniaques » de Toukhatchevski. Les erreurs sont donc collectives et pas simplement imputables à Staline.
Ordres criminels
Assurément l’un des moments majeurs de cette étude. Après guerre les généraux allemands ont tout fait pour nuancer voire nier le caractère meurtrier de la Wehrmacht, faisant porter les crimes de masse aux SS et à Hitler. Loin de s’inscrire dans une logique intentionnaliste, Jean Lopez montre combien si « Mein Kampf » a pu poser des bases utopiques à la destruction de masse de population, c’est bien un glissement progressif qui s’est opéré et, par-dessus tout combien la culture de guerre allemande en œuvre chez les généraux et la troupe régulière a accompagné ce mouvement terrifiant.
Tout commence le 30 mars 1941 lors d’une vaste réunion des principaux acteurs de Barbarossa. Hitler y expose clairement, une nouvelle fois, sa conception de guerre raciale, d’extermination, de violence absolue. Les sources sont les carnets de note des généraux Hoth et Halder. En réalité tout ce qui est dit par Hitler l’avait déjà été par le passé, par exemple en 1939. Rien n’est donc surprenant et personne, dans l’auditoire, n’est surpris. La réalité est donc bien celle d’un antibolchevisme et d’un antisémitisme total chez ces officiers, comme en témoigne un extrait d’une brochure de l’OKW de février 1939, destinée à la troupe.
L’angle d’attaque de l’historien est donc celui d’une exploration fine de la culture de guerre allemande portant à ses yeux, bien plus que le racisme d’Hitler, les bases des massacres à venir. Il suit dans ce sens les analyses de Isabel Hull et le concept de kriegsnotwendigkeit, la nécessité militaire. Selon cette approche, que l’on retrouve en dans le Sud-ouest africain allemand au début du XXe, mais aussi lors de la révolte des Boxer en 1900-1901, en France en 1870 ou encore en Belgique en 1914, les forces allemandes font montre d’une violence extrême contre les civils afin de couper court, ou de prévenir tout risque de guérilla sur les arrières. L’essentiel des forces est destiné au combat pour une victoire rapide, il reste trop peu de troupe à l’arrière pour sécuriser donc il faudrait agir avec une violence totale pour limiter les risques d’insurrection par la peur. Dans ce cadre l’idéologie nazie serait venue démultiplier une culture déjà largement ancrée dans la tradition militaire allemande.
Ceci posé, la Pologne offre dès septembre 1939 une idée de ce qui sera appliqué avec encore plus de férocité lors de Barbarossa, sans qu’aucun officier supérieur ne puisse avoir été au courant. Dans le sillage d’une psychose du franc-tireur et de la volonté de détruire un État, la Wehrmacht participe aux massacres perpétrés par les SS et les Einsatzgruppen. La singularité polonaise tient au fait que la destruction systématique des Juifs n’est pas demandée. Pour le reste, suite à l’arrangement entre Heydrich et l’OKH de Brauchitsch par l’entremise du général Wagner le 13 mars 1941, la SD et les Einsatzgruppen auront la charge de nettoyer l’arrière. Les ordres sont limpides, les officiers supérieurs savent tout de la demande de destruction systématique de civils. La logique est mettre en perspective avec deux faits : 143 divisions pour détruire l’URSS, c’est très peu, d’autant qu’il faut gagner vite et chercher de ce fait la bataille décisive. Il semble donc nécessaire et logique pour ces officiers de pratiquer une politique de terreur. Ceci est confirmé par les directives adressées dès mars 1941 aux tribunaux militaires, exonérant de fait la troupe des crimes de violence contre les civils. Ceci est une approche clé pour comprendre la violence, violence qui sera encore plus systématique contre les commissaires politiques. À ce terreau déjà propice aux pires exactions s’ajoutent un guide qui diabolise les Russes distribué à la troupe et une planification de famine qui, si elle n’a pu aller au bout de sa logique, n’en a pas moins coûté la vie à 4 à 7 millions d’être humains selon les études des historiens Christian Gerlach et Timothy Snyder cités par Jean Lopez.
Reste le cas de la politique anti-juive. La destruction est perçue par l’historien comme une utopie dans Mein Kampf, ce que confirment les différentes mesures prises par Hitler, Himmler et Goring entre 1933 et 1939 (spoliation, isolement, émigration). On retrouve même trace avec Eichmann de tentatives d’accords avec les Soviétiques pour expulser des Juifs dans les territoires polonais. C’est donc bien la thèse d’un glissement progressif qui est défendu, vers le meurtre de masse après Barbarossa.
Staline sourd et aveugle ?
C’est un point marquant de l’étude des réflexions de Staline. Pourquoi, alors que tous les signes montrent que l’attaque est imminente, avec par exemple des rapports précis du 17 juin, pourquoi la surprise semble aussi totale au point de déstabiliser le vodj. Dans un premier temps l’historien rappelle qu’il faut se garder de toute conclusion hâtive car nous connaissons la fin, ce qui n’était pas le cas des acteurs. D’ailleurs tous se sont trompés.
Plusieurs aspects sont à prendre en compte. Tout d’abord le biais idéologique systématique pris par Staline qui voit dans Churchill un adversaire plus sérieux car capitaliste. Ensuite il y a une logique militaire : les Allemands n’attaqueront pas car ils ne commettront pas l’erreur d’ouvrir un second front. Staline pense également jusqu’au bout que l’aide matérielle et économique offerte à l’Allemagne est indispensable à cette dernière. En réalité il semble ignorer ou laisser de côté le fait que Hitler ait juré la destruction de l’URSS et qu’il a toujours menti et attaqué par surprise.
La priorité des priorités du dictateur reste la sécurité interne : un État policier, un renseignement de l’intérieur, une police à ses ordres. Les analyses qui remontent ne sont pas discutées, contrairement à ce qui se passe à la même époque au Royaume-Uni. La peur de déplaire au chef suprême, le prisme purement idéologique, l’absence de débat, autant de pistes pour comprendre les défaillances dans un renseignement disposant pourtant de tous les éléments. Ainsi Jean Lopez cite-t-il fort à propos le cas des rapports de mai 1941, où des soldats allemands multiplient les raids pour voler de l’essence afin de la tester sur les moteurs de la Wehrmacht, dans l’optique de palier aux pénuries d’une offensive en profondeur. Hitler sait aussi jouer à plein de la désinformation, tandis que la confusion est entretenue avec l’affaire Rudolf Hess dans laquelle Staline voit le début d’un rapprochement entre Londres et Berlin. Le dernier rapport sur lequel le maître du Kremlin pet s’appuyer est daté du 31 mai sous la plume de Golikov. Les erreurs d’analyse sont nombreuses et de toute façon les remontées des agents prévoient une attaque depuis la fin de l’année 1940, ce qui limite l’impact des ultimes signaux d’alerte. Staline pense avoir le temps, joue l’apaisement jusqu’au bout sans comprendre que les enfers sont prêts à se déchainer.
L’URSS un genou à terre
Prélude – « J’ai honte devant mon père parce que je suis resté en vie »
L’analyse de l’invasion à proprement parlé débute par le récit de l’interrogatoire du fils ainé de Staline, Yakov Djougachvili, dont de larges extraits sont retranscrits ici. Cette source, disponible depuis 1992, est de première qualité car elle permet de mesure le chaos, la panique, les folles rumeurs ayant cours dès les premiers jours de Barbarossa du côté soviétique. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir que la guerre contre l’ennemi judéo-bolchevique voulue par Hitler bute sur des failles abyssales. Le fils de Staline est lui-même clairement antisémite, et les Juifs sont très loin de constituer l’épine dorsale du système soviétique.
Dimanche 22 juin 1941, le jour le plus long
Après avoir exploré les racines profondes de cette opération, Jean Lopez explore plus avant les situations purement militaires, sans pour autant sombrer dans une histoire bataille à l’ancienne. Le propos est toujours clair, accessible, et la mise en perspective historique pertinente.
Dans un premier temps Staline refuse de croire à une invasion réelle, penchant pour une mise sous pression ou un coup de bluff. Pourtant les signaux remontent du terrain et certaines mesures sont prises pour faire faire à l’imminence de l’attaque. Cependant la pauvreté des transmissions, les sabotages divers font leur œuvre et les forces placées aux frontières encaissent pour l’essentiel un choc absolu sans réelle préparation. C’est à reculons que Staline s’engage dans la guerre, signifiant son désir de réagir par une riposte limitée dans les premières heures de la guerre. Quant à Hitler, la porte ouverte sur les enfers s’accompagne d’un message mensonger à la troupe, justifiant l’attaque par les supposées agressions soviétiques. Les pièces sont en place pour le désastre.
L’historien s’applique à une analyse des trois fronts de façon successive, ce qui permet de suivre au mieux les opérations. Ainsi commence-t-il par évoquer le cas du front lituanien. L’Armée Rouge est supérieure dans tous les secteurs en nombre, mis à part les fantassins. Mais peu préparée, mal commandée, à l’image du général Fiodor Issidorovitch Koutznetsov, bureaucrate « rejeton du monde stalinien », incapable d’initiative, obsédé par l’espionnage, la recherche de complot, la peur de la trahison et de déplaire à Staline, l’Armée Rouge est pulvérisée. En face von Leeb, un officier à l’ancienne, non formé au combat blindé, monarchiste, chrétien peu en phase avec le nazisme, peut compter sur un 4è groupe Panzer de qualité. Cette unité constitue une nouveauté, une armée à part entière, sous commandement de l’excellent général E. Hoepner, très critique envers Barbarossa (trop peu de forces, ennemi trop grand), mais dévoué à ses hommes et superbement secondé par deux subalternes qui feront les beaux jours de la Wehrmacht, Reinhart et Manstein.
C’est au centre que se trouve le gros des forces allemandes, le point névralgique de l’attaque. Il appartient au feld-maréchal von Bock de rechercher, par des encerclements géants, la destruction des forces soviétiques pour ouvrir la route de Moscou. En face la plus grande hétérogénéité est de mise, à tous les niveaux, le meilleur cohabitant avec le plus médiocre, l’auto intoxication idéologique à base de « lutte des classes » suffisant à laisser croire que le plan MP41, qui a eu pour conséquence de masser les forces rouges à la frontière, à portée d’encerclement et de destruction rapide, sera suffisant pour renvoyer les Allemands à Berlin. L’une des clés pour comprendre la percée rapide est bien celle de la surprise. Les Soviétiques restent en effet vissés sur cette idée que l’attaque interviendra en Ukraine, om sont disposées les meilleures unités. Ceci explique la confusion des premières heures, décuplé par l’absence de prise d’initiative dans un système où il est avant tout nécessaire d’assurer ses arrières bureaucratiques pour éviter de partir avec l’eau d’une purge. La première bataille de char de la guerre à l’Est, à Kobryn, est un excellent cas d’école. La 18e Panzer affronte la 30è division blindée. Le commandement soviétique est très vite dépassé, pris d’apathie après une période de panique. Les T26, techniquement dépassés mais dont les canons, de qualité, auraient pu faire beaucoup plus mal aux Panzers attaquent par paquet, sans coordination, sans transmission. On manque de camion pour déplacer les troupes, on se bat sans cohésion, sans sang-froid, sans capacité d’improvisation. Si certaines unités se battent avec une férocité totale, la masse est touchée par la panique générale, l’abandon sur place d’un matériel dantesque. Malgré les avertissements d’Isserson le commandement soviétique n’a pas pris la mesure de cette guerre d’artères tranchées par des lames de Panzer s’enfonçant dans la profondeur pour couper les têtes de commandement. Ainsi les unités sont livrées à elle-même vers une destruction quasi assurée.
En Ukraine la situation est plus compliquée pour les Allemands. C’est ici que se trouvent les meilleures unités soviétiques qui, selon le plan MP41, doivent percer vers la Pologne et l’Allemagne dans une gigantesque contre-attaque. Mais ce sont aussi des forces allemandes qui ont été utilisées dans les Balkans et sont dont le potentiel n’est plus à 100%. Côté soviétique Kirponos offre un commandement de qualité, qui ne panique pas et parvient à presque stabiliser la situation même si un de ses officiers, lui aussi appelé à jouer un grand rôle ultérieur, Rokossovski, pointe du doigt la qualité médiocre des T26 mais, surtout, le manque de mobilité des fantassins. Pour le feld-maréchal von Rundstedt la tâche est donc plus complexe qu’en Lituanie et dans le front Centre. Il s’en acquitte néanmoins avec la froideur d’un technicien hors pair, carriériste absolu, sans pitié pour les considérations morales qui voudraient épargner les civils. Alors que Kirponos a maintenu un corps de bataille cohérent, le 22 juin au soir, tombe la directive 2 de Staline enjoignant d’appliquer le plan MP41. Le chef d’état-major du front, Purkaev, hurle au délire et prévient de la catastrophe à venir, Kirponos et Bagramian lui emboîtant le pas de façon moins véhémente ; mais Staline a parlé.
Après la mort de Staline en 1953, deux approches ont pris le dessus pour expliquer le désastre initial : la surprise et les erreurs du Vodj, dans la droite logique d’une déstalinisation tournant à plein régime. Jean Lopez offre ici un retour sur l’écrasement, au sol puis dans les airs, de la VVS, l’armée de l’aire soviétique. Or que constater ? Que la VVS n’est pas prête du tout, que les erreurs ont été multiples dans toute la chaine de commandement, que les officiers ont été incapables de mettre les avions, regroupés à la frontière, à l’abri, sans parler des retards dans la mise en place des aérodromes, de l’incompétence généralisée dans l’emploi des forces aériennes. Non Staline n’est pas le seul responsable et c’est bien une faillite globale qui emporte nombre de pilotes et de soldats dans un écrasement systématique dès les premières heures. C’est aussi la vision de Churchill, divinement surpris par l’attaque allemande, mais sans réel espoir d’une résistance soviétique efficace, ce qui ne l’empêche pas d’apporter un appui moral dans un premier temps, malgré son anti communisme total. Quant au chef du Kremlin, passé les doutes initiaux, il tient la barre et s’engage assez vite vers une mise en exergue d’un discours patriotique, relayé par Molotov, avec même le soutien de l’Église orthodoxe.
La bataille de frontières 23 juin – 9 juillet
Ce chapitre est très dense du fait de la multiplicité des combats, des lieux, des acteurs. C’est aussi le moment d’aborder les premiers crimes de masse. Que retenir ? Il est possible de dégager dans un premier temps des constantes pour chacun des camps. Pour l’Armée Rouge c’est une succession d’erreurs dues à la médiocrité de la chaine de commandement incarnée par un Fiodor Koutznetsov, à l’absence de liaisons correctes, à la sous formation chronique de forces disposant pourtant d’un matériel de première qualité, à l’image de chars KV1 sacrifiés par des équipages qui ne savent tout simplement pas s’en servir. Côté allemand c’est une course effrénée à la recherche d’encerclements géants où l’on espère anéantir les forces vives adverses. C’est aussi le moment de mesurer les tensions entres généraux, au Nord Hoepner et Manstein à propos de la décision de foncer, ou non, sur Léningrad, au Centre la haine entre von Kluge et Guderian. D’un point de vue tactique les Allemands écrasent des Soviétiques qui se battent parfois avec une férocité réelle, notamment sur le front Sud. Mais ces derniers sont engoncés dans les affres du plan MP41 et des délires de contre-attaques mal pensées, si tant est qu’elles le soient réellement à l’image des différentes tentatives de contre, comme celui de Lepel par exemple.
De cette analyse ressortent quelques traits saillants : le front Nord est pulvérisé par les forces allemandes, Manstein pouvant avancer en 100 h de 360 kilomètres. Riga tombe vite et les portes de Leningrad semblent ouvertes dès le début juillet, même si la cité est encore à plus de 500 km du front. La différence se fait sur une combativité ridicule des forces baltes engagées par l’Armée Rouge, autant que sur la nullité des équipages de blindés ne sachant à peine tirer ou manœuvrer leurs chars. Au Centre se produit le plus grand encerclement aboutissant à la destruction de quasiment quatre armées soviétiques. Le mythe de la résistance acharnée de Brest-Litovsk, vérité absolue depuis les années 1960, vole en éclat sous l’analyse de l’historien. Mais cette course offre aussi des moments de doutes potentiels ; entre une avancée trop rapide des pointes blindées et des chaudrons qui sont difficiles à réduire sans combats acharnés, entre une infanterie qui reste loin des percées, les failles existent. Ainsi en est-il du vaste mouvement d’encerclement Bialystok-Minsk entre la fin juin et le début du mois de juillet. Déjà l’horreur est réelle pour les prisonniers soviétiques, déjà les combats prennent l’allure parfois de combats désespérés qui éreinte la Wehrmacht.
L’analyse de la bataille pour la route de Moscou, espérée comme la bataille décisive selon le plan Barbarossa montre un autre aspect important. Trois villes verrouillent l’artère praticable vers la capitale : Smolensk, Orcha et Vitebsk. Conscient de ce fait, les Soviétiques tentent de faire barrage, ce qui est plutôt bien fait jusqu’au moment où s’impose le plan MP41 et son urgence de vaste contre attaque. La frappe de Lepel tourne alors à la catastrophe et Joukov, analysant les faits après guerre, admet l’incapacité à l’été 1941 pour l’Armée Rouge à monter toute opération cohérente avec du matériel moderne. On retrouve ces approches en Ukraine même si là, malgré les entrées en guerre hongroise et roumaine à la fin juin, avec leurs apports de troupes fraîches (en plus des autres alliés finlandais ou italiens, pour ne citer qu’eux, c’est près d’un million de troupes qui renforcent l’armée nazie), le front est beaucoup plus cohérent. La contre-frappe de Novgorod-Volynski est l’occasion de constater une nouvelle fois la férocité des combats, certaines unités allemandes étant même encerclées et proches de la destruction. Les pertes soviétiques sont immenses, la catastrophe totale. Dans le Grand Nord l’effort germano finlandais peine à se rapproche de Mourmansk, dans des conditions de combat dantesques, mais Leningrad est à 30 km pour les forces finnoises au mois de septembre.
Au-delà des combats, ce qui est particulièrement marquant c’est la guerre annexe menée par les forces nazies et une partie des populations locale. Cette guerre est celle menée contre les Juifs, une sorte de guerre parallèle. Dès les premiers jours les massacres se retrouvent un peu partout sur le front. Les rapports de résistance de points d’appuis soviétiques mentionnent le plus souvent la présence de Juifs parmi les forces, ce qui expliquerait la létalité supérieure pour prendre tel ou tel point, comme une justification future des représailles à mettre en œuvre contre les populations juives. Ici ce sont des populations civiles qui se livrent à des pogroms comme à Kaunas où, entre la fin juin et le 7 juillet ce sont entre 3000 et 5000 Juifs qui sont massacrés. Mais les exemples sont aussi nombreux que les cas de figure : initiative locale, troupes alcoolisées, réponse à une attaque de partisans ou de supposés partisans tout est passé au crible et glace d’effroi. Sokal, Bialystok, Lvov, parfois avec l’aide de la population locale, parfois du fait de Einsatzgruppen avec l’assentiment de Heydrich, la liste s’allonge tout au long de l’été 1941. La hiérarchie se radicalise et la troupe est au diapason d’un cycle de destruction qui s’accélère et fait de moins de moins de distinction entre hommes, femmes, enfants et pseudo partisans. Clairement la SS ou la folie de Hitler ne sont pas les seuls responsables du basculement.
Reste Staline ; s’il est évident qu’il se soit trompé sur Hitler et le pacte germano-soviétique, le vodj parvient néanmoins à trouver les mots pour ressouder le peuple, le 3 juillet, autour d’une idée : c’est une guerre nationale, une guerre de défense face à une agression. Le peuple est touché dans sa fibre nationaliste et, pour un temps, le socialisme et l’idéologie sont laissés de côté. L’appel répété à appliquer la terre brûlée et à généraliser la guérilla sur les arrières allemands a aussi un impact clair du côté des agresseurs. Dès le 8 juillet Goebbels emploie le terme de guerre d’extermination sans possibilité de paix. La violence déjà massive va devenir absolue.
De l’euphorie aux premiers doutes
À la mi-juillet s’impose une question : alors que la percée ou la bataille décisive tant attendue ne sont pas encore au rendez-vous, quels sont les objectifs de campagne ? Du côté de Staline la clé reste basique : distiller la peur au sein de l’état-major en envoyant ses représentants comme le maréchal Simeon Mikhaïlovitch Boudienny ou Nikita Khrouchtchev en Ukraine. C’est la posture idéologique qui prime plus que les capacités militaires de ces deux hommes. Le résultat est limpide : la chaine de commandement est alourdie sans aucun effet positif. L’atmosphère de purge n’arrange rien à l’affaire, Joukov et Staline voyant des espions partout pour expliquer les défaites sur le terrain. Du côté allemand la question de Kiev hante Hitler qui y voit un foyer très important de Juifs. C’est l’un des axes forts de Jean Lopez : montrer que la question juive a été une donnée militaire majeure dans Barbarossa. Les retards accumulés avec les actions du général Kirponos, les hésitations pour la capture de Kiev, la volonté maintes fois répétées par Halder qu’il faille prendre Moscou alors que Hitler fait de l’Ukraine une priorité, autant de données qui pèsent dans la balance des hésitations.
Sur le front de Leningrad la tension est également à son maximum. Côté soviétique l’envoi sur place du duo Vorochilov et Jdanov vont dans le sens d’une défense à tous prix. Il est intéressant de noter que les choix sont encore purement idéologiques et que la population est utilisée à plein régime pour fortifier la cité sous le commandement de Popov. Des milices sont levées en nombre, sans réelle valeur militaire, à peine armées mais pour Staline la vie humaine a peu d’importance. La poussée allemande vers Leningrad est difficile du fait du terrain mais surtout de la résistance et des contres soviétiques comme celui de Soltsy-Dno qui entre les 14 et 18 juillet fait reculer les forces nazies de 50 km. Petit à petit, à l’image des troupes de Manstein, la Wehrmacht est sapée à sa base, victime de fatigue, d’épuisement du matériel et des hommes, menacée d’anémie.
Sur la route de Smolensk les analysent continuent à diverger. Percer directement ? Envelopper par le Nord et le Sud face à un adversaire dont on croit qu’il est fini ? En réalité seul von Bock semble prendre la mesure du risque lié à l’épuisement de ses troupes tandis qu’un Guderian joue sa carte personnelle en tentant des coups aussi audacieux que risqués. En face Timochenko ne dispose que de troupes disparates. Tout ceci débouche sur l’encerclement de Smolensk et finalement sa prise après de très violents combats. Cette dernière est intéressante pour deux raisons : pour les Allemands c’est le problème du ravitaillement qui s’impose en tête des réflexions, notamment le manque de trains. Pour Staline c’est un moment de doute et de décisions délirantes visant à imposer des contre-attaques meurtrières à grand coup de menaces et de volontarisme imposé. Si par moments les généraux Rokossovski ou Kourotchine obtiennent des succès tactiques le coût humain est exorbitant.
Il ressort de ces lignes quelques idées forces. Tout d’abord les cris de victoire de Hitler et Goebbels au cœur de l’été sont totalement en rupture avec la réalité du terrain. Berlin évoque déjà la prise de Moscou et la percée vers Bakou alors que la troupe doute, ce que montrent les nombreux extraits de lettres ou de carnets cités par l’historien. Le tournant intervient au début du mois d’août : les USA s’installent en Islande ce qui va compliquer la tâche des U-Boot, les contres soviétiques montrent une capacité inattendue à lever toujours plus de nouvelles divisions. Hitler et l’OKH entrent dans une vrai crise de commandement avec pour nœud central la question de Moscou. Cette guerre est aussi à nulle autre pareille. La troupe, dont 40% est passée par les institutions nazies, se croit tout permis et les massacres et exactions se multiplient. Le terrain y est aussi pour quelque chose comme le souligne le général Heinrici : diabolisation de l’ennemi, fatigue extrême, insécurité ou culte de l’insécurité, autant de leviers qui, habillés par des représailles nécessaires voient les crimes exploser. À partie de la fin juillet la hausse des effectifs de Einsatzgruppen soutenue par les mesures de Heydrich et Himmler prises la fin juillet, la volonté de nettoyer les arrières de sources de dangers potentiels, les Juifs étant ciblés comme des partisans, aboutissent aux premiers massacres de masse. Parmi les nombreux exemples celui de Loutsk est révélateur : les 3 et 4 juillet 1160 habitants sont massacrés par la troupe après la découverte de 10 corps de soldats de la Wehrmacht. La terrible routine meurtrière s’installe à tous les échelons.
Kiev, Moscou ou Leningrad ?
C’est un moment clé qui voit les Allemands passer du sentiment d’échec à la réussite potentielle entre le 1er août et le 30 septembre. C’est le flair d’Hitler qui est au cœur de ce retournement.
La question des Marais du Pripet est au cœur des premières réflexions de l’historien. Alors que l’exemple des Ardennes pour la France aurait pu apporter quelques réponses quant à la capacité des Panzers à franchir un obstacle naturel difficile, les Soviétiques tiennent pour acquis que ces marais sont infranchissables. Ceci permet donc concentrer l’essentiel des forces sur la route de Smolensk et dégarnissant un flanc couvert de façon naturelle. Pour les Allemands ces marais posent d‘autres questions. Pour von Bock à la fin juillet (20-25) il faut viser la vitesse et donc les laisser sur les arrières mais, de ce fait, ils deviennent une base potentielle pour les partisans, d’autant que Staline lance un appel à l’insurrection général et aux attaques de partisan partout où c’est possible. La réponse militaire allemande est limpide : l’extermination de tous les Juifs qui y sont pour éviter la constitution d’un maquis de partisan. Tous les Juifs sont traités comme une cible militaire.
La recherche de la solution militaire de la campagne reste encore en suspens ; Halder ne démord pas de l’option Moscou mais Hitler voit dans une action en Ukraine la clé de la destruction de l’Armée Rouge. Le choix de Kiev est donc au cœur de réflexions stratégiques soulignant l’incapacité à tenir une ligne directrice claire depuis le début de Barbarossa. Du côté soviétique la frappe de Staraïa Roussa confirme au début août l’incapacité de l’Armée Rouge à monter une opération complexe et la nécessité d’apprendre simplement les bases. Le système communiste et son hypercentralisation s’avère catastrophiques, laissant peu de place à la nécessaire improvisation sur le terrain, sans parler du rôle dévastateur des contrôles par des commissaires politiques ne comprenant rien aux affaires militaires. Face aux percées allemandes la réponse est meurtrière : ainsi von Leeb ouvre-t-il la voie vers Leningrad que Mekhlis, tout puissant chef de l’administration politique de l’armée fait fusiller les officiers supérieurs, déclinant de façon méthodique l’un des outils préférés de Staline : l’épuration.
Début septembre l’encerclement progressif de la cité de la Révolution est en cours, ce qui pousse le Vodj dans une colère noire ; Joukov est envoyé sur place pour mettre en place une défense acharnée de la ville, en sacrifiant au besoin les civils. L’une des clés de la campagne se joue alors : le 20 septembre l’opération Typhon visant à prendre Moscou est actée et von Leeb doit porter son effort vers le Centre. C’est encore une fois l’incapacité à trancher, à choisir une cible et à s’y tenir qui sont la règle. Trois semaines de plus et la cité tombait offrant toute la Baltique aux Allemands, avec des capacités de ravitaillement irremplaçables. Au lieu de cela commence un siège concentrationnaire et militairement se forme un abcès de résistance jusqu’en 1944.
La suite est terrible pour l’Armée Rouge. Alors que la reprise de Smolensk est une priorité absolue pour Timochenko et que la propagande soviétique se régale des succès tactiques de Koniev stoppant net la progression de la 7e Panzer dans le secteur de Doukhovchtchina, la catastrophe arrive : le Groupe centre est écrasé, la route de Kiev ouverte, un immense chaudron consume une Armée Rouge qui a ordre direct de Staline de ne pas envisager la retraite. 5 armées sont quasiment détruites, ce qui représente 43 divisions. 13 généraux sont capturés, un immense matériel est perdu, 650 000 prisonniers vont connaître les pires sévices. Cette bataille a nourri les querelles historiographiques autour d’un axe limpide : Kiev a fait perdre Moscou. Jean Lopez montre que rien n’est certain, loin s’en faut. Par contre deux choses sont certaines : Smolensk a été une victoire défensive pour les Soviétiques sur la route de Moscou ; Kiev est un désastre absolu.
Le désastre militaire s’accompagne d’un désastre humain qui, dans les suites meurtrières des massacres du Pripet par les cavaliers de Fegelein et de Himler, se cristallise en un lieu infernal : Babi Yar. La mécanique meurtrière est implacable : Staline ordonne de miner toute la ville avant l’évacuation des dernières forces soviétiques sans se soucier des risques pour les civils. Le 19 septembre les forces allemandes entrent dans la capitale ukrainienne. Les prisonniers de guerre sont parqués et très vite commencent des massacres. Les mines fauchent les forces de la Wehrmacht, les incendies se multiplient, la violence se généralise en une crise paroxysmique qui conduit le général Eberhardt à concevoir le massacre de tous les Juifs. Ils sont une cible militaire, la Wehrmacht, avec l’aide d’une partie de la population locale est à l’origine du massacre qui débute à la fin septembre, comme ce fut le cas à Jitomir. En 36H environs 34000 personnes sont tuées dans des conditions terribles. Ce processus se retrouve partout en Ukraine avant et après la prise de Kiev ; la Shoah est active et la Wehrmacht y a toute sa place, de la base à la hiérarchie.
Le retour de la terreur stalinienne
Les crimes nazis sont une évidence et sans commune mesure sur le front de l’Est. Tout aussi évidente est la criminalité du régime soviétique et de Staline en particulier, contre sa propre population, contre ses troupes. Après la chute de Minsk, les 28-29 juin Staline connait un moment de réel doute. Or la tête de l’URRS est au cœur d’un chaos institutionnel où Staline est tout puissant, entouré de fidèles zélateurs. C’est un système bureaucratique au possible, incapable de gérer avec efficacité le défi imposé par Hitler. C’est dans ce cadre que se met en place le GKO ou la mise en coupe quasi féodale des pôles majeurs de l’URSS. Beria, Molotov, Vorochilov, Malenko, autant de têtes autour du Vodj pour trouver des solutions. Cette idée de Molotov débouche sur deux premières décisions : accroître la production de T34 et de KV1 coûte que coûte ce qui débouchera sur les usines à ciel ouvert où mourront de nombreux travailleurs dévoués à la cause patriotique.
De la même façon un organe de décision militaire et de coordination est pensé : la STAVKA. Ici d’un projet de mai 1940, repoussé par une Staline réticent, il devient effectif le 23 juin 1941. Le premier chef en est Timochenko mais cet outil ne cesse d’évoluer tout au long de l’été, sans être capable d’infléchir le cours des événements et d’empêcher Staline de passer outre pour imposer ses vues. Or si Hitler a de réelles capacités militaires, celles de Staline sont nulles. Totalement incompétent pour gérer des opérations militaires et comprendre les bases d’un front, pensant en idéologue avec un mépris total de la vie humaine, multipliant les erreurs aux conséquences meurtrières pour les populations et la troupe, le portrait dressé de Staline est bien loin de la propagande forgée après la guerre. La clé pour le dictateur est celle d’une bolchevisation à tous les étages et d’une répression comme réponse aux problèmes strictement militaires. En découlent des chiffres ahurissant de désertions, de maltraitance, de pertes. Ce qui prime c’est la loyauté au bolchevisme avant la compétence militaire. Le NKVD et le Parti sont les deux organes qui gèrent le fait que tout militaire est un suspect potentiel capable de trahir l’État. En réalité Staline suit les pas empruntés par Trotski lors de la guerre civile russe entre 1918-1921. On fusille ceux qui s’échappent d’un chaudron ou font retraite, on interne et torture ceux qui se sont échappés des mains des Allemands car suspects, on purge les unités des soldats d’origine ukrainienne. Le summum est atteint avec l’ordre 270 faisant des familles des soldats concernés des otages, avec l’ordre d’abattre les soldats les moins combatifs ou celui de se battre jusqu’à la mort si on est encerclé.
L’un des points les plus intéressants est celui de l’analyse des « kessel », ces chaudrons où sont consumées les forces soviétiques après un encerclement dans les règles de l’art. Staline y a vu la preuve d’une défaillance de ses chefs et de ses hommes nécessitant des purges et une violence inédite contre sa propre armée. Qu’en est-il dans la réalité ? Les soldats soviétiques se sont beaucoup plus battus que les Polonais et les Français. Il n’y a pas eu au cœur de l’été 41 un défaitisme total expliquant ces massacres. Par contre il y a des données purement militaires : un chaudron en rase campagne ne sert à rien, autant se faire encercler en ville, comme cela aurait pu être le cas à Minsk. Quant à fixer des forces ennemies, c’est tout à fait possible et les Allemands vont le faire à plusieurs reprises, ravitaillés par des ponts aériens, avec une cohésion sans faille, un commandement au niveau. Le problème des Soviétiques est un commandement totalement défaillant et un culte de l’offensive qui les a empêchés de travailler les bases de l’art défensif. Staline préfère donc avec ses généraux défendre les assauts aussi meurtriers que la plupart du temps inutiles.
Alors que s’avance l’automne, l’Armée Rouge s’est petit à petit restructuré en unités moins grandes, ce qui est due à la clairvoyance de Joukov, conscient des faiblesses du système. Le second point essentiel est que les Allemands ont pêché par supériorité, niant à un pays disposant pourtant de 110 millions de personnes de plus de lever des armées. Le pragmatisme soviétique dépasse la simple lecture idéologique lorsque les faits l’exigent : libération de prisonniers des goulags, enrôlement de fils de koulaks, capacité industrielle hors norme au prix d’un esclavage réel, absence de réelle révolte interne, le NKVD ayant nettoyé tout ce qui pouvait l’être avant le conflit, patriotisme certain. De cela Hitler et ses généraux n’ont pas voulu envisager ne serait-ce que la possibilité et l’idéologie nazie s’avère alors plus rigide encore que celle de son adversaire.
L’automne des illusions
La République antisoviétique de Lokot
Cette analyse fait partie de tous faits, méconnus, que Jean Lopez exploite pour non seulement les porter notre connaissance mais aussi et surtout démontrer combien les Nazis se sont engagés dans une guerre absolue plus que totale, niant jusqu’à la possibilité de gagner des alliés sur le terrain par pure racisme. Il en fut ainsi de l’expérience pourtant couronnée d’un certain succès du général Rudolf Schmidt qui, par un traitement plus humain des territoires et des personnes sous sa responsabilité, par sa capacité à retourner des Russes contre le système soviétique a marqué les esprits. Mais ce projet de Russie nouvelle disparait en 1943 avec la radicalisation d’un régime poussé vers une course à l’abîme.
Le double cataclysme de Viazma-Briansk
À mesure que l’on se rapproche de Moscou les témoignages cités par l’historien montrent combien les soldats allemands doutent de plus en plus. L’ennemi es féroce, la fatigue et l’usure réelles. Pourtant les mois de septembre-octobre vont consacrer une accélération de la catastrophe selon une lecture a priori positive pour les Nazis.
Tout d’abord, avec le lancement de l’opération Typhon devant déboucher sur la prise de Moscou à partir du 6 septembre, commence aussi l’accélération des mesures les plus meurtrières. C’est la réduction des ghettos de Biélorussie, la décision d’affamer Leningrad au lieu de la prendre, la volonté de faire basculer la Turquie dans le camp de l’Axe. Tout est pensé dans la logique d’une victoire à venir comme si Kiev avait été une bataille décisive, l’avant-dernière avant l’effondrement du système soviétique. Tenant compte de l’état des forces, l’État-major allemand décide d’organiser deux « kessel » pour enfermer les dernières forces vives de l’Armée Rouge et les y concasser. Les pertes sont réelles pour une Wehrmacht dont les signes de faiblesse sont mesurables. 15% pour les hommes, près de 50% pour le matériel sont contrebalancés par la volonté d’en finir avant l’hiver et un moral à la hausse après l’exploit de Kiev. C’est tout le sens du discours de Hitler entre le 1er et le 2 octobre : la bataille décisive est enfin là.
Côté soviétique, trois lignes de défense devant Moscou et le nombre des moyens font pencher la balance du côté d’une forme de confiance avant l’assaut. Mais cette dernière est basée sur de faux rapports, une organisation totalement défaillante avec trois commandements qui ne peuvent communiquer entre eux sans passer par Moscou, Moscou où la STAVKA n’a droit qu’à des rapports biaisés pour ne pas froisser la prééminence de Staline. Mais il n’est pas besoin des seuls errements du Vodj pour expliquer l’ampleur du désastre qui va une nouvelle fois s’abattre sur les soviétiques. Le général Koniev, par exemple, dans son secteur ne fait pas de reconnaissance vers des terrains qu’il juge impropre aux chars. Ainsi cette incurie laisse songeur quant quelques semaines plus tôt les Marais du Pripet infranchissables l’ont été pour déboucher la mise en place du gigantesque « kessel » de Kiev. Que penser de généraux supérieurs soviétiques dont les exemples terribles des opérations précédentes montrent que les Allemands n’attaquent jamais, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, du fort au fort, privilégiant la surprise, le déplacement y compris dans les secteurs « infranchissables ». Alors que tout indique un assaut imminent, la surprise sera donc pour les Allemands que leur attaque soit … une surprise.
Les opérations sont analysées en détails avec beaucoup de brio pour ne pas noyer le lecteur dans des considérations trop techniques. Guderian, n’en faisant qu’à sa tête, perce le 30 septembre, 2 jours avant la date, ce qui finalement arrange von Bock. Moscou continue de croire longtemps à une poussée au Sud, vers Orel et les forces soviétiques y sont attirées, ce qui laisse le champ libre au Centre. Eremenko et Staline sont tombés dans le piège, la suite est terrible. Par peur des commissaires et des purges on ment, on minimise les percées, on invente des échecs allemands. En quelques jours Viazma et Briansk tombent, les lignes de défense de Boudienny et Koniev sont enfoncées. Le 5 octobre la sentence tombe : le désastre est total, c’est un second Kiev. Le ratio des pertes est de 1 à 18, 13 des 16 armées qui barraient la route de Moscou sont anéanties. Les causes sont assez simples : pas de liaison et de communication, des errances dans le commandement soviétique à tous les niveaux. Staline et la peur qu’il impose ne sont pas au dernier rang des responsables du désastre et, chose nouvelle, ce dernier décide de ne pas procéder à une purge. Cette fois-ci il laisse du temps à ses officiers de pouvoir, enfin, apprendre.
Les conséquences pour Berlin sont évidentes : Moscou est virtuellement prise et elle deviendra un mouroir à ciel ouvert, comme Leningrad, afin d’éviter les sabotages meurtriers rencontrés à Kiev. L’Armée Rouge n’existe plus, c’est une évidence, on ne peut pas se remettre de deux telles défaites. Tous les alliés félicitent Berlin, à commencer par Franco. À Moscou la panique est réelle pendant quelques jours, jusqu’au 17 octobre où le NKVD met fin aux émeutes par la force. Au Sud, en Ukraine, après de terribles combats Ukraine tombe enfin, Kharkov est prise (24 octobre) et finalement, les échecs répétés des forces roumaines d’Antonescu n’empêchent pas Odessa de tomber à son tour le 17 octobre. Ce dernier, embarqué dans une fuite en avant, accompagne avec satisfaction les massacres perpétrés par ses forces et 3000 membres du Sonderkommando 11b contre les Juifs. 32000 y sont massacrés. À ce stade Barbarossa semble être enfin sur la voie du succès pour Hitler. Le réveil n’en sera que plus douloureux.
La Wehrmacht grippée, la boue, les routes, Joukov 15 octobre – 15 novembre
Comment Moscou n’est pas tombée ? Comment expliquer qu’après deux telles catastrophes, l’Armée Rouge n’est pas été vaincue par la Wehrmacht au point même de connaître à son tour l’échec ? Pour l’historiographie classique, alimentée par les récits des généraux allemands après la guerre les causes sont évidentes. La boue, le ravitaillement et Hitler. L’historien s’applique à démonter cette construction en prenant appui sur un combat oublié, la batille de Kalinine, au Nord de Moscou. Elle devait être le troisième grand encerclement, le « kessel » ultime. Ni Halder, ni von Bock et pas plus Reinhardt ne comprennent ou ne voient pourtant la réalité. Les troupes allemandes sont lancées dans un combat de poursuite au bord de l’épuisement car l’Armée Rouge n’existe plus. Il faut donc prendre tous les risques car il n’y a plus rien en face si ce n’est des forces à encercler et achever. La leçon de Kalinine est tout autre : les soviétiques s’accrochent, luttent, bloquent, repoussent. La boue, la pluie ? Non, les bulletins météos sont formels, il pleuvait plus au mois d’août. Par contre le ravitaillement pose en effet problème : il y a peu de route et ces dernières sont utilisées par des flux trop importants, elles se dégradent vite. Les soviétiques les détruisent aussi dès que possible. Mais ceci n’explique pas tout : la désorganisation est totale entre les unités et les bouchons réguliers L’essence est bloquée dans le trafic, le réseau ferroviaire n’est pas utilisable et l’aviation ne peut jouer son rôle de substitut. Jean Lopez donne un cas exemplaire : une division panzer, pour parcourir 60km, consomme 220 m3 d’essence. Pour dépasser les problèmes routiers il faudrait que la Luftwaffe utilise des 100 Ju52, les avions de transport trimoteurs, pour acheminer l’essence aux troupes. La flotte totale est de 300 appareils.
Mais plus encore que la route et la boue toute relative finalement, c’est bien la résistance des Soviétiques, niée comme une évidence après Minsk, Kiev, Briansk et Viazma, qui n’a pas été prise en compte. Une étude fine des combats montre tout autre chose : la mobilisation est totale pour faire de Moscou une forteresse, la répression du NKVD est impitoyable. Les quelques forces qui arrivent de Sibérie sont complétées par des troupes levées à la hâte, à peine formées mais faisant le nombre. Voilà la clé réelle de l’échec : la capacité de résilience hors norme d’un adversaire qui devait s’effondrer sur lui-même comme la France un an plus tôt. L’échec de Kalinine s’accompagne de l’incapacité pour von Leeb à en finir à Leningrad, ne serait-ce qu’à rejoindre les forces finlandaises, laissant la route de Mourmansk, artère vitale de l’aide alliée, ouverte. Il en est de même en Ukraine ou Rundstedt comme Manstein échouent avec des forces épuisées. Sébastopol ne tombe pas et le discours, début novembre, Staline regonfle le moral. La guerre va durer, ce qu’Hitler admet enfin. C’est l’échec de la lecture clausewitzienne du triomphe de la volonté face à un ennemi qui était au bord du gouffre et devait alors céder. C’est l’échec sur l’incapacité à choisir un objectif et s’y tenir. C’est l’échec de savoir s’arrêter alors même que Colmar von der Glotz, fort justement cité ici, écrivait en 1883 que Napoléon, en Russie, n’avait pas su s’arrêter en surestimant son génie à vouloir tout gagner en une seule campagne. C’est l’échec d’Hitler, de Halder et des penseurs de Barbarossa.
Les grands mouroirs à ciel ouvert
Les historiens reviennent ici sur l’étendue des massacres depuis le début de la campagne alors que s’amorce le tournant marquant le recul des forces allemandes devant Moscou. Entre juin 1941 et le printemps 1942 les données statistiques donnent le vertige. 4 millions de civils, 2 millions de prisonniers sont morts du fait des décisions allemandes. Les causes sont multiples : l’idéologie, le sinistre calcul économique mais aussi ce que la Wehrmacht a habillé sous le voile des « nécessités militaires ». Le siège de Leningrad dont la mise en place est détaillée, est celui d’un siège concentrationnaire. Les Nazis veulent faire périr la population avec le meilleur rapport coût-efficacité, comme en témoigne le simple harcèlement de l’artillerie qui vise à maintenir une pression constante sur la population et les défenses.
Quant au pouvoir soviétique, il n’est pas épargné par les faits : La ville ne doit pas tomber et doit servir à fixer le maximum de forces allemandes pour Staline qui ne fait pas grand cas des pertes civiles. Au plus fort du siège la NKVD maintient ses purges locales.
Les conditions de vie des soldats faits prisonniers n’est pas en reste : martyrisés par les soldats allemands, ces hommes sont aussi abandonnés par les leurs, capables de les interner après une évasion pour suspicion de trahison. Les marches forcées vers des camps atteignent des niveaux de perte délirant, de près de 70%.
Pendant ce temps les massacres de Juifs se poursuivent dans le sillage de l’avancée des troupes vers Moscou ; alors même que les forces allemandes sont à bout, que le ravitaillement fait défaut, aucune pause n’existe dans la logique meurtrière de cette invasion visant la destruction pure et simple d’un système et de sa population.
Staline et Hitler face à leurs alliances
Deux axes sont à mesurer. Tout d’abord du côté de Staline la méfiance reste totale face aux USA et encore plus à Churchill. La crainte du complot n’est jamais éloignée ; et si Londres et Berlin se rapprochaient pour mieux s’allier contre Moscou ? Et si les Occidentaux laissaient simplement Berlin et Moscou se saigner pour finalement en récupérer les fruits ? Pourtant les rapprochements sont réels et s’ils ne sont pas encore décisifs quant à l’aide apportée, ils ne sont pas nuls. Ainsi en est-il de l’envoie de blindés britanniques qui serviront ponctuellement lors de la défense de Moscou mais surtout d’un soutien aérien et de la Royal Navy pour la défense de Moursmansk lors de la bataille de Lista entre juillet et septembre. Dans le même cadre, la coopération entre Britanniques et Soviétiques est totale sur le terrain lors de l’invasion de l’Iran visant à l’extraire du potentiel giron allemand en septembre, lors de l’opération Countenance. Peu connue, c’est peu de le dire, cette opération assure une ligne de ravitaillement à l’URSS en cas de perte de Mourmansk alors même que le prêt-bail est acté à l’été 41. C’est là aussi une erreur fondamentale d’Hitler : ne pas croire un instant que les démocraties aideront Staline. L’idéologie prime pour ce dernier alors que le pragmatisme des alliés est capable d’associer un système totalitaire avec des démocraties, et un Staline de pousser à ce que les communistes de tous les pays se rapprochent des réseaux de résistance, ici de de Gaulle, là des forces de Tchang Kai Tcheck ou encore de laisser la porte ouverte à une Église orthodoxe faisant de Hitler l’antéchrist.
La question des alliés de l’Axe est plus complexe et se résume finalement en un mot : chacun pour soi. La Finlande refuse de pousser vers Leningrad et de couper totalement avec les Alliés fort d’un courant de sympathie non négligeable vis-à-vis de Londres et Washington. La Finlande est de toute façon trop faible pour pousser plus avant dans une guerre totale, les soldats sont réticents à se battre au-delà des frontières de 1939. La Roumanie et la Hongrie sont incapables de faire plus, ce qui n’est pas le cas de l’Italie. Mussolini offre bien des troupes supplémentaires mais dans une vision toute personnelle faisant de la Mer Noire un lac italien. Les troupes du général Messe se comportent très bien sur le terrain mais ce dernier est en conflit régulier avec Kleist et les tensions sont perceptibles. Quant au Japon, le choix de l’Indochine, le 30 juillet 1941, la certitude de ne pouvoir combattre les forces soviétiques avec un espoir de réussite réel au regard du différentiel de matériel, les reliquats du pacte germano-soviétique, autant de blocages rendant impossible toute stratégie commune.
Dans un cas une alliance véritable, symbolisée par le cas polonais poussant Staline à accepter des compromis avec Londres, du moins pour le moment et dans l’autre, un Axe où chacun joue sa partition derrière une Allemagne toute puissante mais au bord de l’échec.
L’hiver de l’échec
Voyage en Crimée
En quelque pages, terribles, le sort de cette région est utilisé comme étude de cas des massacres à tous les niveaux. Les Juifs, le siège de Sébastopol qui fini par tomber en juillet 1942 répondent en écho aux purgent de Staline, avant et après l’occupation laissant cette région vidée d’une bonne partie de ses communautés à l’exception des Russes et des Ukrainiens …
Le dernier effort, 15 novembre – 4 décembre
Reviennent comme une litanie mortelle les mêmes causes d’échecs répétés sur le front de Leningrad et d’Ukraine. Dans le premier cas von Leeb à Tikhvine, dans le second Rundstedt à Rostov. Les causes sont évidentes : la troupe n’en peut plus. La réponse d’Hitler et du haut commandement est de remplacer von Rundstedt par von Reichenau. Dans les deux cas c’est le recul grosso modo aux positions d’octobre et deux échecs des objectifs initiaux de Barbarossa : pas plus Leningrad que Rostov ne sont tombées et dans ce dernier cas la ligne de défense est le Mious, à 100 km de l’objectif.
Le dernier effort demandé aux troupes face à Moscou s’écrase face à des défenses toujours plus féroces, des champs de mine, de T34 et KV1 en tous points supérieurs, du sacrifice d’unités soviétiques pour lesquelles plus aucune retraite n’est permise. La criminalisation des échecs militaires devient totale de la part des commissaires politiques. Et qu’en est-il du « général Hiver » dont Jean Lopez rappelle qu’il est convoqué depuis Voltaire et la défaite suédoise face à Pierre le Grand ? Et bien les rapports météos sont encore une fois formels ; il a fait froid, mais pas plus que d’habitude et, surtout, le pic est atteint au moyen de la contre-offensive soviétique. Le froid n’a pas arrêté les Allemands, du moins pas plus qu’il n’a empêché les Soviétiques de les écraser par la suite. Quid des divisions de Sibériens ? Un mythe : 2% des forces devant Moscou. Et les manteaux ? Et l’impréparation des généraux allemands ? Tout a été commandé dès le mois de juillet et produit en quantité suffisante, ce qui n’est pas le cas forcément pour les pièces détachées. Mais le problème reste le même : la logistique, l’incapacité à gérer des flux cohérents. Pire selon certains officiers, on s’est privé par le massacre de Juifs d’une main-d’œuvre que l’on aurait pu tuer au travail. La sentence des auteurs s’impose alors : « Les Allemands n’ont pas manqué Moscou d’un cheveu mais d’une année lumière. Ils n’avaient ni les effectifs ni la logistique ni le moral pour y parvenir ». La faute à Hitler, Halder, von Bock, victimes de leurs propres suffisances face à une campagne unique à grands coups de batailles décisives qui n’en furent jamais. Une constante néanmoins : le froid n’a jamais ralenti le massacre des Juifs comme ce fut le cas à Rovno ou Slonim, massacres ordinaires à coups de mitrailleuses et de grenades, au cours de l’hiver.
La contre-offensive, 6 décembre 1941- janvier 1942
L’échec de Barbarossa est consommé et Staline croit pouvoir faire un Barbarossa à l’envers. Par deux fois l’Armée Rouge a été détruite, par deux fois elle s’est relevée. C’est ici qu’il faut comprendre que les efforts d’industrialisation de guerre des années 30, le choix de la rusticité, de la standardisation ont joué à plein, avec la capacité d’épuiser une population impensable dans des démocraties. La contre-offensive soviétique se fait dans des conditions météorologiques épouvantables, ce qui sauve les Allemands, et dans un rapport de force qui est à peine en faveur de l’Armée Rouge. La faible motorisation de cette dernière et les conditions météos expliquent que les reculs ne soient pas aussi terribles que possibles pour les Allemands. L’étau sur la capitale est finalement desserré, la retraite d’une centaine de kilomètres n’étant jamais une déroute. L’Allemagne parvient à mobiliser dans l’urgence 10 divisions légères pour compenser les pertes et Hilter devient le chef suprême en lieu et place de Brauchitsch. Le fameux « haltebefehl » qui par deux fois interdit une retraite massive ralenti l’effort soviétique et sauve la Wehrmacht du désastre. Les Allemands connaissent des chaudrons, des « kessel » mais ils parviennent à tenir et percer, grâce à un ravitaillement aérien. Ceci n’est pas anodin dans les choix futurs. Staline n’a pas non plus réussi à vaincre cette armée épuisée en une campagne.
Guderian, Hoepner, von Leeb, von Bock sont écartés, soit les principaux penseurs et acteurs de Barbarossa. Le 11 décembre, 4 jours après la surprise de Pearl Harbour Hitler déclare la guerre aux USA dans une fuite en avant qui conclut l’échec des objectifs stratégiques de cette opération. La bataille de Moscou fut-elle décisive ? Cette question est un non sens pour les soviétiques qui refusent la bataille décisive comme concept opérationnel. Ce rêve allemand n’est pas décisif ; la Wehrmacht se rétablie, repart à l’offensive en 1942, les Soviétiques connaissent encore de nombreux échecs retentissants et les pertes vont encore exploser dans tous les camps. Moscou est donc un moment important, au mieux, dans un continuum d’atrocités loin d’être achevé en janvier 1942 comme le souligne l’historien en évoquant la mise en place du système concentrationnaire d’Auschwitz et les massacres et atrocités perpétrés dans les goulags.
Conclusion
Je laisserai le lecteur achever les dernières pages seul. Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri achèvent leur étude en citant le concept monstrueusement pur de guerre absolue pensé par Clausewitz. Ce dernier n’a pas pensé l’approche totalitaire et ne peut être tenu pour responsable de ce que Hitler en a fait avec Barbarossa. Mais tout au long de ce livre passionnant l’historien touche au but en analysant les fondements de cette guerre absolue. Au-delà du simple fait de dépasser la querelle des fonctionnalistes et intentionnalistes, il apporte un éclairage décisif quant à la place tenue par les logiques strictement militaires. L’incapacité de tenir un territoire autrement que par une violence radicale envers les civils, la participation de la Wehrmacht à tous les échelons, les circonstances du moment, le climat délirant de peur du partisan, autant de clés pour comprendre la singularité du front de l’Est. La force de cette étude est de traiter également de la vision soviétique, prise entre la violence terrifiante du système stalinien, la capacité de résilience incroyable d’une Armée Rouge se relevant des pires catastrophes, telles les légions romaines face à Hannibal.
Cette somme de 956 pages est d’une densité et d’une richesse rares mais les auteurs ont su rester clairs. Les analyses militaires sont pointues sans être trop techniques, les extraits fourmillent, les notes et la bibliographie, essentiellement en langue allemande, anglaise et russe, font prendre conscience de la masse de travail accomplie. Les cartes permettent en outre de suivre les opérations et sont d’une grande lisibilité. C’est donc le point d’orgue de 10 ans d’une vie passée par Jean Lopez à étudier le front de l’Est. Après Stalingrad, Koursk, le chaudron de Tcherkassy-Korsun, Bagration et Berlin, Barbarossa parachève une œuvre immense dont la portée mérite d’être soulignée. L’étude globale des faits tactiques et stratégiques s’inscrit ici dans une histoire militaire globale, resituant l’analyse guerrière dans toute sa complexité. C’est aussi un modèle de mise en perspective historiographique et de chasse aux mythes dans la droite ligne du travail que l’historien a fait avec Olivier Wieviorka dans leurs ouvrages sur les mythes de la seconde guerre mondiale. Un livre éprouvant parfois lorsqu’il s’agit d’aborder les horreurs de tous bords, mais essentiel pour l’historiographie du second conflit mondial.
Je me permets enfin de proposer une interview de 2011 de Jean Lopez explorant, déjà, Barbarossa dans toute sa complexité. Le document est très intéressant car il permet de voir le chemin accompli dans la construction de cette somme.

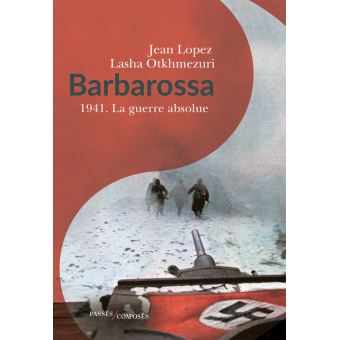


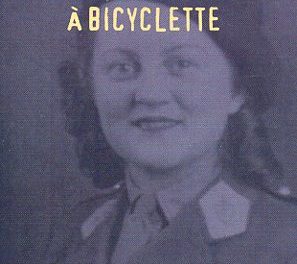










Merci de ce retour précieux
il y a une faute de frappe dans l’avant dernière partie ; « haltebefelh » ne s’écrit pas de cette manière, il y a eu une inversion du « h » et du « l ».
Le terme était en italique pour cette raison. Si vous pensez que les guillemets ajoutent une clé de compéréhension, ce détail a été ajouté.
L’expression « l’écrasement des koulaks » pose problème ici : le terme « koulaks » mérite des guillemets vu son usage systématique pour désigner toute forme de résistance à la « collectivisation » des années 1929-33 (l’entrée forcée de la paysannerie dans les kolkhozes, en fait un nouveau servage), comme le rappellent les travaux de nombreux historien.ne.s, dont Juliette Cadiot et Marc Elie dans leur Histoire du Goulag (2017).
Par conséquent, cette « dékoulakisation » orchestrée par le pouvoir a pu avoir des effets au contraire négatifs sur la capacité de résistance des populations paysannes face à l’invasion allemande. On sait qu’au début, celle-ci a plutôt été vue comme une chance de sortir du kolkhoze dans certaines campagnes, avant les désillusions face à la brutalité de la Wehrmacht, cf. le livre de Masha Cerovic sur les partisans soviétiques, entre autres.
En fait la thèse selon laquelle la politique stalinienne des années 1930 (collectivisation forcée et industrialisation accélérée par le « plan ») aurait permis la victoire de 1945 est un des arguments principaux de la réhabilitation de Staline aujourd’hui en Russie ; la biographie d’Oleg Khlevniouk traduite en français fournit des pages très convaincantes pour répondre à cet argument et l’invalider, même s’il faut bien sûr examiner tous les éléments.