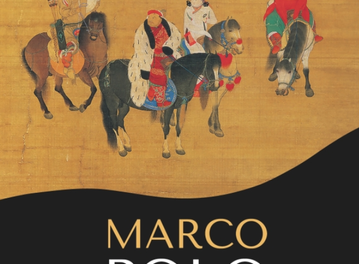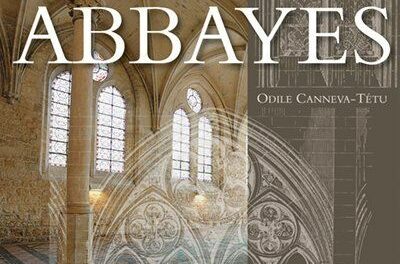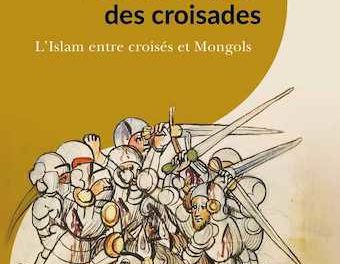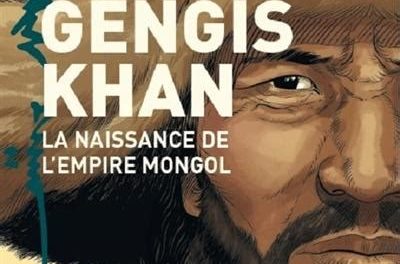Clovis et son vase de Soissons figurent en bonne place parmi les clichés les plus mémorables du roman national modelé sous la IIIe République. Rois des Francs présentés comme des précurseurs de la France moderne par la doctrine scolaire lavissienne, les Mérovingiens sont pourtant des figures énigmatiques, dont la légende tout à la fois romantique et brutale est d’autant plus persistante que la part des certitudes est relativement restreinte. La rareté et le biais des sources les nimbent d’opacité. Malgré l’attrait du mystère et l’exotisme des âges barbares, la période charnière entre l’Antiquité tardive et le bas Moyen Âge, où achève de se dissoudre l’Empire romain, est ardue à déchiffrer et pourrait sembler difficilement accessible aux non spécialistes.
C’est ce brouillard historique que s’emploie à dissiper habilement Katalin Escher, docteur en archéologie médiévale, universitaire spécialiste de cette période sur laquelle on lui doit déjà des publications consacrées à Attila et aux Burgondes. Sur un sujet qui n’est donc pas forcément grand public, on peut louer la clarté de sa démarche, attentive à la culture matérielle, et son souci de prudence historiographique qui souligne à juste titre les limites des sources et leur parti-pris providentialiste.
Le tableau qui s’en dégage fait clairement la part du connu et du spéculatif. Il se limite aux premiers Mérovingiens, dans leur trajectoire de l’émergence à la puissance, laissant hors de son cadre la décadence ultérieure des prétendus « rois fainéants ». On suit ainsi l’ascension d’une dynastie de chefs barbares semi-romanisés qui possèdent des liens culturels avec les Huns. Rois chevelus à la mode germanique, les Mérovingiens règnent sur une ligue de peuples germaniques installés sur le Rhin et en Belgique, qui prennent le nom de Francs occidentaux. Ils se distinguent des autres royaumes barbares environnants par leur abandon tardif du paganisme, du reste compatible avec des relations cordiales avec l’épiscopat, puis par leur adhésion au catholicisme, choix qui contraste avec l’arianisme embrassé par leurs concurrents. Jalonné par les figures successives du mythologique Pharamond, du mal connu Clodion, de l’incertain Mérovée et du mieux situé Childéric, dont la tombe à Tournai, fouillée au XVIIe siècle, a livré un somptueux mobilier archéologique, le lignage trouve sa plus puissante incarnation avec Clovis, fils de ce dernier. Le rôle historique déterminant de ce roi-guerrier est à l’origine de son statut ultérieur d’icône religieuse et scolaire. Il est la cheville ouvrière de l’expansion du royaume franc qui, partant d’un territoire initial modeste, parvient à s’approprier la plus grande partie de la Gaule. Cette conquête ne s’explique pas seulement par les armes. Elle résulte également des qualités personnelles du roi franc, de l’importance politique des alliances matrimoniales de sa maison, et de son adoption du christianisme. Même si la tradition impute cette conversion aux pieux efforts de son épouse Clotilde, son schéma analogue à celle de l’empereur Constantin incite à y voir au moins autant un acte politique, qui lui permet de s’assurer le soutien de l’élite gallo-romaine. Son rôle de législateur est également important, car il est à l’origine de la codification écrite de la célèbre Loi Salique, fondée sur le wergeld germanique. Fixé à Lutèce, Clovis y élit l’église Sainte-Geneviève comme nécropole royale. La succession assurée par ses quatre fils n’est pas exempte de discordes mais maintient et renforce néanmoins les acquis de la dynastie.
Le tableau qui s’en dégage fait clairement la part du connu et du spéculatif. Il se limite aux premiers Mérovingiens, dans leur trajectoire de l’émergence à la puissance, laissant hors de son cadre la décadence ultérieure des prétendus « rois fainéants ». On suit ainsi l’ascension d’une dynastie de chefs barbares semi-romanisés qui possèdent des liens culturels avec les Huns. Rois chevelus à la mode germanique, les Mérovingiens règnent sur une ligue de peuples germaniques installés sur le Rhin et en Belgique, qui prennent le nom de Francs occidentaux. Ils se distinguent des autres royaumes barbares environnants par leur abandon tardif du paganisme, du reste compatible avec des relations cordiales avec l’épiscopat, puis par leur adhésion au catholicisme, choix qui contraste avec l’arianisme embrassé par leurs concurrents. Jalonné par les figures successives du mythologique Pharamond, du mal connu Clodion, de l’incertain Mérovée et du mieux situé Childéric, dont la tombe à Tournai, fouillée au XVIIe siècle, a livré un somptueux mobilier archéologique, le lignage trouve sa plus puissante incarnation avec Clovis, fils de ce dernier. Le rôle historique déterminant de ce roi-guerrier est à l’origine de son statut ultérieur d’icône religieuse et scolaire. Il est la cheville ouvrière de l’expansion du royaume franc qui, partant d’un territoire initial modeste, parvient à s’approprier la plus grande partie de la Gaule. Cette conquête ne s’explique pas seulement par les armes. Elle résulte également des qualités personnelles du roi franc, de l’importance politique des alliances matrimoniales de sa maison, et de son adoption du christianisme. Même si la tradition impute cette conversion aux pieux efforts de son épouse Clotilde, son schéma analogue à celle de l’empereur Constantin incite à y voir au moins autant un acte politique, qui lui permet de s’assurer le soutien de l’élite gallo-romaine. Son rôle de législateur est également important, car il est à l’origine de la codification écrite de la célèbre Loi Salique, fondée sur le wergeld germanique. Fixé à Lutèce, Clovis y élit l’église Sainte-Geneviève comme nécropole royale. La succession assurée par ses quatre fils n’est pas exempte de discordes mais maintient et renforce néanmoins les acquis de la dynastie.
Même si l’appropriation rétroactive des Mérovingiens comme première dynastie royale de l’histoire de France est un raccourci abusif, il n’est sans doute pas illégitime de leur reconnaître le statut d’ancêtres défricheurs de celle-ci. Moins sans doute en termes d’espace géographique que comme force motrice d’une ethnogenèse romano-germanique qui assure la transition entre la Gaule romaine et les prémisses du monde féodal. En cette fin du monde antique où l’Église chrétienne représente la continuité, les rois mérovingiens sont quant à eux des porteurs de modernité. C’est la leçon principale de cet exercice de vulgarisation réussie. En cent pages et cinq chapitres, complétés par un cahier d’illustrations bien choisies en couleur, une chronologie et une bibliographie, voici donc une mise au point très pratique pour découvrir et comprendre les Mérovingiens. Et apprendre incidemment que le vase de Soissons était sans doute un objet précieux en métal, ce qui fait sérieusement douter de la capacité d’un guerrier germain, même irascible, à le fracasser !© Guillaume Lévêque