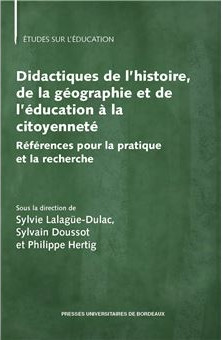Introduction par Sylvie Lalagüe-Dulac, Sylvain Doussot et Philippe Hertig : Si les références sont les valeurs, les lois, les règles…pour l’école il s’agira des programmes, des paradigmes pédagogiques…faut-il y inclure les résultats des recherches scientifiques ? Le croisement des références est inévitable : les chercheurs sont formateurs d’enseignants, ont (souvent) été enseignants et ont inévitablement été élèves. Classiquement, on mobilise les disciplines homonymes et leur épistémologie, les autres didactiques, les sciences de l’éducation, les autres sciences sociales, les savoirs de la pratique. Il y a toujours un risque à opposer théorie et pratique (ça reste délicat chez les praticiens-chercheurs). La temporalité joue : l’enseignant doit traduire ses références en situations viables sur le plan pédagogique, il n’a pas le loisir (le temps) de faire une analyse réflexive, des amendements, du comparatisme. Les chercheurs sont en dehors de toute pression sur les « bonnes pratiques » voulues par l’autorité.
Préambule « Pluralité des références et cohérence épistémologique » par Nicole Tutiaux-Guillon : les références sont d’abord nées dans les années 1980 à partir de l’objet étudié. Les références légitimes étaient la science homonyme et son épistémologie. Mais le temps de l’imprégnation de l’objet de la recherche nécessite d’aller voir ailleurs (psychologie, théorie des l’apprentissage, représentations…). Le cadre joue : faire de la didactique, c’est soit un laboratoire de sciences de l’éducation, soit un laboratoire de la science homonyme : dans les deux cas, on sera un chercheur minoritaire. Un bon schéma page 30 permet d’appréhender les « références métissées ». Que se passe-t-il quand on veut légitimer un nouvel objet à étudier didactiquement car on pense qu’il est potentiellement légitime ? On survalorise la part de l’épistémologie de la science homonyme dans les bibliographies. Le style d’écriture est la convocation d’un itinéraire intellectuel (et un renoncement à d’autres) différent selon qu’on s’intéresse à la didactique de la discipline ou à la science homonyme. On a, en France, une difficulté à mobiliser des références non francophones. Le problème c’est que les concepts de la recherche sont incorporés dans la culture professionnelle (transposition didactique, vulgate, représentations sociales…) sans tenir compte du contexte dans lesquels elles ils ont été créés. Un autre très bon schéma, page 36, clôture ce préambule autour du rapport entre posture épistémologique, instance de légitimation et conception de la didactique.
« Les Profs-chercheurs, sur le chemin de l’école. L’étude de cas des étudiants du master de didactique, mention histoire-géographie » par Sophie Gaujal : c’est ici un travail sur la posture du praticien chercheur, du prof chercheur qui permet peut-être de dépasser l’opposition théorie/pratique. A l’aide du cas du master de didactique de l’Université Paris 7, l’auteure récolte des témoignages d’étudiants : la salle des profs est stérile, il fallait un autre lieu pour avoir du recul réflexif et faire avancer sa pratique (mais la « sienne » réellement, pas la pratique en général). Les objets « mémoires » peuvent porter « sur » et « dans » le champ de la pratique et les objets peuvent être vus de l’extérieur ou de l’intérieur. Il y a convocation du « bricolage » (une posture vue comme « ingéniosité » ou négativement comme « approximation » qui trouve corps dans la recherche. Mais les profs-chercheurs deviennent très peu enseignants-chercheurs, ils reviennent à la pratique. De nombreux obstacles, administratifs notamment, sont soulevés. Le groupe « Pensée spatiale » qui a pu constituer un levier différent et original.
« Spatialité des élèves…de nouvelles références pour les recherches en didactique de la géographie » par Sylvie Joublot-Ferré : les savoirs géographiques spontanés et vernaculaires sont un angle mort des recherches en didactique. L’importance cruciale des spatialités des acteurs, matérielles et idéelles, est soulevée. A partir des années 1990, on veut répondre à la crise de la géographie (bon schéma page 67 qui débouche sur un second page 69 qui monte les différents axes de représentation de la didactique de la géographie). Le corps, l’expérience spatiale, est à convoquer pour sortir des classiques représentations qui peuvent parfois être des thèmes d’enseignements (une réponse modelable à des exercices déjà préconçus) et non des matériaux.
« Références en jeu dans l’étude de discours géographiques d’enseignants de l’école primaire » par Anne Glaudel et Thierry Philippot : ici, il est question de l’étude du discours géographique de l’enseignant en activité avec la classe via deux dimensions imbriquées : la dimension épistémique et la dimension didactique. Le discours articule la géographie spontanée, la géographie scolaire et la géographie universitaire qui innerve la géographie scolaire et révèle le croisement de plusieurs histoires (celle du sujet, de l’institution scolaire, de la géographie à enseigner, de la science de référence). Une méthode directe d’accès au discours est sollicitée mais aussi indirecte. Le corpus, ce sont 4 séquences d’enseignement portant sur le programme de 2008. Il y a mobilisation de la géographicité des enseignants et des élèves pour donner du sens. Cela entre en tension avec les concepts appris et/ou censés être transmis par les instructions officielles. Il y a différents mobiles : l’histoire du métier, éviter la peur de l’ennui, favoriser la liberté créative de l’enseignant…
« Les références de la didactique de la géographie à l’épreuve des représentations de la discipline de jeunes enseignants » par Sylvie Considère : il y a ici décalage net entre la géographie telle qu’elle devrait être et celle qu’elle est dans l’esprit des professeurs des écoles enquêtés. On est plus réceptif à ce qui conforte notre vision des choses qu’à ce qui la bouscule. L’auteure fait référence à la culture disciplinaire (Saussez, 2009). Chez les professeurs des écoles, le fait de ne pas avoir baigné dans de la géographie en début de parcours universitaire amène à ce qu’ils prennent appui sur leurs références d’anciens élèves (cycle secondaire). Mais ces pratiques n’ont pas été interrogées à l’époque et elles servent de grilles d’analyse, reconstruites a posteriori, pour faire de la didactique. Chez les étudiants enquêtés, on voit une géographie ayant pour objet l’espace (sans plus de définition) mais dont la finalité clé se limite à la localisation. La géographie qu’ils ont vécu leur a servi à avoir des connaissances sur le monde mais pas à le comprendre. Et, selon eux, cet objectif de compréhension n’apparait pas souhaitable spécialement pour leurs futurs élèves. La géographie familiarise à des outils variés. La situation du cours type autour d’un schéma d’étude de documents pour lesquels des notions sont à apprendre par cœur émerge (alors que, vu le contexte temporel, ils n’ont pas forcément vu ça dans le secondaire). Ils attribuent à la discipline, paradoxalement, un caractère ennuyeux mais des potentialités d’ouverture d’esprit. Une vision moins physique que par le passé mais une succession de chapitres empêchant une vision systémique, une discipline sans concepts. Des représentations qu’on sonde mais sans trop savoir quoi en faire. Peu de place à la co-construction, notamment de vocabulaire spécifique pour lequel on préfère la mémorisation-récitation de termes fixés par l’enseignant. Mais tout cela ne sert qu’à ceux qui sont déjà scolaires. Et la forme de la formation (courte, sans moments d’échanges entre enseignants-chercheurs, formateurs et aspirants) cumulée à une entrée dans le métier avec ses contraintes de devoir d’approprier la gestion de classe fait perdurer un modèle plutôt transmissif.
« La géographie prospective : entre formation du citoyen et formation disciplinaire » par Laurence Fouache : la prospective émerge en France dans les années 1950, sert la DATAR puis appelle le citoyen. Depuis les années 2010, l’institution scolaire s’en empare. Peut-elle servir la cause de la discipline enseignée en faisant évoluer le paradigme pédagogique ? On rappelle ici le paradigme classique, amenant didactiquement le modèle de la « boucle didactique » (Audigier, Crémieux, Mousseau, 1996) et de la « tradition didactique » (Lautier, 1997). Ici le paradigme est positiviste. La géographie prospective permet-elle de dépasser l’approche « d’une idée pour un lieu » (Clerc, 2002) et amener un peu d’aléatoire, de diversité et des contenus moins stabilisés ? Peut-on aller vers un paradigme constructiviste plus critique ? On a des finalités différentes attribuées à la prospective avec, soit un renforcement de contenus scolaires classiques, soit une remise en cause de ces contenus. En cycle 3, il y a un certain équilibre. En cycle 4, va dominer la version confortant le classique avec peu de visées citoyennes. Pourquoi ? En cycle 3, on ne cherche pas à faire des spécialistes, l’équipe de rédaction des programmes n’a pas été la même en cycle 3 et en cycle 4 ! Le cycle 3 permet le basculement pédagogique. Pour compléter, une enquêter auprès de professeurs de collège montre qu’ils attribuent à la prospective des finalités citoyennes tournées vers l’action davantage que vers l’apprentissage de valeurs communes.
« Evaluer les compétences en géographie à l’école primaire : selon quelles références ? » par Philippe Jenni, Walther Tessaro et Véronique Pamm-Wakley : le contexte est celui du plan d’études romanes, de la Suisse francophone avec une géographie explicative et systémique et non plus seulement descriptive et pratique. De nouveaux manuels sont parus. Quelles tâches sont proposées en évaluation ? Quelles tensions chez les enseignants ? On réfléchit à l’approche herméneutique/nomothétique/idiographique, au type d’exercice (restitution, application, tâche complexe), à l’appropriation (notions, utilisation d’outils, compétences de questionnement/d’analyse. Une enquête a porté sur 4 enseignants. Les résultats montrent une domination des tâches idiographiques (50 %) sur les nomothétiques (36 %) et herméneutiques (13 %). Il y a une domination des capacités visant à « s’informer » plutôt qu’à « se repérer », « analyser », « se questionner ». Et également une domination de l’application contextualisée, puis la restitution, puis enfin la situation complexe.
« Le paysage multisensoriel au cœur d’une ingénierie éducative, vers un curriculum de l’expérience » par David Bédouret : ici, nous sommes sur un modèle d’ingénierie didactique, le « TEM TER I 3 » (Temporalités et Territoires : innovation, investigation, imagination) via le paysage pour étudier l’EDD. Est convoqué l’angle du paysage multisensoriel pour passer du curriculum formel au curriculum réel en créant une expérience du territoire. Le croisement entre EDD, paysage et sensorialité, c’est cette combinaison qui n’est pas envisagée dans le curriculum formel. Des résultats de ce protocole demeurent fragiles : difficulté pour les élèves à dépasser la vision déterministe du présent, imagination bridée un peu comme si l’imaginaire était irrationnel avec la demande des enseignants. D’où le recours à un complément qu’est le « baluchon multisensoriel » (Théa Manola) qui comporte un carnet de voyage et d’autres supports d’expression (appareil photographique jetable, enregistreur numérique de poche, enveloppes pour recueillir des objets). La réalisation d’une carte sensible à partir d’une sortie équipée du baluchon est effectuée. Les cartes intègrent bien les changements socioéconomiques, le recours aux témoignages. Ces supports sont riches pour les discussions et permettent l’ouverture aux parents (sous forme d’exposition).
L’ouvrage comporte également des contributions en histoire sur les écrits de travail (Martine Champagne-Vergez), sur le fait religieux (Anne Vézier), sur la compatibilité des cadres théoriques de recherche et de la pratique d’enseignant (Lucie Gomez), sur la posture critique comme moteur de la didactique de l’histoire (Laurence De Cock et Charles Heimberg), sur les marges dans l’enseignement de l’histoire (Feredico Dotti) et en éducation à la citoyenneté sur le projet républicain (Jean-Charles Buttier).