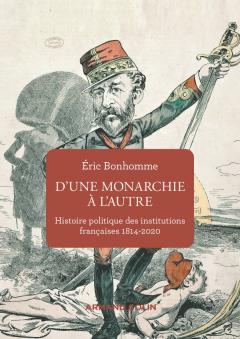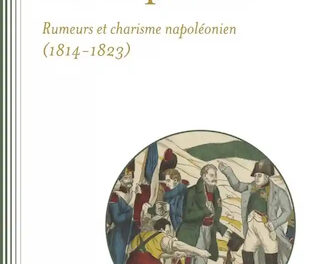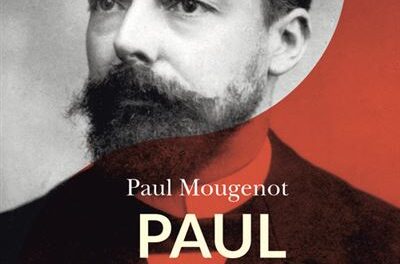On ne peut pas dire que les historiens se soient bousculés aux portes de l’histoire des institutions, tant la thématique semble dévolue aux politistes et aux constitutionnalistes. C’est donc un vide qu’entend combler l’excellente synthèse d’Eric Bonhomme, professeur honoraire de chaire supérieure. Vide tout relatif car il y a quelques années l’historien Nicolas Roussellier avait consacré une solide et fort belle somme au thème du fonctionnement des institutions françaises, sous l’angle du pouvoir exécutifNicolas Roussellier, La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXè-XXIè s., Paris, Gallimard, 2015.
Eric Bonhomme sollicite d’ailleurs très régulièrement les analyses de ce dernier pour étayer son propos. D’autres auteurs, comme Pierre Rosanvallon, ont intelligemment fréquenté les thématiques institutionnelles et constitutionnelles pour élaborer d’éclairantes analyses sur les pouvoirs dans la France contemporaine. Le livre d’Eric Bonhomme, qui combine les vertus spécifiques à l’essai et au manuel d’histoire politique, est donc aussi un bel hommage rendu à ses devanciers et confrères.
La France de l’époque contemporaine se caractérise, ce n’est une découverte pour personne, par une succession assez rapide de régimes différents qui signale sa « difficulté à créer un cadre constitutionnel pérenne, à la différence des pays anglo-saxons » (p. 6). Pour comprendre cette difficulté et expliciter le « tropisme monarchique qui se mue en césarisme sous les empires, en imaginaire providentialiste ou présidentialiste sous les républiques ultérieures » (p. 8), l’auteur entend explorer les interactions entre les institutions et la vie politique française, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrageHistoire politique des institutions françaises. Tropisme monarchique, l’expression est heureuse et justifie pleinement le titre du livre.
On ne lira donc pas une nouvelle histoire politique de la France contemporaine mais une histoire qui met l’accent sur les institutions (au sens large) dans leur dynamique politico-constitutionnelle. L’auteur commence son étude en 1814, car dès ce moment « se noue une tension entre principe de souveraineté nationale et personnalisation du pouvoir qui anime la vie politique française » (p. 9) et reste une constante jusqu’à nos jours.
Les temps monarchiques (1814-1879)
De 1814 à 1879, c’est le principe monarchique qui façonne les constitutions et les régimes associés et conditionne les pratiques politiques et institutionnelles. A vrai dire, la Charte du 4 juin 1814 n’est pas une constitution, même si elle installe une monarchie de type constitutionnel. Ce « monument d’ambiguïté » (p. 22) regarde davantage vers l’Ancien Régime que vers la Révolution : le bicamérisme (Chambre des Pairs et Chambre des députés) ne signifie pas que le régime soit parlementaire, le roi cumulant les trois pouvoirs et la pratique parlementaire étant réduite à peu de choses ; le règne de Charles X (1824-1830) porte par ailleurs des coups sévères aux libertés et les ultras qui dominent un temps la scène politique essaient d’instrumentaliser la Charte dans le sens de leurs convictions réactionnaires, partagées par le roi. Et c’est, selon l’auteur, « le refus d’interpréter la Charte dans un sens parlementaire qui emporte la Restauration » (p. 25) en 1830.
Le peuple, quasiment absent de la Charte, fait son grand retour au moment des Trois Glorieuses. Or, le nouveau monarque, Louis-Philippe Ier, se contente de toiletter la Charte (14 août 1830). Officiellement, si le peuple est à la source du pouvoir et si un rééquilibrage s’opère entre les pouvoirs respectifs du roi et des Chambres, en réalité, la plénitude du pouvoir exécutif royal est maintenue tout comme le système censitaire. On constate toutefois une dynamique parlementaire plus nette que sous la Restauration, mais le roi instrumentalise les Chambres au profit de son propre pouvoir. L’évacuation du peuple, au sens large, de la vie politique conduit à la montée des revendications démocratiques qui jouent un rôle non négligeable dans la révolution de 1848 : « La Restauration était morte d’avoir ignoré la Charte, la monarchie de Juillet meurt de l’avoir conservée, ou peut-être de n’avoir su l’amender » (p. 40).
En dépit de l’instauration de la République à ce moment, les républicains pèsent peu sur le cours du régime, puisqu’on assiste à une rivalité entre les monarchistes, désireux de reprendre le pouvoir, et Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République, démocratiquement élu (le suffrage universel, masculin, ayant été adopté en 1848), qui le confisque à son profit grâce au coup d’État du 2 décembre 1851. En fait, à partir de 1849 « la Constitution n’est plus qu’un cadre formel habité par le principe monarchique, qui se dédouble dans un affrontement entre le parti de l’Ordre qui admet le régime parlementaire et refuse la démocratie et le bonapartisme qui admet la démocratie mais refuse le régime parlementaire : deux manières de nier la République, qui est précisément l’association des deux » (p. 58).
Le régime impérial, qui succède à la Deuxième République, incarné par un seul homme, aux soutiens fragiles et opportunistes, ne résiste pas aux vents de l’histoire : il s’effondre le 4 septembre 1870 au profit de républicains… qui se gardent dans l’immédiat de lancer un processus constitutionnel. Le gouvernement s’intitule d’ailleurs « de la Défense nationale » et non pas « républicain », car il est dirigé par un orléaniste libéral, Trochu.
Le nouveau pouvoir est uni dans son rejet de l’Empire. Pour le reste… L’auteur consacre alors de très bonnes pages à la Commune de Paris en 1871, « moment exceptionnel de l’histoire de France, le seul où le peuple en armes devient le fondement du pouvoir constituant, comme contre-pouvoir d’abord face au Gouvernement du 4 septembre, puis face à l’Assemblée nationale réunie à Versailles. » (pp. 85-86). Sa défaite face au Gouvernement ampute l’idéal républicain de sa composante révolutionnaire. La République qui concourt alors face aux monarchistes, toujours étreints par leur désir de revanche-restauration, est donc une République « modérée », à laquelle peut se rallier Thiers…
En attendant, les lois constitutionnelles de 1875 sont un texte de compromis, clairement monarchiste, qui crée un régime à la fois présidentiel et parlementaire. Pour Eric Bonhomme, c’est « une charte de 1830 améliorée, mâtinée du parlementarisme mis en place par Napoléon III en 1870. Le seul élément authentiquement républicain est le maintien du suffrage universel pour désigner les députés » (p. 99). Les Républicains vont s’en accommoder et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour en déposséder les monarchistes. Les élections qui scandent les années 1876-1879 et la crise institutionnelle de 1877 leur permettent de parvenir à leurs fins. Grâce au suffrage universel, les républicains contrôlent bientôt l’essentiel des rouages politiques. La République est établie, le danger monarchiste écarté. La séquence 1814-1879 est donc l’histoire « de l’impossibilité de conjuguer le principe monarchique avec le régime constitutionnel et parlementaire » (p. 104).
Les temps parlementaires (1879-1958)
La République est établie, reste à l’ancrer dans la durée. Le chapitre 7 indique le défi qui se pose aux républicains : « Incarner l’abstrait ». Pour cela, quelques personnalités, aux profils divers, sont mis en avant (bustes, noms de rues) : Gambetta, Hugo, Pasteur. Les institutions scolaires participent puissamment à l’édification républicaine tout comme les présidents de la République qui symbolisent, d’une certaine façon, la République lors de leurs voyages dans le pays (à ce sujet d’ailleurs, l’auteur y voit un évident héritage bonapartiste). La promotion et la défense de la République doivent également passer par le droit, notamment constitutionnel, qu’on généralise dans l’enseignement supérieur consacré.
Pour écarter l’éventuelle menace d’une restauration monarchique, la révision constitutionnelle de 1884 empêche toute modification de la forme républicaine et interdit aux « membres des familles ayant régné sur la France » de se présenter à une élection présidentielle. Enfin, « les républicains de gouvernement adossent […] leur maintien au pouvoir au mode de scrutin dont les textes constitutionnels français […] ne disent jamais rien. Comme ils ont endossé le costume de la notabilité, ils n’ont aucun intérêt à modifier le scrutin uninominal à deux tours qui avait cours sous le Second Empire [et qui] permet aussi à une aristocratie élective, qui a remplacé celle du sang, de se maintenir au pouvoir » (p. 127).
La IIIè République se caractérise par une instabilité gouvernementale : entre le 24 février 1879 et le 12 mai 1899, vingt-neuf gouvernements se succèdent, soit une moyenne de neuf mois par ministèreet cela continue jusqu’au terme de la Troisième République : dix-sept gouvernements entre juin 1899 et juin 1914, dix-huit dans les années 1920 ; entre février 1930 et mars 1940, la durée moyenne d’un ministère est inférieure à 6 mois…. Cette instabilité signale clairement « que la République est entrée dans un système où le parlement est roi » (p. 132) et favorise la montée d’une contestation antiparlementaire.
La continuité du pouvoir semble s’incarner dans la personne du président de la République. Entre les deux, on ne peut que constater la faiblesse de la présidence du Conseil. Jules Ferry était partisan d’un renforcement de celle-ci, appuyée sur une majorité parlementaire solide qui la laisserait gouverner jusqu’à la reddition des comptes. Il n’en a rien été : la montée en puissance des radicaux, favorables au régime d’assemblée, n’a pas facilité les choses.
A partir des années 1900, les radicaux règnent à la Chambre des députés et plus encore au Sénat, le grand « fossoyeur de réformes » (p. 166) qui auraient pu contribuer à limiter la toute-puissance parlementaire et faire avancer quelques thèmes clés : la question sociale (négligée par les républicains de gouvernement, notamment par haine du socialisme et en raison des liens étroits qui unissent les sphères politiques et les milieux patronaux), la question du suffrage féminin (bloquée par l’hostilité de larges fractions parlementaires) et la question des colonies (elles ne sont pas citées dans les lois constitutionnelles et forment un espace dans lequel le principe de séparation des pouvoirs et le droit républicain sont bafoués).
Il est toutefois des moments pourtant où le Parlement et le gouvernement savent marcher main dans la main : ainsi, lors de la préparation et du vote de la loi de Séparation des Eglises et de l’État (1905), « l’exemple même d’une complémentarité réussie du Parlement et du gouvernement dans une réforme d’ampleur » (p. 169) ou lors de la Première Guerre mondiale, quand le pouvoir exécutif (en fait, le président du Conseil) voit sa capacité d’action renforcée, surtout avec Clemenceau à partir de 1917.
Le Parlement continue toutefois de jouer son rôle, grâce aux commissions, qui auditionnent les représentants du gouvernement, dont le président du Conseil, et aux comités secrets. S’opère donc un rééquilibrage des pouvoirs entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Par ailleurs, Clemenceau parvient à subordonner le pouvoir militaire au pouvoir civil et à donner corps à un exécutif politico-militaire incarné par son tandem avec Foch.
« La guerre a […] montré [que la République française] pouvait être gouvernée autrement, par un exécutif renforcé et interventionniste adossé à une représentation nationale vigilante. Mais la classe politique n’a sans doute pas pris conscience que c’est ce rééquilibrage des pouvoirs qui a permis au régime de traverser victorieusement la guerre, en maintenant le lien entre le pouvoir républicain et la société civile. A contrario, les empires autoritaires qui ont fait le choix de laisser gouverner les militaires au mépris de leurs populations se sont effondrés » (p. 192).
On en revient donc, une fois la guerre terminée, au « parlementarisme absolu » qui préfère, en 1920, élire Paul Deschanel à la présidence de la République plutôt que Clemenceau.
Dans les années 1920 et 1930, la question de la réforme de l’Etat s’installe au coeur de la vie politique française, sans aboutir pour autant à des bouleversements majeurs. Le blocage institutionnel est dû principalement au poids retrouvé d’un Parlement peu enclin aux réformes qui le conduiraient à donner plus de force à l’exécutif, et en particulier au président du Conseil qui, de manière constante, ne parvient pas à s’appuyer sur une majorité parlementaire (aucun parti politique ne dispose de la majorité et la discipline de vote n’existe pas). Le parti radical, pivot de la vie politique et des coalitions électorales, porte une lourde responsabilité :
« […] si les radicaux pèsent très lourd dans les vingt dernières années de la IIIè République, ils sont surtout un poids mort : partisans inconditionnels du régime parlementaire, ils bloquent la réforme des institutions ; enracinés dans la haute administration coloniale, ils empêchent toute évolution démocratique à l’intérieur de l’Empire ; majoritairement misogynes, ils interdisent l’accès des femmes à la citoyenneté ; pacifistes, et parfois pacifistes intégraux, ils continuent de privilégier l’action de la SDN à l’heure où Hitler fourbit le glaive » (p. 202).
Pour limiter le pouvoir de blocage du Parlement, des chefs de gouvernement n’ont pas hésité à recourir aux décrets-loi. Doté d’un programme qui sert de plate-forme électorale, Léon Blum parvient ainsi à imposer au Parlement une « cadence rapide » pour le vote des réformes. Las, les choix militaires et idéologiques faits au début de la Seconde Guerre mondiale conduisent à la fin de la République : Eric Bonhomme souligne à cet égard le rôle éminent de l’armée dans ce processus.
Au temps de l’Affaire Dreyfus, l’Etat avait été « longtemps à la remorque » (p. 153) d’une armée largement composée, dans ses strates supérieures, de monarchistes et d’antisémites, et donc plus que réticente à l’égard de la République. Quand Philippe Pétain prend le tête du gouvernement, ce sont ces militaires qui s’imposent au pouvoir civil : « L’armistice […] permet aux militaires de transférer la responsabilité de la défaite sur les politiques, et donc de justifier le démantèlement du régime » (p. 212).
Il appartient donc à la Résistance de penser le rétablissement de la République. Le programme du C.N.R., qui sert de fondement à la politique du G.P.R.F. puis aux dirigeants de la IVè République, vise à créer une république économique et sociale : « Comme en 1848, la République s’annonce révolutionnaire » (p. 223). Les débats à l’assemblée constituante tout comme l’architecture de la nouvelle Constitution (1946) montrent cependant combien il semble compliqué de « sortir de la logique tertio-républicaine de la souveraineté parlementaire » (p. 231). Le président de la République est affaibli et le Sénat disparaît.
L’assemblée nationale est donc toute-puissante et ne se prive pas de prendre en otage les gouvernements successifs, même si, par moments, des hommes, comme Pierre Mendès France, parviennent à imposer leur rythme à l’assemblée. Mais le régime, très fragile, finit par sombrer dans les flots, parfois tumultueux (guerre d’indépendance algérienne), de la décolonisation de l’empire…
Les temps présidentiels (depuis 1958)
En 1958, de Gaulle, républicain pragmatique, se sert de l’armée, désireuse d’instaurer un pouvoir fort susceptible de conserver l’Empire, comme d’un levier pour revenir au pouvoir. Il s’agit d’« un chef-d’oeuvre de coup d’Etat, qui revêt toutes les apparences de la légalité » (p. 247). De Gaulle entend dès lors instaurer un pouvoir présidentiel fort, élu au suffrage universel. Le Parlement est réduit à « une simple coquille » (p. 251), car dans la pratique on le dépossède d’une grande partie de sa capacité à fabriquer les lois.
« […] de Gaulle réussit la synthèse de deux passions françaises en apparence antithétiques, celle de la République et celle de l’homme providentiel. Le texte de 1958, amendé en 1962, réconcilie le goût de la République et celui de l’autorité : il guérit les partisans d’un exécutif fort de leur antirépublicanisme et guérit aussi, à l’usage, les républicains parlementaires de leur phobie du césarisme […] » (p. 254).
Malgré des différences évidentes (style, ambition réformatrice, bilan), ses deux successeurs (Pompidou et Giscard) n’ont pas cédé un pouce de leur pouvoir. Les crises qui n’ont pas manqué de se produire entre le président et le premier ministre (Pompidou-Chaban, VGE-Chirac) en disent long à ce sujet.
En 1981, l’auteur du Coup d’Etat permanent (1964), qui marquait une opposition déterminée aux institutions gaulliennes, arrive au pouvoir. Or, François Mitterrand « s’est coulé sans peine dans les habits de la présidence absolue » (p. 280). La Constitution a été à peine retouchée. « Le président Mitterrand n’a touché ni au septennat, ni à l’article 16, ni à l’article 11, [donc] à aucun des textes dont la modification aurait pu altérer son pouvoir. Si celui-ci a diminué, c’est du fait d’un changement de majorité politique qu’il n’avait pas souhaité » (p. 289) débouchant sur une cohabitation (1986) :
« La cohabitation dévalue le rôle du président de la République et réévalue celui du Premier ministre et du Parlement. Les constitutionnalistes estiment qu’elle fait fonctionner la Vè République comme un régime parlementaire. Sauf qu’à la différence du cas des démocraties parlementaires classiques, le chef de l’Etat n’est pas politiquement neutre […] » (pp. 291-292).
Ultérieurement, malgré de multiples symptômes de dysfonctionnement, la démocratie s’approfondit sur certains points, avec la création en 2008 d’un Défenseur des droits indépendant des trois pouvoirs ou l’instauration de la Q.P.C.« question prioritaire de constitutionnalité instaurant un contrôle a posteriori de la loi qui donne la possibilité à tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, par l’intermédiaire du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, s’il estime que la loi appliquée est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution » (p. 325).
En 2000 intervient la réforme du quinquennat dont Eric Bonhomme pointe avec justesse les conséquences néfastes sur le fonctionnement démocratique et institutionnel : le quinquennat dévalue en effet la fonction de Premier ministre en faisant plus que jamais du président de la République le chef d’une majorité parlementaire. Et comme cette majorité est souvent écrasante, le Parlement redevient une chambre d’enregistrement. La révision constitutionnelle de 2008 avait pourtant semblé redonner au Parlement un rôle notable dans la confection de la loi et le contrôle de l’action de l’exécutif.
En réalité, le gouvernement se montre aussi interventionniste dans le domaine législatif qu’auparavant; il utilise largement la « procédure accélérée » (permettant de faire voter un texte de loi sans passer par la case Sénat) et a recours au « vote bloqué » (sur la réforme des retraites en 2010) ainsi qu’aux ordonnances, devenues « le principal mode de législation » (p. 330). Enfin, « en devenant chef de la majorité, le président cristallise les insatisfactions » (p. 332) d’où l’impopularité constante des derniers présidents et la relative popularité de leurs Premiers ministres respectifs.
Faut-il pour autant faire de la Constitution de la Vè République la responsable des défaillances et des dérives constatées qui minent la représentation démocratique et le fonctionnement équilibré des institutions et, donc, envisager une VIè République? L’auteur ne le pense pas. La réflexion doit, selon lui, s’engager en particulier autour du mode de désignation du président et de la nature de son pouvoir dans une République moderne : or, pour l’instant, « le monarque républicain demeure assis sur son trône », le président de la Vè République demeurant « un totem constitutionnel » (p. 336).
Appuyé sur une bibliographie constituée de quelques-uns des meilleurs livres et rédigé par une plume talentueuse et dotée d’un vrai sens de la formule, le livre d’Eric Bonhomme est passionnant de bout en bout. C’est une mine d’informations et d’analyses pour tout professeur désireux de nourrir un cours d’histoire contemporaine de la France. Il comporte en outre un remarquable chapitre consacré à « La République en Europe » qui montre bien le rôle majeur de la France dans l’histoire de la construction européenne mais aussi, à travers la procédure de « révision-adjonction », combien la France se montre réticente à faire entrer l’Europe dans sa Constitution.
Un livre à lire et à méditer!