Après les biographies des généraux Georges, Corap et Weygand, Max Schiavon poursuit son autopsie du haut commandement de l’armée française en 1940 en couchant sous son scalpel le généralissime failli Maurice Gamelin. Il est d’usage dit-on, de ne pas tirer sur les corbillards, et celui de Gamelin est, devant l’histoire, déjà bien criblé. Mais force est de convenir que le « mystère Gamelin » exposé par Max Schiavon vire à nouveau en un « procès Gamelin » on ne peut plus justifié. Comment un aussi brillant sujet a-t-il pu ainsi entraîner toute l’armée française dans sa chute ? Il est clair que la responsabilité globale est collective, ce que Marc Bloch a très tôt et très lucidement établi. Cela ne peut toutefois conduire à minorer le rôle de Gamelin en tant qu’horloger de la défaite.
La débâcle de 1940 est tout à la fois une question de caractère, de doctrine et de moyens. Gamelin se situe à la croisée de ces trois insuffisances. C’est le point d’aboutissement en apparence illogique d’une carrière exceptionnellement brillante. Quel sujet remarquablement doué que ce Gamelin ! Issu d’une famille de forte tradition militaire, il embrasse la carrière des armes comme une évidence. Tous les chefs qui l’ont employé l’ont remarqué, loué et poussé vers le sommet. Élève de Foch à l’École de Guerre, proche assistant de Joffre pendant une grande partie de la Grande Guerre, son talent lui vaut un avancement accéléré. C’est un pur officier d’état-major qui voit le combat de loin, y compris dans ses responsabilités opérationnelles sur le front, puis au Levant après la guerre.
Il sert ensuite quelques années à la tête de la mission militaire française au Brésil, avant d’accéder aux hautes responsabilités en métropole. Il succède pleinement à Weygand à la tête de l’armée en 1935. Gamelin est alors en mesure de modeler l’outil militaire selon son appréciation de la menace à venir. Le moins qu’on puisse en dire est que le résultat laisse à désirer. Il y a encore énormément à redire sur tous les plans en juin 1940, lorsque la Wehrmacht passe à l’attaque.
La personnalité complexe du personnage est au cœur de l’équation. Le portrait qu’en dégage Max Schiavon est en clair-obscur. Capacités intellectuelles exceptionnelles, vaste culture et sens de la synthèse caractérisent ce grand travailleur et peuvent justifier son ambition. Mais d’autres traits sont moins avantageux. L’homme est habile à l’excès. Conciliant jusqu’au compromis, manœuvrier jusqu’à la duplicité, c’est un opportuniste d’un souplesse d’échine étonnante.
La chose va de pair avec un net manque de caractère, d’imagination et de volonté. Théoricien militaire ingénieux mais inapte à l’imprévu, il est un conseiller indécis et temporisateur auprès du gouvernement. Sur le plan intellectuel et humain, il n’emporte ni l’affection ni l’adhésion de ses grands subordonnés, que conduit le seul esprit de discipline. Certains de ses détracteurs lui prêtent une « mentalité de préfet », ce qui n’est pas tout à fait un compliment à son niveau de responsabilité ! Même son principal protecteur politique Édouard Daladier le qualifie d’« édredon »…
Sa conception du commandement est un vice majeur. Gamelin en a une approche olympienne et désincarnée. Il analyse les situations mais s’abstient de décider. Il parvient ainsi à la fois à lier les mains de ses grands subordonnés et à leur laisser le choix de trancher, ce qui lui permet de faire assumer à d’autres ses propres erreurs. C’est un homme qui ne semble « pas trempé pour commander » comme l’avait dit Joffre en 1914 d’un de ses généraux défaillants (Pouradier-Duteil). Gamelin est un chef ne sachant pas ou ne voulant pas « cheffer ». Son style de commandement caractérisé par l’évitement prend une ampleur calamiteuse avec la guerre.
Le bilan dressé par Max Schiavon est consternant. Le tableau des chimères stratégiques du généralissime sidère. Il néglige les enseignements de la guerre éclair en Pologne, convaincu de la fragilité mécanique des blindés. Il fait délibérément l’impasse sur l’hypothèse d’une attaque par les Ardennes dont certains de ses généraux ont pourtant l’intuition prémonitoire. On reste pantois devant la réorganisation aberrante du commandement de l’armée qu’il prescrit en décembre 1939 : elle aboutit à diluer les circuits de décision ! Et ce décideur si timoré conçoit une manœuvre particulièrement téméraire pour contrer l’attaque allemande en Belgique, tombant ainsi dans le piège tendu par l’adversaire.
Battu, dépassé, submergé, Gamelin reste trop imbu de lui-même pour être capable d’admettre ses erreurs. Il ne songe plus alors qu’à se défausser sur les autres. Le 19 mai 1940, sa dernière grande directive avant son limogeage est un monument de stratégie inapplicable. Sa substance fait songer à la cinglante sentence du général MacArthur : « Les batailles perdues se résument en deux mots : trop tard ». Surtout, son entame est digne d’une anthologie de la fourberie : « sans vouloir intervenir dans la conduite de la bataille en cours » ! Mais quelle sorte de chef est-ce donc là ?
Son souci des apparences va jusqu’à l’indécence. Il ose ainsi dire publiquement à son successeur Weygand, lors de la passation de pouvoir : « en somme je ne vous laisse pas une si mauvaise situation » !!! Il fait encore valoir son art de l’esquive lors du procès de Riom, événement où la vindicte pétainiste lui permet pratiquement de passer pour une victime. Mais le procédé atteint ses limites après la guerre. Discrédité et ostracisé, Gamelin s’acharne en vain à dénier ses responsabilités jusqu’à son dernier souffle.
Pourtant, Max Schiavon souligne avec justesse que les carences de Gamelin ne sont pas exclusivement imputables à sa seule personne. Il faut replacer son parcours de carrière et son accession au zénith de la hiérarchie militaire dans son contexte politique. Gamelin est aussi le produit du système vicié de la IIIe République, obsédé par la crainte des « généraux de coups d’État ». Les dirigeants en place ont donc tendance à faire primer l’allégeance idéologique sur la capacité. L’Affaire des fiches avait été un premier avertissement sans frais. Puis il avait fallu un grand coup de balai en 1914 pour assainir à peu près le haut commandement. Encore cela avait-il été possible parce que Joffre, lui-même issu de cette logique frelatée, possédait les qualités de décision nécessaires…
Or Gamelin fait partie des grands chefs qui rassurent. Il est notoirement proche des radicaux, parti essentiel et influent de la vie gouvernementale de l’entre-deux-guerres. Il est même clairement le poulain de Daladier, l’homme fort du parti. En outre, son caractère accommodant est perçu comme une garantie. La vérité est qu’on apprécie en haut lieu qu’il soit dépourvu de l’énergie d’un Joffre ou d’un Weygand (hélas, les Allemands aussi…). Le couple politique indissociable qu’il forme avec Daladier conduit Max Schiavon à associer ce dernier à la responsabilité de la catastrophe. En effet, le dirigeant radical avait conscience de la défaillance cruciale de son affidé mais s’était obstinément refusé à le congédier, au point de jouer l’obstruction lorsque son successeur à la présidence du conseil Paul Reynaud, percevant l’incurie du personnage, avait tenté de le déboulonner peu avant l’offensive allemande.
La biographie signée par Max Schiavon sur Gamelin n’est pas la première. Mais elle marque par son ampleur et sa profondeur. La richesse de la documentation utilisée est à noter, notamment les archives privées des protagonistes majeurs auxquelles il a pu avoir accès, à commencer par celles de l’ex-généralissime lui-même. La matière bibliographique consultée est tout aussi ample (seul petit regret : l’absence de cahier d’illustrations photographiques). Il en ressort un portrait précis et sans doute exhaustif d’un personnage singulier, à certains égards lamentable, et foncièrement inexcusable.
Son insuffisance dans la préparation à la guerre et son impuissance dans la déroute de 1940 ne font plus mystère. La pire erreur de casting de l’histoire militaire française ressemble en somme étonnamment au président Albert Lebrun, tel que l’a cruellement décrit Charles de Gaulle : « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un État ». Il en est de même de Maurice Gamelin. À ceci près que si le président était un organe accessoire au bon fonctionnement du pays, tel ne pouvait pas être le cas du généralissime……



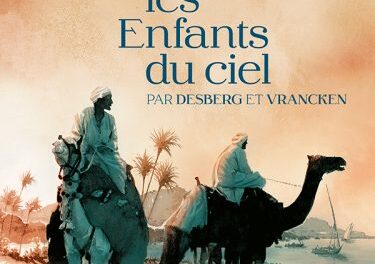

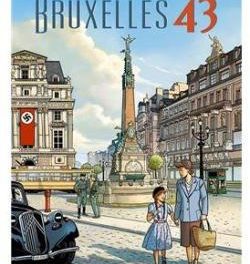









Bonjour.
En effet, l’objet d’une recension est de rendre compte du contenu d’un ouvrage, ce qui ne revient pas à soutenir une opinion. L’histoire est fondamentalement un travail d’analyse et de compréhension.
L’auteur est effectivement l’historien des chefs de 1940 (vous oubliez Corap dans votre tour d’horizon) sur lesquels son accès privilégié aux sources privées des intéressés apporte bel et bien du nouveau. Et le moins est de convenir que sa biographie de Gamelin n’a rien d’une apologie…
Enfin sur le fond, je ne saisis pas le motif de votre alacrité. Le caractère partisan et politique du procès de Riom est une évidence historique incontestable. Mais je crains que cela soit tout de même très insuffisant pour réhabiliter le lamentable Gamelin, si tel est le but de votre argumentation…
Je vois qu’à travers votre « analyse » vous soutenez la thèse du gouvernement de Vichy (il « suffit » de lire l’acte d’accusation du procès de Riom), portée par un auteur qui encense dans ses biographies, le général Weygand, fossoyeur de la IIIe République avec le maréchal Pétain, le général Huntziger, qui aura ouvert la « porte » au corps blindé de Guderain, ministre de la Guerre de Vichy et du général Georges, qui s’effondra nerveusement alors qu’il doit commander les combats, et qui voudra s’affronter au général de Gaulle. “À vaincre sans péril on triomphe sans gloire” !