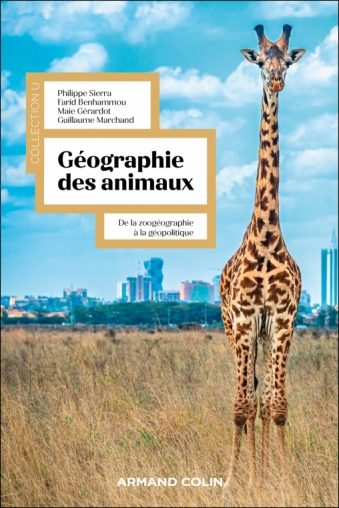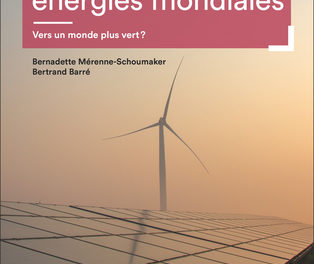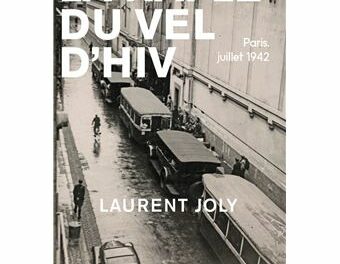A l’heure où la déforestation et la défaunestation se font de plus en plus criantes, la question du rapprochement entre l’homme et l’animal se pose, pour le meilleur et pour le pire ! Cet ouvrage entend combler un vide sur cette géographie du monde animal : la dernière étude systématique rédigée par Marcel Prenant sous un angle biologique datait de 1933 et la synthèse géohistorique plus récente de Xavier de Planhol (2004) n’eut qu’un impact limité. Pourtant, à en croire l’extrême richesse de la bibiliographie, il y a bien matière à rédiger sur la question animale.
Déjà comment les nommer ? Idéalement, des « animaux non humains » ou des « animaux autres qu’humains » étant nous-mêmes des animaux. Il convient de rappeler que les espèces sont « sentientes » (douées de sensations) mais que ce terme est souvent réservé aux seuls animaux terrestres (ceux qui domineront l’ouvrage). Comme l’homme a vu dans l’animal des usages variés (prédation, amplification de la force de travail, moyen de locomotion…), les termes pour les définir sont multiples : on peut ainsi s’arrêter sur les animaux sauvages, les animaux domestiques et les commensaux qui, eux, ont les caractéristiques des animaux sauvages mais dépendent des milieux anthropisés. L’occasion est faite de remettre en cause notre exceptionnalisme humain et notre rapport de domination.
La géographie classique n’a que difficilement pris en compte les animaux même s’ils ne sont pas absents des travaux de cette époque. Plus récemment, on a pu les exclure de définitions du tournant social en géographie. C’est là encore l’occasion de repenser le rapport homme-milieu. Une première bonne figure, p 17, montre que la géographie des animaux interpelle les champs biophysiques et sociaux/humains. Les animaux sont des actants, ils ont une agentivité. Ils sont considérés de façons très diverses selon les cultures (on les protège, on les mange, on les vend…).
Les animaux sauvages dans leurs environnements
Ce premier chapitre s’intéresse à la répartition du vivant animal sauvage et montre qu’il est difficile d’établir des localisations car une espèce peut être présente : 1/ à un endroit donné, 2/à plusieurs endroits, 3/partout. On doit prendre en compte des facteurs limitants (température, présence de l’eau ou non) et le rôle de plusieurs autres facteurs : la sélection naturelle, l’endémisme, l’adaptation qui permet une diffusion sur le temps long, les sociétés humaines qui introduisent des espèces ou en font disparaitre. En fait, la zoogéographie est moins évidente que la botanique.
L’endémisme s’applique mal aux fonds marins (l’océan est continu et il doit s’apprécier en volume et non en surface). Trois critères sont déterminants : la lumière, la température et les nutriments disponibles. Proche de la surface, la zone photique concentre la majeure partie de la vie animale marine.
La niche (habitat et relations fonctionnelles au sein de cet habitat) est théorique à travers l’idée qu’à une d’elle correspond une seule espèce : il y a différenciation et compétition.
L’animal agit sur son espace : il consomme la ressource, il modèle (la zoogéomorphologie). La territorialisation se fait par le son (chant) et l’odeur (phéromone) mais cela a un triple coût (l’animal s’expose, se fatigue et risque la blessure si confrontation il y a). La taille des territoires est liée à la disponibilité en nourriture (plus celle-ci est rare, plus le territoire doit être vaste).
Les sociabilités animales peuvent être étudiées sous trois angles :
1/entre individus d’une même espèce : plus ou moins grande concurrence selon qu’on vit en groupe ou non (attaques dans les zones de conquête pour agrandir son territoire),
2/entre individus d’espèces différentes : rapport proie-prédateur notamment,
3/entre animaux et humains : relations pacifiques – commensalité.
Les localisations sont constamment modelées et remodelées par les présences et absences en fonction des temporalités. La figure du « paysage de la peur », p 39, illustre ces éléments.
L’anthropisation du globe réduit les biomes et crée des « anthromes » qui questionnent la place des animaux en leur sein. Diverses espèces trouvent refuge en ville et bénéficient des déchets de consommation de l’homme.
Les stratégies d’adaptation coexistent entre des espèces plus ou moins mobiles et des espèces plus ou moins fixes. L’homme aménage l’espace pour développer une « compensation écologique » et pour optimiser la connectivité des « zones naturelles ». Attention à ne pas voir ça que sous l’œil de la vue aérienne et à tenir compte de la troisième dimension verticale (pylônes, façades, parois…) pour englober les modalités de déplacements de chaque espèce et penser à une « connectivité fonctionnelle ». Les routes génèrent hélas de nombreux décès.
Les questions animales et le changement global
Avec le changement global, les animaux sont vus comme des témoins, victimes et acteurs des transformations à l’œuvre. La prédation et l’extinction par l’homme sont en hausse constante et ce, pour des raisons différentes : la modification des habitats naturels, les usages commerciaux des animaux, l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes.
L’animal ne représente qu’un faible pourcentage sur l’ensemble de la biomasse (par rapport au végétal notamment). La biodiversité est difficile à mesurer (des lieux sont inaccessibles) et quelles peuvent être les méthodes appropriées ? La comparaison entre deux milieux ? Ou alors, le suivi d’un lieu ? Mais s’il y a des disparitions, il peut aussi y avoir des apparitions.
Il y a une charge symbolique négative très forte pour certaines espèces « exotiques » (frelons, ragondins…) alors que le lapin de garenne ou le faisan prolifèrent dans l’indifférence. Le terme « invasion » est excessif : cas du frelon « asiatique » qui s’attaque à la plus sympathique abeille. Les pièges sont peu efficaces et, au passage, englobent d’autres espèces, faisant ainsi davantage de dégâts que l’espèce ciblée elle-même !
Les effets du réchauffement sur les animaux entrainent des déplacements pour adapter le métabolisme, les chaines alimentaires et l’habitat. Les migrations, y compris saisonnières, se font vers les hauteurs et les latitudes plus fraiches. Mais attention à la différence de rythme entre le déplacement et l’adaptation de l’animal et celle du couvert végétal dont il dépend (plus lente). Attention aux co-extinctions (chaines). Le problème se pose aussi pour les espèces fixes ne pouvant migrer (cas emblématique des coraux).
Les animaux des humains
Ce chapitre débute par une analyse de l’élevage qui est à usage alimentaire surtout mais qui permet de fournir laine, cuir et source d’énergie. Les animaux alimentent certains secteurs professionnels (combat, chasse, accompagnement des handicapés, cobayes pour la recherche scientifique). Les conditions d’élevage et d’abattage sont très différentes. Le marché mondial des productions animales est dominé par la Chine, l’Inde et le Brésil. Le chapitre expose un inquiétant focus sur le poulet calibré jusqu’à l’os pour satisfaire la consommation humaine. Il est aussi question de l’impact avéré des animaux, bovins surtout, sur le réchauffement climatique de par le CO2 et le méthane. D’un autre côté, la hausse des phénomènes météorologiques extrêmes nuit à la ressource alimentaire de ces animaux d’élevage. Le chapitre traite aussi des épizooties, du véganisme et du bien-être animal.
L’animal de compagnie n’est pas forcément domestique ni même apprivoisé. La moitié de l’humanité en possède un, surtout en Amérique et en Asie. Le chat et le chien dominent. Cela représente un véritable marché (aliments, produits de soins…), accéléré pendant la crise du COVID-19 et représentatif des jeunes qui tardent à avoir des enfants mais également des personnes âgées. Les « nouveaux animaux de compagnie » sont un cas particulier, soumis à un fort trafic (le 3ème après la drogue et les armes) et participant à l’érosion de la biodiversité sans compter le risque de générer des zoonoses et de devenir invasives.
L’animal vu comme une force de travail permet de porter ou tirer une charge. Remplacé par des machines, il peut revenir à la mode comme moyen de transport de personnes (cas du cheval). Les autres usages sont la chasse, la recherche de truffes, le gardiennage, l’accompagnement des aveugles, la détection des pathologies par l’odeur, le sauvetage, les usages militaires et la recherche. L’élevage peut aussi se faire en vue de compétitions sportives ou esthétiques (concours de beauté mais également de laideur, non pour susciter la moquerie mais générer de l’adoption).
Le cas des animaux de zoos montre des configurations très variées avec, dans tous les cas, une place très limitée pour les animaux en regard de leurs besoins. La mission éducative et de conservation ne permet pas toujours une réintroduction dans le milieu naturel. Il y a des nuances à apporter sur le fait que les animaux des zoos ne sont pas tous menacés, qu’ils sont parfois médicamentés pour masquer leurs signes de détresse (ennui, automutilation…).
Un focus est porté sur l’emblématique ours polaire qu’on expose plus que de raison et qu’on cherche à reproduire alors même que son milieu se meurt et que sa réintroduction serait vaine tant les conditions de vie dans le zoo ne correspondent pas à la situation réelle (espace, besoin de chasse…).
Le panda est aussi évoqué comme animal géopolitique au départ donné, puis prêté par la Chine pour asseoir sa place dans la compétition commerciale mondiale.
Les animaux sauvages face à l’emprise humaine
Ce chapitre invite à la décentration à travers l’idée que les animaux voient l’action humaine pour en profiter. C’est le cas du commensalisme. Il peut y avoir bénéfice pour les deux parties, les humains et les animaux. Les catégories sont fluctuantes. La distance doit être juste (il ne faut être ni trop prêt, ni trop loin, ni que l’animal ne génère trop de représentation négative). Le point de départ c’est l’accès à la nourriture, de façon directe (on geste des restes sciemment) ou indirecte (des mouches sur un cadavre vont attirer des oiseaux insectivores).
Les oiseaux sont justement facilement tolérés, ils logent dans des espaces de la ville « publics » et semblent à leur place dans les arbres, ils ne gênent pas. Quand c’est trop gênant (bruit, fientes), on recourt à des techniques pour les effaroucher.
Le cas des souris et des rats est ambivalent : ils nettoient les métros et les égouts mais ont une image négative et peuvent coloniser les caves et leurs ressources alimentaires. La situation est pire encore pour les blattes, les punaises de lit et moustiques tigres.
Le classement dans la catégorie « nuisible » diffère selon les intérêts des uns et des autres : les écologistes y voient des auxiliaires rendant des services à l’homme. Des mesures d’éradication d’espèces porteuses de maladies se sont montrées inefficaces.
Concernant les « protégés », la stratégie est d’abord réglementaire et donc non spatialisée. On définira rapidement des aires par la suite. Environ 17 % des terres et 8 % des eaux seraient protégées en termes de surface mais avec de grandes disparités. Parfois, on définit une aire ailleurs que chez soi, qui plus est dans des contextes où la protection réelle n’est pas possible du fait d’une instabilité géopolitique.
Il y a une ambivalence des zones protégées qui peuvent générer plus de problèmes que de solutions : les populations locales sont exclues, les animaux protégés deviennent des nuisibles pour les autres espèces (compétition, risque de transmission de maladies). D’où des stratégies de réensauvagement qui cherchent à restaurer un « état initial » avec notamment des « espèces clés de voute » mais la définition du rapport prédateur/proie n’est pas toujours simple. Il y a aussi des ingénieries écologiques de restauration de paysages de mégafaune préhumaine mais cela demeure utopique (on pense à Jurassic Park).
Il y a également le cas du réensauvagement spontané qui permettrait de rendre quelques « services écosystémiques » comme la séquestration du CO2. Aussi le cas de la protection ou non des intérêts humains : sanitaires notamment avec la crainte de la contamination (exemple très parlant des bouquetins pp 161-163).
Les conflits humains/animaux : approches de géopolitique locale
Quels espaces ? Quels territoires ? Quelles représentations de chaque partie ? La cohabitation est-elle possible ? Le conflit peut n’être que la conséquence d’une compétition pour la ressource et peut couvrir un spectre allant de la destruction des plantations à l’attaque à la personne.
Mais les zoonoses sont bien plus mortelles que des attaques directes même s’il n’y a pas d’agentivité chez un virus ou un microbe et ces espèces ne sont pas « charismatiques ».
Malgré tout, il y a une difficile quantification des attaques directes et de grandes inégalités territoriales : cela touche les pays en développement surtout et les zones rurales ainsi que les zones présentant des reliquats d’éléments naturels.
L’abattage n’est pas forcément la solution : il peut amener à la disparition de l’espèce, à la désorganisation d’un groupe (tuer les dominants peut amener les autres à se rabattre sur des proies plus accessibles comme les animaux d’élevage). Mais cet abattage perdure car il calme les victimes qui ont besoin de désigner un responsable et car il génère des revenus. Il faut bien identifier qui on tue dans la chaine : si on tue à la clé de voute, on aura une prolifération du reste. D’autres stratégies existent : la protection (clôtures) pour séparer les deux mondes, la dissuasion et l’effarouchement. Le problème est le coût et le contournement parfois difficile pour l’animal.
La territorialisation de l’homme et de l’animal avec ou non inclusion, varie dans le temps et dans l’espace avec une plus ou moins grande tolérance selon l’analyse de qui perturbe qui.
Les grands carnivores n’ont pas de prédateur sauf l’homme si la réintroduction les amène à dépasser les limites fixées.
On note des effets contre-productifs chez les loups : on les surchasse et donc on a des réactions de surcolonisation, la meute n’envoie pas que les jeunes pour assurer sa survie.
Concernant le lien entre les animaux et la santé, il y a un problème ici car la « zone de contact » est plus floue que précédemment. La moitié des maladies infectieuses est due aux zoonoses, un tiers des maladies émergentes est due aux zoonoses. Et cela continue d’augmenter.
Même si la faune sauvage peut être génératrice d’un fort taux de mortalité, la faune d’élevage est la première source de maladies émergentes. Le problème est aigu de nos jours car l’homme rogne sur les territoires des animaux.
Au sujet de la nature en ville, on peut évoquer les zones humides et les immeubles végétalisés qui font le nid des moustiques développant des maladies dont un retour du paludisme. Les villes chaudes sont propices au développement de ces maladies. Les coupelles d’eau et gouttières dans les espaces privés empêchent les pouvoirs publics d’intervenir. D’où la nécessité de campagnes d’information mais le surtraitement peut développer la résistance.
La chasse et la pêche : enjeux de conservation
Ces thématiques intéressent le volet alimentaire mais également le loisir. Selon la position sociale, la chasse sera un loisir de riches (que ceux-ci légitimeront par une régulation environnementale) ou une nécessité (braconnage). Comme loisir, la chasse voit une augmentation artificielle d’espèces à chasser qui occasionnent des dégâts dans les parcelles agricoles voisines. Dans certains cas (Sologne), on « privatise » l’espace de chasse avec une engrillagement des forêts. C’est en France que la période de chasse est la plus longue et que le taux de chasseurs est le plus élevé.
La chasse des chasseurs-cueilleurs est finalement assez anecdotique en nombre. En revanche, la surchasse commerciale a vu des massacres d’éléphants (ivoire) mais aussi de castors, phoques et antilopes. La baleine, après avoir frisé l’extinction, repart et se porte plutôt bien malgré un tourisme associé qui gêne quelque peu l’espèce.
Si les chasseurs ont joué un rôle positif avec une participation à la création d’aires protégées, il y a tout de même un cercle vicieux à voir les forêts dépérir du fait de la réintroduction de grands herbivores..qu’il faut réguler en les chassant…alors qu’ils ont été préalablement réintroduits pour le loisir (les chasseurs entretiennent leur fond de commerce).
Concernant la pêche, deux tiers des prises se font au niveau du plateau continental qui ne représentent que 10 % des surfaces océaniques. On est au palier maximal d’exploitation des ressources avec un tiers de la population de poissons qui est pêché à un niveau biologique non durable. La surveillance générale semble opérationnelle mais localement, on ne sait pas trop ce qui se passe (Inde, Afrique) et il y a donc menace sur les stocks. Les chances d’identifier les contrevenants sont faibles et les ports sont corrompus.
Une solution peut passer par les quotas et les techniques plus douces (éviter de racler le fond). D’où les ZEE et les AMP mais, là aussi, difficile d’assurer le contrôle et faire appliquer les règles. Il faut impliquer les populations locales et miser sur des redécoupages plus fins quand c’est possible (cas des archipels).
Les animaux dans la mondialisation : approches géopolitiques
Le chapitre traite d’échanges commerciaux. La consommation de viande est en hausse avec l’augmentation de la démographie et la forêt se voit détruite en conséquence pour nourrir les bêtes (soja) et les émissions de CH4 augmentent.
Les ventes d’animaux vivants se chiffrent en millions (d’abord les poulets, puis les porcs, les bovins, les ovins et les chevaux), c’est un commerce aussi en hausse. Les explications sont conjoncturelles (pics de consommation là où le cheptel local ne suffit pas : exemple des cérémonies de l’aïd) ou structurelles (la mauvaise chaine du froid oblige à transporter l’animal vivant) et il y a des spécialisations régionales (engraissement et abattage dans des lieux différents) avec des conditions de travail qui ne sont pas toujours optimales.
Sur les animaux sauvages, le trafic est aussi énorme pour des usages essentiellement esthétiques (exhiber) ou liés aux croyances médicinales.
Il faut un encadrement législatif car le trafic existe : la viande de brousse par exemple est revendue très chère et comporte un risque de zoonose. Mais il y a souvent confiscation sans amende. Pour échapper aux contrôles, les flux sont complexes et certains n’hésitent pas à user de la violence…mais tant que la demande initiale ne baisse pas, cela semble peine perdue.
L’ours polaire est évoqué à nouveau avec l’idée qu’il ne s’adapte pas si mal et qu’il n’est pas le plus menacé des animaux. Sa chasse est maintenue car elle peut être la seule ressource pour certaines populations locales et c’est bien la pollution qui le menace davantage. L’ours brun progresse au nord et ne menace pas la « pureté » de l’ours polaire, au contraire cela rappelle son métissage originel. Le phénomène de boréalisation, décrit p 255, est globalement plus inquiétant.
Le tourisme sauvage animalier est générateur de fort revenus notamment dans des pays relativement pauvres au départ. Le stress animal est palpable (contacts trop proches et trop fréquents, nourrissage qui enlève l’autonomie, dégradation des habitats, mauvais traitements pour tenter d’apprivoiser). Malgré tout, il y a bénéfice en comparaison du braconnage.
Conclusion
En soulignant l’agentivité des animaux, l’ouvrage entend imbriquer les approches naturaliste et sociale. Cette thématique des animaux devrait contribuer aux études à venir portant sur l’anthropocène et la « grande accélération ».
De mon point de vue, c’est un ouvrage réellement majeur. Il est particulièrement riche pour aborder de multiples angles de la thématique et, à nouveau, la copieuse bibliographie montre qu’il y a matière à creuser dans le détail cette très belle synthèse. Les nombreuses figures et études de cas apportent réellement à l’ensemble.
Surtout, du point de vue didactique, il y a vraiment matière à intéresser les jeunes élèves avec ce formidable symbole que représente l’animal et qui sera de plus en plus présent dans les analyses spatiales. A voir comment évolueront les prochains programmes mais il faut rester en alerte, à l’image de la présentation initiale de l’un des auteurs Philippe Sierra, à « l’intégration de ces questions dans les approches géographique académiques et appliquées ».
Une coquille à souligner, p 60, dans une note de bas de page où il est noté « moléculme » et quelques cartes, comme celle p 191, qui tolèrent mal les niveaux de gris : d’infimes remarques pouvant servir la réimpression qui ne tardera pas à arriver tant l’ouvrage devrait être un succès.