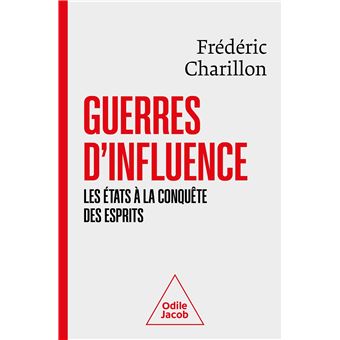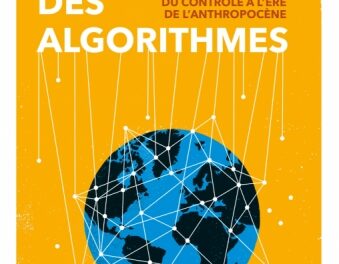Professeur des universités en science politique et ancien directeur de l’IRSEM, Frédéric Charillon offre une précieuse synthèse sur les enjeux géopolitiques et les stratégies des acteurs – publics ou privés – dans le domaine de l’influence.
Cet ouvrage est le fruit d’un constat : les règles de la compétition internationale ont changé, les manœuvres d’influence ayant supplanté les confrontations armées directes. Cette évolution, esquissée dès la fin de la guerre froide, constitue un enjeu majeur. Pour l’auteur, il est clair que « la bataille pour l’influence façonnera une grande partie du paysage stratégique dans les années qui viennent ». Cette thématique des nouvelles formes de guerre fait l’objet de publications depuis quelques années, comme celle de Pascal Boniface sur l’intelligence artificielle.
La première partie de l’ouvrage est un effort pour tenter de définir ce qu’est l’influence et les pratiques qui la sous-tendent.
L’influence, une notion complexe
Frédéric Charillon entend tout d’abord préciser ce que recouvre la notion d’influence. Si l’on peut la comprendre comme la capacité à faire faire quelque chose à quelqu’un sans recourir à la contrainte, on ne saurait la confondre avec la propagande, le lobbying ou le soft power. Elle représente un moyen et, à ce titre, ne doit pas être assimilée à de la domination. Elle englobe des méthodes comme le storytelling, le smart power et le sharp power.
Cette influence s’épanouit dans un contexte international complexe et mouvant, où la compétition se fait permanente et plus subtile qu’auparavant. Le retour des idéologies clivantes et l’extension des terrains de l’affrontement entre États, dans le domaine cyber notamment, ont aussi participé à l’essor de l’influence. Les approches indirectes des conflits ont fait leur preuve et révélé les carences des conflits armés directs. Certains États ont pris acte de ces mutations, à l’instar de la Chine qui pense la « guerre sans limite », c’est-à-dire sur plusieurs terrains à la fois et par différents relais. De fait, le terrain social, qui touche aux cœurs et aux esprits, devient central dans les conflits : il importe de gagner le soutien de la population locale.
Le politologue conçoit l’influence comme une politique publique à certains égards. Les objectifs inscrits à l’agenda de celle-ci sont variés : changer le comportement d’un autre États, contrôle une instance internationale, valoriser son image… Un rapprochement avec la notion de « diplomatie publique » est possible pour comprendre ce que recouvre l’influence. Elle désigne « la communication institutionnelle en vue de mettre en valeur l’action extérieure d’un État, auprès de tous les publics, au contact direct des populations et à leur écoute ». Certains analystes évoquent un nation branding pour désigner l’entreprise de défense d’un État comme on le ferait d’une marque.
La diplomatie publique emprunte plusieurs voies : échanges universitaires, diasporas, émissions de télévision, défense d’une cause particulière, etc. Le numérique représente alors un champ d’action incontournable, par exemple pour créer des ambassades virtuelles dans les pays avec lesquels les relations sont difficiles. Parmi les domaines d’action des États, si la diplomatie culturelle reste essentielle, transformer la culture en influence est aujourd’hui un défi. C’est pourquoi les diplomaties sectorielles, plus ciblées, existent afin de tisser des réseaux et de diffuser des normes. Les acteurs locaux sont également sollicités par les États : régions, municipalités et collectivités territoriales développent des réseaux qui intéressent les États centraux. Quant aux acteurs privés comme les FTN, la coordination de leur communication avec les États s’avère difficile tant les intérêts divergent souvent.
Quelles formes d’influence aujourd’hui ?
Dans un deuxième temps, l’ouvrage se propose de disséquer les trois modèles d’influence aujourd’hui à l’œuvre.
Le modèle démocratique libéral américain consiste à « convaincre et attirer ». Ce modèle repose sur la conviction que les États-Unis sont le phare du monde, la puissance dominante incontestée. Afin de transformer cette puissance en influence, les États-Unis misent sur une présence mondiale et un smart power qui joue de la transitivité entre secteurs d’excellence. Pour assurer la diffusion de ses idées, le pays jouit d’une position centrale dans l’actualité internationale et s’efforce de contrôler la couverture médiatique des conflits à son avantage. Ce modèle a été remis en cause avec, dans un premier, les attentats du 11 septembre 2001, ces derniers ayant mis en lumière le fait que des franges importantes de l’opinion mondiale détestent l’Amérique, ensuite avec la présidence de Donald Trump.
Le président républicain a pris ses distances avec l’interventionnisme, montré des sympathies pour des régimes autoritaires et fait du politiquement incorrect une marque de fabrique. Les techniques d’influence ciblées dans les organisations internationales, forums et traités ont été désorganisées. La crédibilité et la légitimité des États-Unis ont été minées par le retrait de certains accords (climat, nucléaire iranien) et l’absence de soutien à certains groupes (Kurdes), ce qui a fragilisé la posture de protecteur du monde. Toutefois, force est d’admettre qu’il a obtenu des résultats dans son domaine d’influence. Certains pays (Pologne, Hongrie, Brésil…) ont vu l’essor de mouvements pro-Trump, tandis que Steve Bannon a sillonné le continent européen pour soutenir les forces conservatrices.
Les autres pays anglo-saxons (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) imitent le modèle américain d’influence, mettent en valeur leur diversité et leur image d’eldorado pour les entrepreneurs. L’Asie est un autre haut lieu de la compétition. Les Tigres et le Japon polissent leur image de démocraties prospères et modernes. Taïwan est dans une situation unique, luttant pour sa survie et la préservation de son modèle démocratique.
Dans cette typologie présentée par Frédéric Charillon, on peut distinguer un deuxième modèle dit « impérial ». Incarné par la Russie, la Turquie et la Chine, ce paradigme repose sur les minorités à l’étranger pour s’en proclamer les protectrices et l’exaltation d’un passé impérial grandiose. Dans cette vision, l’ennemi est l’Occident responsable système international actuel et des humiliations. Il s’agit de réviser l’ordre international injuste et de restaurer un ordre régional qui leur fasse une place de choix. Pour la Russie, la fondation « Monde Russe » diffuse sa culture, tandis que le réseau VK met en relation des communautés russes, orthodoxes ou anciennement réunies par le socialisme. Bien sûr, la critique des démocratie libérales est une composante de leur stratégie d’influence.
Analysant la Russie, les spécialistes emploient le concept de sharp power, c’est-à-dire une politique agressive et subversive vis-à-vis de l’Occident. La manipulation supplante ici la séduction, selon une perspective défensive, en réaction aux attaques de l’Occident. Pour la Russie, le conflit se joue dans les forums comme le club Valdaï, dans les pays émergents, via les diasporas et les médias (RT, Sputnik). Quant à la Chine, elle s’est donnée les moyens d’une stratégie d’influence complète et redoutable, avec ses organismes dédiés (département du « Front Uni » du comité central du PCC, agence Chine nouvelle, Instituts Confucius, fausses ONG, étudiants chinois sur les campus universitaires, etc.).
Les nouvelles Routes de la soie est la plus ambitieuse stratégie d’influence géopolitique des autorités chinoises, diffusant les normes, l’agenda et le modèle de gouvernance chinois. Les caractéristiques communes aux politiques d’influence chinoise et russe sont aussi leurs points faibles. En effet, dans la compétition internationale, les régimes autoritaires supportent mal d’être exposés aux critiques. De plus, ce modèle autoritaire ne parvient guère à séduire les démocraties. Enfin, le modèle chinois demeure peu attractif et culturellement trop étranger à bien des pays.
La Turquie est le dernier adhérent en date de ce modèle d’influence. Pays anciennement allié de l’Occident, aujourd’hui difficile à situer, il tire son influence de sa ressource religieuse. L’influence turque passe de plus en plus par des vecteurs religieux et nationalistes. Les « Loups gris » commettent des violences intercommunautaires dans les pays européens alors qu’Erdogan s’érige en défenseur des musulmans en Occident, exploitant les réseaux des Frères musulmans dans l’éducation et la politique.
Le modèle des pays du Golfe présente la singularité de « rémunérer la croyance ». A la convergence de la foi et des pétrodollars, cette stratégie s’appuie sur « des communautés extérieures non nationales en s’en faisant le défenseur ». Ces pays ne souhaitent pas convaincre le monde des vertus de leur modèle. C’est une influence transnationale, qui passe par des acteurs plus discrets que les États et proches des sociétés : confréries, associations, écoles, etc. Elle n’engage pas officiellement l’État instigateur mais doit lui permettre de maximiser son poids fragile sur la scène mondiale. L’objectif est triple : développer une stratégie de séduction pour soigner leur image et faciliter l’après-rente pétrolière sans provoquer de révolte sociale, gagner la compétition infrasunnite en ralliant des pays à sa cause, diffuser un message religieux.
De fait, l’Arabie saoudite déploie des efforts pour promouvoir le wahhabisme, que ce soit par des financements d’écoles coraniques ou des aides aux Frères musulmans. Les Émirats Arabes Unis partagent les mêmes objectifs mais présentent une façade plus accueillante et jouissent de quelques succès militaires. Quant au Qatar, il demeure une énigme. Le cheikh en place a multiplié les initiatives diplomatiques ou de médiation pour contrebalancer l’image de second de la Turquie dans lutte contre Riyad. Ainsi, Doha a participé au règlement de la crise libanaise en 2008 et aidé l’UE lors de la crise des infirmières bulgares en 2007.
La chaîne TV Al-Jazira (et ses dérivés) incarne la politique d’influence du Qatar, apportant un contrepoint arabe au traitement américain de la guerre en Irak de 2003, adaptant aujourd’hui son discours aux jeunes générations connectées. L’énigme est ici le risque important que prend ce micro-Etat à travers cette stratégie d’influence, compte tenu de son faible poids stratégique.
L’UE dans ces guerres d’influence
Dans une dernière partie, Frédéric Charillon examine la place et les stratégies de l’Europe en matière d’influence.
L’Europe doit tenir compte de l’existence de nouvelles « niches de l’influence » si elle veut s’affirmer. Parmi secteurs clefs de l’influence, la jeunesse est au centre des préoccupations. A la fois avenir des pays, électeurs, consommateurs, touristes potentiels et commentateurs virulents sur les réseaux sociaux, les jeunes doivent être conquis par l’université, le numérique et la rencontre directe. Se joue ainsi une véritable guerre entre universités pour attirer les talents et maîtriser le discours. Si elle compte trois pays parmi les plus attractifs pour les étudiants internationaux, l’Europe semble en retrait dans la guerre du numérique. Elle n’a pas imposé son moteur de recherche ni son Facebook, agissant seulement sur la régulation des géants du numérique.
Quant aux séries, malgré des succès indéniables, leur message n’est pas politisé et elles ne proposent pas de modèle de société. Cela dit, cibler les jeunes ne suffit pas : les femmes peuvent aussi représenter un secteur de niche pour les stratégies d’influence. Certains pays européens, comme la Suède, font des droits des femmes le fer de lance de leur diplomatie. Les minorités et les populations défavorisées constituent un autre segment ciblé en Europe. Pour exercer une influence dans les niches ou dans des secteurs plus conventionnels, il convient de développer une expertise dans, autrement dit d’être capable de fournir une expertise dans des délais rapides à un autre pays, pour façonner ses normes et comportements, faire et faire des réputations.
Or, les États-Unis restent maîtres en la matière, par exemple via leurs agences de notation financières ou leurs cabinets de consultants. Enfin, les think tanks, qui produisent des idées pour le débat, intéressent de nombreux acteurs politiques. Ils permettent aux Etats de participer aux grands rendez-vous internationaux dans un contexte de multiplication des rencontres dites « Track 1,5 », soit situées entre la voie officielle interétatique et la voix non officielle des analystes privés, couvertes par presse. Ce sont les dialogues de l’IISS, l’hôtel Shangri-La de Singapour, le Forum international de Dakar ou encore le Club Valdaï.
Face aux initiatives des Etats-Unis et des pays émergents, l’Europe apparaît fort « démunie », davantage théâtre qu’acteur de la guerre d’influence. En l’absence d’unité et d’intérêts communs, les États européens laissent le champ libre aux stratégies d’influence des États non-européens. Le lobbying bruxellois facilité ces manœuvres, comme l’atteste l’association d’amitié UE-Chine au Parlement européen. Certes, vue de l’étranger, l’Europe paraît dotée d’une politique d’influence avec sa politique d’adhésion et des projets d’aide dans le monde. Mais elle « ne se fait pas respecter ». Ses combats vertueux et sa puissance normative relèvent d’une stratégie naïve face à la montée des tensions et aux régimes autocratiques.
Le Royaume-Uni apparaît comme le seul pays européen ayant déployé une véritable et efficace stratégie d’influence. L’Allemagne dispose de sa réputation de champion économique européen et s’affirme de plus en plus grâce à des outils d’influence (échanges universitaires, fondations de chercheurs, Instituts Goethe, etc.). En France, on préfère parler de « rayonnement », mais cela ne se traduit pas nécessairement de l’influence, comme l’illustre la francophonie. De plus, la France souffre de trois travers qui l’empêchent de penser l’influence : la confusion entre présence et influence, la croyance en l’existence de l’influence pas simple décret, l’attachement à l’idée que l’exercice de postes prestigieux à haute visiblité génère de l’influence dans l’influence générée par l’exercice de postes prestigieux à haute visibilité. Elle jouit pourtant d’atouts, comme l’ENA et les IFRE.
A cela s’ajoute la crise sanitaire. Cette crise a mobilisé des savoir-faire en matière d’influence dans chaque pays, donnant lieu à des rivalités entre modèles de gestion de la pandémie. Ce fut une bataille pour l’image et le nation branding, sur fond de concurrence pour l’approvisionnement en masques, gels et vaccins. Les démocraties ont exalté la transparence pour dénoncer le silence chinois sur l’origine du coronavirus, mais elles ont dû importer massivement des masques, faire venir des virologues russes et reconnaître que leurs systèmes de santé étaient débordés.
Dans les pays populistes, les « négationnistes » ont tout d’abord nié la gravité de la situation, avant de devoir se prendre les mesures qui s’imposaient. La crise a eu aussi pour conséquences de révéler brutalement à l’Europe et à l’Amérique du Nord leur vulnérabilité dans plusieurs secteurs stratégiques. Ainsi, la notion d’autonomie stratégie est devenue centrale dans les réflexions, « la nouvelle raison d’être des stratégies d’influence ».
Enfin, parmi les tendances récentes qui compliquent l’adoption d’une stratégie d’influence européenne, la fragmentation des réseaux sociaux selon leurs publics, l’essor des forums de discussion de pair à pari ont joué et l’avènement d’ « influenceurs » reconnus internationalement et utilisés par les gouvernements sont déterminants dans la bataille de l’influence. A l’heure de la cancel culture, du wokism et de Twitter, il ne s’agit plus de débattre autour d’arguments, mais de placer l’ennemi dans le camp du mal, afin de rendre sa parole inaudible. Les insultes et la haine ont remplacé le débat, la critique des autorités est permanente. L’influence prend ainsi les traits de l’intimidation.