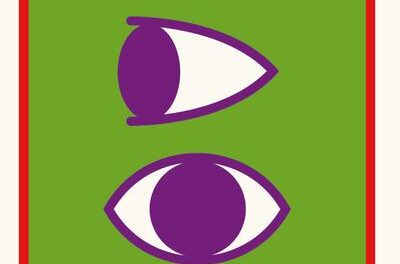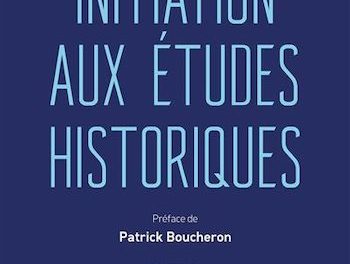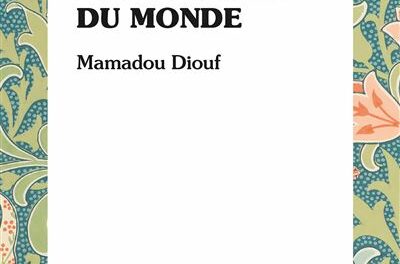Fort de sa vaste culture et de sa longue expérience, Philippe Joutard nous propose aujourd’hui une étude historique et une réflexion personnelle sur les relations entre l’histoire et les mémoires.
Professeur d’histoire à l’université de Provence et à l’École des hautes études en sciences sociales, ancien recteur des académies de Besançon et de Toulouse, président du Centre alpin et rhodanien d’ethnologie, Philippe Joutard a publié seul, ou en collaboration, une quarantaine d’ouvrages et plus d’une centaine d’articles. Ses travaux ont principalement porté sur le protestantisme cévenol au XVIIIe siècle et la révolte des Camisards, et sur le fonctionnement de la mémoire collective, en particulier protestante, objet de sa thèse. Il s’est interrogé dans la construction de ces mémoires collectives sur la part respective des historiens professionnels, de l’école, des fictions (romans et aujourd’hui films et dramatiques de télévision) et parfois de la tradition orale, comme il l’a découvert avec surprise en Cévennes. 
A ce titre, il est un des pionniers de l’utilisation de la source orale en histoire : c’est ainsi qu’il a mené une enquête sur la tradition orale en Cévennes de 1967 à 1973, et en a dirigé d’autres sur le souvenir de la Seconde Guerre mondiale ou l’histoire de la grande pauvreté à Marseille. Au congrès international des sciences historiques de Montréal, en 1995, il a été chargé de présenter un bilan de vingt-cinq années d’histoire orale dans le monde. Il mène actuellement des recherches sur l’imaginaire comme agent et créateur d’histoire, en particulier à propos de l’apparition de la haute montagne dans la sensibilité occidentale. Il réfléchit aussi sur les rapports entre histoire et mémoire dans nos sociétés contemporaines entre autres à propos de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, et du développement des identités nationales, menant des études comparées sur la construction des mémoires historiques et leurs diverses composantes.
Fort de sa vaste culture et de sa longue expérience, il nous propose aujourd’hui une étude historique et une réflexion personnelle sur les relations entre l’histoire et les mémoires. Il inaugure la « collection Écriture de l’histoire », aux éditions La Découverte. Il s’agit d’une collection d’historiographie destinée à faire « prendre conscience que l’histoire elle-même comme pratique de recherche à une histoire qu’il faut retracer ». L’ouvrage est construit en 12 chapitres qui sont liés les uns aux autres en fonction de la cohérence historique, mais aussi de choix subjectifs, l’auteur n’hésitant pas à recourir souvent au « Je » et a évoquer des souvenirs personnels, mais bien évidemment cette étude répond à toutes les règles d’un travail historique méthodique.
Dès l’introduction Philippe Joutard rappelle que « mémoire et histoire sont deux voies d’accès au passé obéissant à deux logiques différentes ». La mémoire « passé dans le présent » abolit la distance temporelle, l’histoire la rétablit. Pour reprendre l’étymologie grecque, l’histoire est une « enquête » qui doit prendre en compte tous les éléments du dossier, alors que la mémoire est fondée sur la sélection des souvenirs et l’oubli. « Cette opposition paraît néanmoins fragile au regard de la réalité historique sur la longue durée ».
Le règne actuel de la mémoire généralisée
Le premier chapitre étudie « l’apparition du phénomène mémoriel », « l’invasion mémorielle ». Elle est datée des années 1970, « grâce à des phénomènes qui ne concernent plus seulement les historiens, mais la société française dans son ensemble » : immense succès d’ouvrages comme Une soupe aux herbes sauvages ou Le Cheval d’orgueil, création d’une multitude d’associations visant à rétablir des fêtes anciennes, à remettre en valeur de petites lignes de chemin de fer etc. En 1980 le pouvoir politique s’empare du phénomène quand Valéry Giscard d’Estaing crée « L’Année du patrimoine ». On assiste à la naissance de 6000 associations de défense du patrimoine et 4000 associations rurales de culture et de loisirs. Quatre ans plus tard, le ministère de la Culture créé les « Journées du patrimoine ». « C’est ainsi que l’omniprésence de la mémoire, au début des années 1980, fit entrer la France dans l’ère de la commémoration, selon l’expression de Pierre Nora. » Tout devient commémorable, « la commémoration se délocalise et se particularise. » La commémoration du bicentenaire de la Révolution française « inaugure la phase de la mémoire historique française contemporaine ». L’auteur observe et démontre que cette poussée mémorielle se produit aussi en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et aux Etats-Unis.
Dans le second chapitre l’auteur recherche les origines de ces poussées mémorielles : nostalgie du « monde que nous avons perdu », elle-même conséquence d’une mondialisation « qui semble uniformiser et dissoudre les identités, qui a bouleversé en trois décennies l’univers familier, non seulement des sociétés traditionnelles du sud de la Méditerranée ou de l’Afrique, et du monde paysan français, mais aussi des sociétés nées des premières formes d’industrialisation du XIXe siècle -la mine, la métallurgie, le textile ». C’est ainsi que s’explique le succès d’un ouvrage comme Grenadou, paysan français, d’une dramatique télévisée comme Jacquou le croquant, ou la création des parcs naturels régionaux et des écomusées. L’auteur s’intéresse particulièrement à l’expression mémorielle suscitée par la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs. Il en rappelle les grandes étapes, cite les travaux d’Annette Wieviorka qui met en évidence « l’ère du témoin », ceux d’Henri Rousso qui diagnostique pour sa part « le retour du refoulé » et un « passé qui ne passe pas ». Plus largement, à la suite des travaux de François Hartog, Philippe Joutard montre que cette poussée mémorielle et à mettre en relation avec la crise du « régime d’historicité » et l’entrée dans l’ère du « présentisme », où le présent est « omniprésent, sans perspectives d’avenir » .
Le troisième chapitre, intitulé « Les temps précurseurs », permet à l’auteur d’identifier deux poussées mémorielles antérieures : beau travail d’histoire de la mémoire ! La première se situe des années 1880 aux lendemains de la Première Guerre mondiale, « elle paraît inséparable, au moins à l’origine, de la crise du rationalisme qui se développe à partir de 1885, au moment même où Bergson et Freud élaborent leurs oeuvres ». Elle est à mettre en relation avec la peur engendrée par la modernisation ; la Première Guerre mondiale pour sa part est à l’origine d’une première « ère du témoin ». L’auteur rappelle que la version intégrale d’Á la recherche du temps perdu date de 1922, que Maurice Halbwachs travaille alors sur Les cadres sociaux de la mémoire et que Marc Bloch est un lecteur averti de cet ouvrage. Une autre poussée mémorielle s’était précédemment produite, à la fin du XVIIIe siècle, en France et en Allemagne, un peu avant et un peu après la Révolution française. « Les deux poussées mémorielles précédentes entrent en résonance avec la dernière. L’éclatante fortune de Proust prend son envol dans les années 1960. Elle trouve son couronnement dans la commémoration du centenaire de sa naissance en 1971 et du cinquantenaire de sa mort l’année suivante, qui s’accompagne de plus de 600 publications (…) Ces trois époques de mémoire sont des temps de mutation rapide, d’écroulement d’un monde, des certitudes passées, engendrant la nostalgie du monde perdu. Pour reprendre François Hartog, ce sont des « brèches », des « failles »
Les constructions mémorielles
Les chapitres 4 et 5évoquent les « sociétés-mémoire » et les romans nationaux qui sont tous deux des constructions mémorielles. Les romans nationaux sont assez faciles à appréhender pour l’historien car la présence d’un État organisateur a suscité l’abondance de documents écrits et monumentaux, alors qu’il éprouve de grosses difficultés pour étudier les sociétés-mémoire fondées sur l’immatériel, la tradition orale, la coutume, le rituel. Il doit alors se tourner vers les méthodes de l’anthropologue et recourir à l’histoire orale.
L’auteur appelle « société-mémoire », « des sociétés qui, depuis longtemps, ont fondé leur identité sur la mémoire historique, avant le règne de la mémoire généralisée. J’entends par-là des groupes ayant une mémoire vivante, autour d’événements fondateurs évoqués dans différents lieux de sociabilité souvent devenus en même temps des lieux de mémoire. Cette mémoire s’exprime aussi par une « tradition orale » qu’il est possible de recueillir (…) Une telle mémoire collective influence le comportement et les attitudes ; elle est donc créatrice d’histoire ». Il consacre plusieurs pages passionnantes à l’un des sujets qu’il connaît le mieux : « un modèle de société-mémoire, les huguenots français ». L’historien montre que « la mémoire du Désert aujourd’hui dominante » a recouvert une mémoire plus ancienne, celle des guerres qu’a menées le duc de Rohan au temps de Richelieu, la dernière des guerres de religion classique, et parfois même celles du XVIe siècle, et que cette mémoire des persécutions a conduit les huguenots à une solidarité avec d’autres persécutés : les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque aussi « la contre-mémoire vendéenne » et, plus longuement, la mémoire des Acadiens.
Le roman national « est un récit destiné à expliquer aux citoyens d’une nation, et prioritairement aux enfants, le passé qui justifie l’existence actuelle de celle-ci, ainsi que sa réussite exceptionnelle, tout en lui prédisant un grand avenir. Dès qu’un groupe se considère comme une nation, il produit un roman national plus ou moins élaboré, mais il lui faut un État et la souveraineté pour que ce roman puisse connaître, entre autres par l’intermédiaire de l’école, mais aussi par la mise en place de différents mémoriaux, une véritable diffusion, en influençant les mémoires individuelles. » Le roman national français et le roman national des États-Unis se rapprochent sur trois points : une volonté d’universalisme, de messianisme (chacun est persuadé d’avoir une vocation pour l’ensemble de l’humanité) ; le besoin de cicatriser de graves ruptures (la Révolution pour la France, la Guerre de Sécession pour les États-Unis) ; la nécessité de gérer l’hétérogénéité et les origines des cultures. L’auteur présente les différentes étapes de la constitution du roman national français puis du roman national des Etats-Unis.
L’histoire orale
Philippe Joutard, qui en est un pionnier en France et un grand spécialiste, consacre trois chapitres à l’histoire orale : chapitre 6, L’histoire orale, une première réponse des historiens ? ; chapitre 7, Une histoire orale contestée qui affirme son originalité ; chapitre 10, Histoire orale et mémoires vives à l’échelle du monde.
Les premières manifestations de l’histoire orale précèdent le règne de la mémoire généralisée et sont liées à la poussée mémorielle de l’entre-deux-guerres. Il s’agit alors, aux États-Unis d’abord, de recueillir des témoignages oraux en tant que compléments des archives traditionnelles. L’histoire orale américaine connaît une croissance exponentielle : les États-Unis comptaient au début des années 1970 plus de 300 centres d’histoire orale. Des chercheurs se tournent également vers l’enquête orale au Royaume-Uni, à la fin des années 1960. Contrairement à une opinion couramment admise, l’auteur affirme que les premières enquêtes orales françaises systématiques sont contemporaines des entreprises américaines ou britanniques. Mais elles n’ont aucune dimension historique et expriment une mémoire ethnologique, souvent lancé à l’initiative de folkloristes. L’utilisation du témoignage pour un travail historique reste limité. Néanmoins, dès sa naissance et alors qu’il est dirigé par un historien, Henri Michel, le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale mène des enquêtes orales et recueille grâce à son réseau de correspondants départementaux 3500 témoignages, dont 2000 de résistants. Philippe Joutard expose alors les conditions dans lesquelles il commença, en 1967, une enquête orale dans les Cévennes sur le souvenir laissé par la guerre des Camisards.
« Tout va changer dans les années 1970. Il existe une corrélation étroite entre l’explosion mémorielle et les recherches » plus savantes « . Les enquêtes orales sont aussi bien le fait de mouvements d’identité régionale que des institutions nationales et on recueille aussi bien des mémoires ethnologiques que des souvenirs historiques ». Des institutions telles que les Archives départementales et les Archives nationales constituent des collections d’ archives orales » et le monde universitaire commence à s’intéresser aux témoignages oraux, sous plusieurs formes : confrontation acteurs-historiens au cours d’un colloque devant un large public (l’Institut d’histoire du temps présent dirigé par François Bédarida joue un rôle important dans cette démarche), collecte systématique de témoignages oraux qui privilégient les « oubliés de l’histoire » et qui sont menées côte à côte par des historiens, des sociologues et des ethnologues.
La réticence des historiens français face à l’histoire orale s’est manifestée très tôt, y compris et surtout chez un grand résistant devenu historien, Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin. S’appuyant sur les archives de Jean Moulin il contredit à plusieurs reprises au cours de colloques les points de vue des acteurs présents dans la salle, qui étaient d’anciens camarades de résistance. Il se fit le défenseur de la nécessité de recourir à l’archive écrite, seule source fiable, et de se méfier du témoignage. Au-delà des historiens, la culture française a longtemps marqué une forte méfiance vis-à-vis de la tradition orale, qualifiée avec mépris de « folklorique », contrastant fortement avec la culture allemande. « Cependant, il existe un domaine où l’histoire orale est devenue l’approche privilégiée, même en France, c’est évidemment la Shoah. » « Irremplaçable » dans ce domaine spécifique, l’histoire orale l’est aussi, selon l’auteur, pour saisir le choc entre la mémoire vive, quotidienne, et l’histoire.
S’il existe des historiens qui ont été tentés par le repli sur une épistémologie traditionnelle face à l’actuelle poussée mémorielle, « d’autres ont relevé le défi, continuant à faire, comme la génération précédente, des mémoires leur objet d’études, tandis que de nouveaux chantiers s’ouvraient à partir de l’histoire orale. » L’auteur consacre un chapitre à dresser un bilan mondial de l’histoire orale : Amérique latine, États-Unis, Europe occidentale, et à cette échelle il étudie plus particulièrement la situation française en évoquant plusieurs études : mémoire communiste, mémoire de la Shoah, mémoire de la guerre d’Algérie, mémoire de l’esclavage.
Le temps des lieux de mémoire
C’est le titre du chapitre 8, mais cette question large de l’historiographie française récente est également traitée dans le chapitre 9, L’Empire de la mémoire, et dans le chapitre 11, Une réponse historiographique féconde. « L’entreprise des lieux de mémoire est d’abord analyse expression de la poussée mémorielle avant d’en devenir, involontairement, l’un des moteurs. » Son concepteur, Pierre Nora, à commencé par tester et expérimenter sa recherche de 1978 à 1981, dans son séminaire de l’EHESS. La première partie consacrée à La République parut en 1984 (deux volumes, 18 contributions), la seconde, La Nation, en 1986 (trois volumes, 48 contributions), et la troisième, Les France (trois volumes, 64 contributions), en 1992.
L’entreprise a pris des proportions gigantesques et la définition du « lieu de mémoire » a évolué : c’est le « lieu où la mémoire travaille » dans les premiers volumes, c’est une « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la volonté des hommes ou le travail du temps ont fait un élément symbolique d’une quelconque communauté » dans les derniers. L’entreprise est paradoxale : elle se voulait une « histoire contre-commémorative » et le lieu de mémoire était un outil destiné à prendre la distance critique nécessaire, or elle a renforcé la commémoration et le lieu de mémoire est devenu « l’instrument par excellence de la commémoration ». « Nora n’a pas déconstruit le roman national, mettant un terme à l’histoire-mémoire., Il les a renforcés l’un et l’autre, devenant le Michelet ou Lavisse du XXe siècle en consolidant l’identité nationale autour de l’idée du patrimoine. » En 1993, l’expression « lieux de mémoire » faisait son entrée dans le Petit Robert, « preuve supplémentaire que la poussée mémorielle, loin de s’atténuer, se renforçait. »
En effet, tout conduit aujourd’hui à renforcer le règne de la mémoire. Les commémorations se multiplient, la Première Guerre mondiale redevenant de ce point de vue un centre d’intérêt majeur. L’État français s’est emparé du phénomène mémoriel et préfère désormais le terme de « mémoire » à celui d’« histoire » pour nommer les institutions en charge du rapport au passé : on parle désormais au ministère de la Défense de la Direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA), on utilise abusivement dans tous les discours l’expression de « devoir de mémoire », on « panthéonise » plus que jamais, les musées cèdent la place à des « mémoriaux », l’histoire de la mémoire entre dans le programme d’histoire des classes de Terminale et le roman national s’empare de la campagne présidentielle de 2007. Les fêtes historiques connaissent un succès populaire énorme et deviennent de véritables « pratiques sociales et culturelles avec une dimension identitaire non négligeable ». « L’historien semble devenir un acteur parmi d’autres, à côté du témoin mais aussi du journaliste, du scénariste et du metteur en images. Paradoxalement cependant, il est recherché comme expert justifiant et instance de légitimation. »
Une réponse historiographique féconde à la poussée mémorielle
« De l’écho infini des Lieux de mémoire de Nora à celui de La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli de Ricoeur, les vingt dernières années ont vu s’amplifier, se renouveler et se diversifier la production historiographique, comme la réflexion sur la mémoire. Preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que l’histoire et le rapport au passé national structurent une grande partie de la culture française, mémoire et histoire n’intéressent pas seulement un cercle étroit de spécialistes ; la presse généraliste et les revues sont font régulièrement l’écho. »
« Plusieurs types de recherche se situent dans la filiation des chantiers suggérés et entamés par Pierre Nora. Elles sont aussi le fruit de l’« époque-mémoire ». Les historiens se sont d’abord totalement réappropriés les commémorations ; c’est pour eux l’occasion d’organiser des colloques où la dimension historiographique et mémorielle est fortement présente. » Ainsi l’histoire de la Résistance est-elle aujourd’hui une histoire au second degré : elle cherche à problématiser, à replacer les faits étudiés dans leur contexte historiographique, à prendre en compte les mémoires sous toutes leurs formes. La biographie connaît un réel succès, avec des approches nouvelles.
L’alliance nécessaire de Clio et de Mnémosyne
À partir des années 1990, les historiens se sont insurgés contre ce qu’ils estimaient être une tyrannie de la mémoire. La polémique a trouvé son origine dans le passé de Vichy « devenu obsessionnel ». Progressivement, l’État a cherché à récupérer la poussée mémorielle et on a vu se multiplier les « lois mémorielles » suscitant des réactions des historiens et la création d’un Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, puis de l’association Liberté pour l’histoire, fondée sous la présidence de René Rémond, puis de Pierre Nora.
Philippe Joutard plaide pour une articulation et non pour une opposition entre l’histoire et les mémoires. Il affirme et pense démontrer que l’histoire a besoin des mémoires (la mémoire prémunit l’histoire contre la tentation du déterminisme, elle peut lui fournir le lien charnel dont elle a besoin pour rendre le passé intelligible, elle lui fournit des sources sans lesquelles l’histoire serait souvent impossible). Il montre également que le travail de l’historien est partiellement conditionné par sa mémoire et que le meilleur moyen de tendre vers l’objectivité et d’en prendre conscience. « Je plaide donc pour des historiens modestes, qui ont conscience de leurs limites les acceptent, qui reconnaissent leur position dans le temps. » Mais il plaide également pour une mémoire modeste « qui accepte aussi de se remettre en cause, en d’autres termes, de se laisser historiser ». L’articulation entre l’histoire et la mémoire a lieu naturellement, à partir du moment où l’historien écoute le témoin et où l’interlocuteur-acteur comprend la logique de l’historien.
L’ouvrage se termine par une « chrono-bibliographie » qui contient « les références aux textes qui, à mes yeux, permettent de mesurer la progression dans l’ère de la mémoire ou en sont une particulière illustration ». Elle mentionne des événements politiques, institutionnels ou sociétaux, mais aussi la publication de livres et d’articles. L’ensemble étant classé par ordre chronologique de 1910 (Charles Péguy compose Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne) à 2012 (une douzaine de mentions dont l’entrée en vigueur des nouveaux programmes d’histoire en terminale L et ES, le cinquantenaire de la guerre d’Algérie le discours prononcé par François Hollande à l’occasion du 70e anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv’ et la parution du livre d’Ivan Jablonka, Histoire de grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête, livre auquel Philippe Joutard a consacré deux pages à la fin de son ouvrage pour en montrer tout le caractère novateur.)