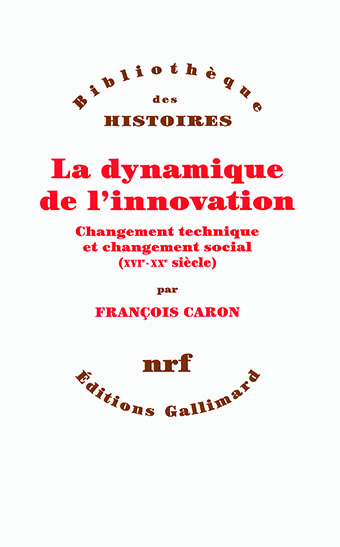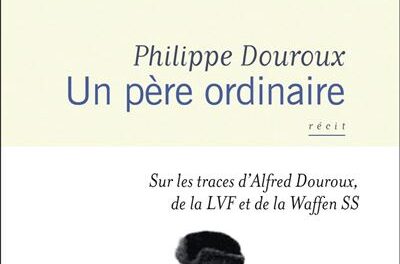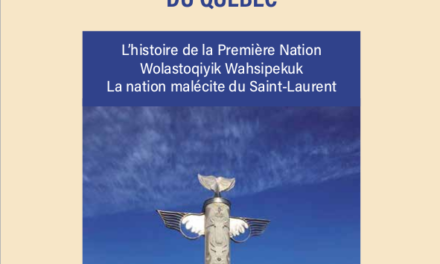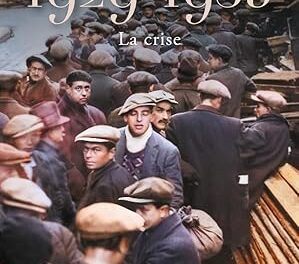Avec cet ouvrage François Caron réussit son entrée dans la prestigieuse collection qu’est la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Ce très grand nom de l’histoire économique nous offre ici une vigoureuse synthèse, irriguée et vivifiée par ses nombreux travaux antérieurs.
Ce livre devrait vite devenir un ouvrage de référence majeur. Le point de départ réside dans le constat que nous vivons, à travers les expériences constitutives de notre univers quotidien, un changement perpétuel de la civilisation matérielle.
Comprendre les ressorts de ce changement passe par une analyse minutieuse des évolutions que connaissent les savoirs techniciens, qui peuvent être décomposés pour les besoins du raisonnement, en savoirs tacites, savoirs formalisés et savoirs codifiés
François Caron nous montre comment le concept ancien de révolution industrielle peut retrouver une vraie pertinence quand on veut saisir dans la longue durée les fils du processus d’industrialisation. Le choix assumé de privilégier une entrée par la technique ne le conduit pas à réduire la perspective d’ensemble, bien au contraire puisque toute sa démarche vise à l’élargir en examinant avec finesse la variété des interrelations à l’œuvre entre quatre catégories d’acteurs directement impliqués dans la création et la perpétuelle recomposition des savoirs techniciens : artisans/ouvriers, experts/ingénieurs, savants/universitaires, entrepreneurs. Ces quatre catégories d’acteurs sont porteuses d’un processus d’innovation dont il s’agit de faire l’histoire, ce qui ne peut à ses yeux être possible qu’à condition d’en avoir une vision dynamique, attentive aux erreurs, à ce qui n’a pas marché, et plus généralement à l’instabilité des systèmes techniques.
Il en résulte une grille d’investigation axée sur l’hypothèse que la construction de ces savoirs techniciens est le produit des relations entre quatre composantes d’un système global : formation d’un corpus de savoirs techniciens et scientifiques organisés en filières ; développement de puissantes institutions de recherche ; mise en place d’un réseau de relations sociales entre les acteurs qui participent à la construction de ces savoirs ; établissement de relations entre le consommateur final et la production de ces savoirs.
Savoirs empiriques et savoirs formalisés (XII° – XIX°)
Cette partie explore la dynamique graduelle des savoirs faire, qui s’élaborent à travers des processus d’apprentissage de caractère collectif, qui commencent autour du XII°, sur un mode artisanal entre savoirs tacites et savoirs empiriques, qui passent ensuite de l’artisan à l’expert (Leonard de Vinci) dans une première étape de la formalisation autour du XVI°, avant d’aboutir, autour des XVIII°-XIX°, aux connaissances formalisées dont vont pouvoir se saisir, pour les porter plus haut, ingénieurs professionnels et entrepreneurs à la Richard Arkwright.
En première période, le monde des métiers offre un cadre institutionnel aux savoirs de la main qu’incarnent par exemple au XVIII°, mécaniciens polyvalents de Birmingham ou ébénistes parisiens. En deuxième période, l’appropriation du savoir artisanal aboutit à greffer sur les savoirs tacites une ébauche de science de l’ingénieur dans chaque secteur : on voit se déployer cette logique dans les planches de l’Encyclopédie. C’est en période trois, que s’opère la reconnaissance collective, exprimée par la création de corps d’ingénieurs de l’Etat ou par la structuration de l’Université, d’un solide corpus de connaissances formalisées adossées à une floraison de traités techniques. Le quatrième chapitre peut alors être consacré à l’examen de trois aventures technologiques (énergie, mécanisation, chimie) qui incarnent la première révolution industrielle.
Lieux de convergence des savoirs et lieux de créativité technique (1830-1960)
Dans une deuxième partie, l’auteur se donne pour objectif d’examiner quatre éléments moteurs d’une convergence décisive entre les différents types de savoirs techniciens (ce qui impose au préalable de cesser d’opposer l’expérience, supposée routinière, du monde artisanal aux pratiques innovantes qui seraient issues de la science) qui peuvent être portés par les métiers d’artisans, les savoirs d’ingénieurs, les cultures d’entreprise et les réseaux universitaires.
Par hypothèse, les entreprises sont vues par l’auteur comme le lieu privilégié de cette grande convergence, à la fois parce que dans cette période les entrepreneurs, partis à l’aventure en imaginant des produits nouveaux, incarnent la dynamique du système et parce que la survie même de l’entreprise passe par sa capacité collective à accéder aux nouveaux savoirs.
Les cultures de métiers ne disparaissent pas, même si elles sont emportées dans une continuelle restructuration forcée : la deuxième révolution industrielle est stimulée par la multiplication des innovations de métier. S’approprier cette expérience est au cœur de la nouvelle culture de l’engineering, en recherche constante, dans les sciences de l’ingénieur, de nouveauté et de performance. Chaque pays construisant des systèmes différents, plus universitaire en France, plus empirique aux Etats-Unis, d’enseignement technique.
Les derniers chapitres de cette partie sont consacrés à la présentation de deux trajectoires.
L’univers de la machine à vapeur, est d’abord dominé par les savoirs empiriques dans un monde professionnel constitués de mécaniciens et d’ingénieurs. Le développement de la thermodynamique, dont l’auteur nous montre les étapes et les difficultés d’application (un seul exemple : le problème des joints d’étanchéité), intègre à ce monde professionnel, des savants et des universitaires qui prennent la main. Cela aboutit, à la fin XIX°, à un modèle cohérent de développement et d’application de savoirs techniques, sauf qu’il s’agit alors d’un modèle dont les capacités d’évolution semblent complètement saturées.
L’univers de la chimie, des années 1880 aux années 1960, permet d’examiner trois types de culture technique qui coexistent : l’atelier, le laboratoire, le génie chimique. C’est l’un des chapitres les plus fascinants de l’ouvrage puisque consacré à un univers moins familier qui a suscité bien des idées reçues. Au début, la rencontre entre la chimie organique et l’industrie des colorants s’effectue dans un cadre entrepreneurial, qui peu à peu se transforme en système intégré dans les grosses entreprises allemandes, tout en maintenant la combinaison recherche académique/expérience d’atelier. L’essor de la thermochimie et de l’électrochimie pousse à une recherche planifiée pour abolir le hasard, eu égard aux lourds investissements exigés par la nouvelle industrie des polymères qui, cherchant des produits de synthèse (caoutchouc), aboutit à développer une science des polymères : la bakélite (le premier plastique) sera ainsi le premier produit issu d’une liaison purement chimique. La dernière étape va être celle de la chimie macromoléculaire qui prend un brutal essor dans les années 30 aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Royaume Uni, les années 50 étant marquées par le passage à la pétrochimie.
La dynamique du changement technique
Deux idées fortes charpentent cette troisième partie : dans les différentes filières, il existe un réseau d’interdépendances techniques qui constitue pour chacune une dépendance de sentier ; la technologie est une construction sociale produit de l’activité de réseaux sociaux.
La dépendance de sentier tient à ce que les trajectoires technologiques évoluent au rythme des réponses apportées aux dysfonctionnements du système de production, ou/et à l’inadaptation des produits à leur usage. L’innovation est alors une adaptation, par tâtonnements successifs, à la demande sociale. Tout se passe comme si les choix initiaux commandaient la trajectoire, de sorte que les sentiers possibles deviennent toujours plus étroits à force de recompositions. La sidérurgie française au XIX° ou les débuts de l’aéronautique illustrent ce propos.
La notion de réseaux sociaux, empruntée aux modèles de B. Latour et de M. Callon, est saisie à travers des études de cas : la communauté gazière qui, au XIX°, tente de construire la demande, la diffusion généralisée du discours électrique, le succès de la Bakélite, de la soudure autogène, la construction d’un pôle technoscientifique à Grenoble depuis le premier cours d’électricité donnée à l’université en 1887, jusqu’à la Zirst de Meylan dans les années 1970, en passant par l’ancrage d’un véritable empire physicien dans la province française. Tout cela débouche sur la notion de district industriel et de système productifs locaux.
Le consommateur final et le citoyen ordinaire, acteurs du changement technique
La quatrième partie du livre installe la consommation au cœur de l’analyse en partant de l’idée que les objets techniques ne sont ni socialement ni culturellement neutres. Quatre modèles de consommation successifs sont alors examinés : jusqu’aux années 1880, le modèle initié par les anglais à la fin du XVIII°, qui avaient inventé la valorisation du bien être par l’usage de produits nouveaux, s’affirme et se généralise dans une première ébauche, surtout américaine de la société de consommation (l’offre créatrice dépendant fortement de la demande social pour le demi-luxe) ; la deuxième révolution industrielle a permis le passage à la double révolution de la production et de la consommation de masse entre 1880 et 1970, tandis que la période actuelle serait caractérisée par les effets d’une troisième révolution industrielle transformant, les produits (un quotidien technologisé avec la prolifération des objets communicants), l’entreprise (avec le passage à l’entreprise réseau ), la production des connaissances dans un réseau interactif mondial.
Par son ambition et par l’ampleur des thématiques abordées, cet ouvrage devrait s’imposer comme une synthèse marquante alors même que se multiplient depuis les années 1970, des travaux croisant les approches historiques, sociologiques et anthropologiques autour des sciences et des techniques de manière à montrer comment elles sont construites et négociées, non sans controverses, par des sociétés. Les professeurs trouveront dans ce livre à la fois, une vision d’ensemble très cohérente, et des études de cas stimulantes, le tout écrit avec beaucoup de clarté et un souci de pédagogie bien appréciable pour un sujet souvent perçu comme ardu.
Post-Scriptum
Signalons en complément de la « trajactoire chimie », un excellent livre qui apporte un éclairage très complémentaire : Pap Ndiaye, « Du nylon et des bombes. Du Pont de Nemours, le marché et l’Etat américain, 1900-1970 », Belin, 2001
Un numéro spécial des Annales Histoire Sciences Sociales a été consacré en juillet-Août 1998 à ce vaste mouvement des « social studies of knowledge ».