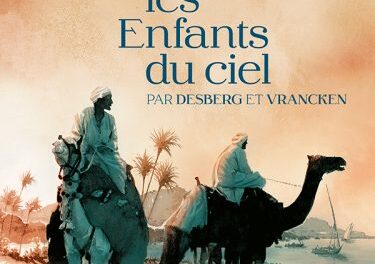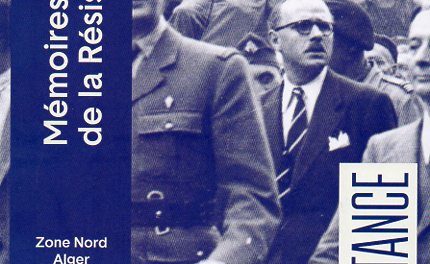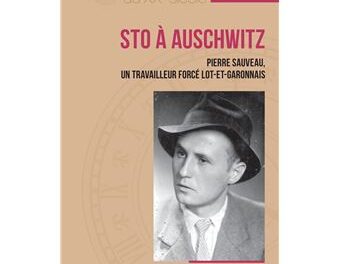En 1940, Arlette Lévy-Andersen est une lycéenne parisienne de seize ans qui vit dans une famille de petits commerçants juifs non pratiquants. Ancien combattant de la Grande Guerre, son père est vite conscient que ce fait ne le protègera pas du Statut des Juifs et des mesures antisémites. Durant l’été 1942, la famille part s’installer près de Clermont-Ferrand. Arlette, désormais bachelière, s’inscrit à l’université de Clermont-Ferrand, pour y suivre des études d’anglais. Elle est arrêtée le 25 novembre 1943, lors de la rafle destinée à briser les réseaux de résistance au sein de l’université de Strasbourg repliée en Auvergne, la plus grande rafle jamais perpétrée dans le milieu universitaire français.
D’abord détenue dans une caserne clermontoise, elle est ensuite transférée à Drancy, puis déportée à Auschwitz- Birkenau en janvier 1944. Elle échappe à la sélection, et survit près des crématoires pendant une année terrible. Animée par une profonde envie de vivre, la jeune femme fut l’une des rares personnes déportées à survivre au camp et à la marche de la mort qui lui fut imposée en janvier 1945. Par la suite, mariée à un Danois, elle devient enseignante de Français au Danemark. Après des décennies de silence, elle décide de témoigner au début des années 1990 et donne des centaines de conférences, en particulier dans les lycées, pendant 25 ans. Elle est décédée le 23 août 2022.
Le journaliste, photographe, auteur et documentariste danois Thomas Kvist Christiansen, connaissait Arlette Lévy-Andersen car il habitait dans la même rue de la petite ville danoise de Fredericia. Mais il ne découvre son itinéraire qu’en 2012, par la lecture d’un livre qui lui est consacré, Une jeune fille à Auschwitz. Il propose alors à Arlette de réaliser un film documentaire sur sa vie. Elle accepte et le film, Arlette, une histoire que nous ne devons jamais oublier, est projeté pour la première fois en mai 2017 à Fredericia. Dans un second temps il choisit de rédiger un livre, dont la traduction française par Fabrice Boyer, diplômé de l’École des chartes et directeur de la bibliothèque du site universitaire Clermont Auvergne, est parue en 2021 aux Presses Universitaires Blaise Pascal, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
« L’édition érudite d’une traduction de la vie d’Arlette par Thomas Vis Kristiansen »
Thomas Kvist Christiansen, a consacré plusieurs années de travail à comprendre et analyser le parcours singulier d’Arlette Lévy-Andersen. Il nous livre le résultat de son travail sous la forme de ce beau livre, Nous sommes ici pour mourir, phrase prononcée par une déportée à laquelle Arlette demandait des renseignements sur le camp, peu après son arrivée. Il s’agit d’un « beau livre » au sens éditorial du terme : grand format, couverture cartonnée, papier de qualité, mise en page soignée, nombreuses photographies de divers formats, en noir et blanc et en couleur. Mais il s’agit aussi d’un beau livre au sens plus global du terme : par la clarté et la solidité de son contenu documentaire, par le travail de mémoire qu’il entend réaliser, par la profonde empathie qu’il révèle de l’auteur pour son héroïne.
« Ce livre n’est pas seulement l’histoire personnArlette Lévy-Andersenelle d’Arlette Lévy-Andersen. Il a également l’ambition de rendre compte de ses tournées de conférences, qui se sont étalées sur de nombreuses années, comme celle de répondre à l’enjeu du devoir de mémoire sur Auschwitz et sur l’Holocauste. C’est pourquoi vous y trouverez des extraits de ses interventions publiques », écrit-il. Dans son introduction, Julien Bouchet, chercheur associé au laboratoire Centre d’Histoire « Espaces & Cultures », analyse la particularité du livre, dans lequel la réalité historique est « triplement filtrée ».
– Arlette Lévy-Andersen ne s’est penchée sur son passé que longtemps après les faits, lors d’un « réveil mémoriel », à la fin des années 1980.
– Le regard de Thomas Kvist Kritiansen est à la fois celui d’un voisin, d’un artiste et d’un ami. Sa « médiation narrative » éloigne le texte du livre du statut de témoignage brut.
– « Plusieurs amendements ont été utiles à l’établissement de la véracité historique, notamment lorsque le traducteur a modifié la chronologie du déplacement des facultés strasbourgeoises (…) Le texte initial a enfin été augmenté par une édition critique », réalisée par une historienne, Françoise Fernandez, responsable scientifique du musée de la Résistance du Mont Mouchet, et par un historien, Julien Bouchet, chercheur associé au laboratoire Centre d’Histoire « Espaces & Cultures ». Ce dernier peut ainsi définir cet ouvrage comme « l’édition érudite d’une traduction de la vie d’Arlette par Thomas Kvist Kristiansen ».
Ce témoignage hybride est ainsi relatif à une triple histoire : un parcours d’une jeune femme dans une France qui ne veut progressivement plus d’elle, une étudiante d’une université double qui est frappée en son cœur à la fin de 1943, une prisonnière dominée par l’attente de jours plus heureux et la peur d’un destin tragique ». Insistons donc sur la richesse documentaire de l’ouvrage qui s’explique par la constante contextualisation par l’auteur des événements de la vie d’Arlette (occupation de la France, repli de l’université de Strasbourg, processus de déportation, phénomène concentrationnaire, marche de la mort, histoire de la mémoire), et par la diversité même de ces événements. Ce compte-rendu insistera plus particulièrement sur la rafle universitaire de novembre 1943, sur l’expérience concentrationnaire et sur le militantisme mémoriel d’Arlette Lévy-Andersen.
Arlette Lévy, étudiante prise dans la rafle universitaire du 25 novembre 1943
En 1939, à la suite de la déclaration de guerre, la ville de Strasbourg est déclarée zone militaire par l’État-Major ; une partie de la population se voit donc contrainte d’évacuer la ville. L’administration de l’Université de Strasbourg est déplacée vers Clermont-Ferrand. Les étudiants et les professeurs suivent l’administration en Auvergne formant un groupe d’environ 1200 personnes. A la suite de l’Armistice du 22 juin 1940, les Allemands créent la Reichsuniversität de Strasbourg et de fait, le déplacement de l’Université en Auvergne ne se justifie plus. De nombreux professeurs et étudiants décident cependant de ne pas retourner vers l’Alsace redevenue allemande. En 1941 naissent au sein de l’Université, les premiers mouvements de Résistance. On y trouve des enseignants et des étudiants de Strasbourg mais aussi de Clermont. En 1942 les mouvements s’unissent au sein du Mouvement unis de la Résistance créé à la suite de l’arrivée de l’occupant dans la zone Sud.
Afin de supprimer les activités anti-nazies, l’Allemagne lance des opérations visant à fermer l’Université et à rapatrier à Strasbourg les 500 Alsaciens considérés comme Allemands de souche. En 1943 plusieurs rafles sont organisées dont celle du 25 novembre : une vaste opération est menée dans presque tous les locaux universitaires communs aux deux universités de Clermont et de Strasbourg. Environ 1 200 personnes sont interpellées ce jour là. 500 personnes sont gardées toute la journée, 130 personnes seront finalement arrêtées pour être déportées. Seule une trentaine d’entre eux reviendra des camps.
Le 25 novembre 1943 est un jeudi. C’est le jour de la semaine où les étudiants sont présents en plus grand nombre, puisque ceux qui sont employés dans les lycées et collèges sont en congé. Ce matin d’automne, le froid est perçant et le ciel gris. Arlette Lévy, alors étudiante en anglais, grimpe dans son bus pour rejoindre le site universitaire de l’avenue Carnot. Elle vit au « Bon Accueil », une pension de famille de Durtol (village à six kilomètres du centre de Clermont-Ferrand) tenue par Georges Froidefond, le maire de la commune. Pendant son cours de littérature, cette bonne élève est assise au premier rang. Soudain, une alarme retentit. Elle aperçoit des soldats allemands courir le long des fenêtres.
Les bâtiments de la nouvelle université, avenue Carnot, sont cernés et envahis par 200 hommes de la base aérienne de la Luftwaffe d’Aulnat, armés de fusils et de pistolets mitrailleurs, sous les ordres du colonel Edzard, commandant de la base. Étudiants et enseignants sont poussés sans ménagement dans la cour intérieure. Arlette a tout juste le temps d’attraper son manteau.
Les secrétariats des facultés de Strasbourg, au deuxième étage de l’avenue Carnot, sont envahis par un groupe de policiers allemands en civil, revolver au poing. Parmi eux se trouve un étudiant en histoire et en droit de Strasbourg, Georges Mathieu. Ce dernier a été l’un des chefs des Mouvements unis de la Résistance (MUR) du Puy-de-Dôme. Arrêté le 23 octobre 1943 par le Sipo-SD, il accepte de travailler pour elle dans le Sonderkommando d’auxiliaires français de la Gestapo. On ordonne aux personnes présentes de lever les mains et de sortir des bureaux. Le professeur de papyrologie, Paul Collomp, résistant, tarde à s’exécuter. Jugeant qu’il n’obéit pas assez rapidement, un agent de la Gestapo lui décharge son revolver en pleine poitrine. Laissé pour mort, il agonise par terre une partie de la matinée avant de mourir.
Vers 11 heures, plus d’un millier de personnes sont rassemblées dans la cour intérieure, en silence, les mains en l’air sous l’œil de sentinelles postées, avec leurs mitraillettes, aux fenêtres ainsi qu’à toutes les issues de la cour. Le rôle principal est tenu par Georges Mathieu, un étudiant organisateur de la Résistance et passé au service de la Gestapo, qui est expert en détection des faux papiers puisque c’est lui qui les a confectionnés. Il identifie évidemment ses camarades. Les personnes, qui ne sont pas retenues, la plupart des Clermontois et quelques Strasbourgeois, sont libérées vers 17 heures.
Après avoir présenté ses papiers, Arlette grimpe dans un camion pour rejoindre la caserne du 92ème Régiment d’Infanterie. Les garçons et les filles sont séparés. Son groupe est conduit dans un gymnase sans confort. Durant les quelques semaines de sa détention, l’étudiante clermontoise écrit une vingtaine de lettres à ses parents. L’ouvrage nous les montre et en analyse le contenu. Malgré l’incertitude pesant sur son sort, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, se montrant même optimiste et joyeuse. Sans doute pour ne pas inquiéter ses proches. Cette étrange parenthèse s’achève au début de janvier 1944. Triées, les personnes au patronyme juif quittent la ville dans un train de nuit. Le train arrive à Paris, sa ville natale, au petit matin. De la gare du Nord, on intime aux passagers l’ordre de s’entasser dans des bus. Au terme de leur périple, ils arrivent au camp de Drancy. Ici aussi, Arlette a la chance de pouvoir envoyer quelques lettres à ses parents. Mais comme à Clermont-Ferrand, elle ne laisse rien transparaître de son inquiétude. Elle occupe un dortoir avec d’autres prisonniers. Ses journées se résument aux corvées de ménage et de repas.
La majorité des hommes non juifs, après des séjours plus ou moins longs au « 92 », puis à Compiègne, sont déportés au camp de concentration de Buchenwald, d’où beaucoup sont envoyés dans des camps encore plus durs, comme le tunnel de Dora. Les femmes non juives sont déportées au camp de concentration de Ravensbrück ; certaines sont transférées ensuite à Neuengamme, puis à Bergen-Belsen . Les Juifs passent par le camp de transit de Drancy, avant d’aboutir au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, où la plupart sont exterminés.
Le traître Georges Mathieu, arrêté après la Libération, est condamné à mort par la cour de justice de Clermont le 17 novembre 1944 et fusillé le 1er décembre. Depuis la Libération, tous les ans le 25 novembre, l’université de Strasbourg et celle de Clermont, commémorent en présence des survivants, de moins en moins nombreux, cette rafle, de loin la plus importante subie par une université durant l’Occupation.
L’expérience concentrationnaire de la jeune Arlette Lévy
Douze chapitres sur les trente-trois qui composent le livre sont consacrés au parcours concentrationnaire d’Arlette : le voyage, l’arrivée et la première sélection, les Kommandos extérieurs de travail, l’intégration dans un emploi industriel intérieur moins exposé au risque de mort, la survie quotidienne, le départ du camp et la marche de la mort, la survie dans les jours qui ont suivi jusqu’à la libération et au retour.
Le 20 janvier 1944, à la tombée de la nuit, les soldats poussent 1153 personnes (539 femmes et 614 hommes), dont Arlette, dans le convoi n° 66. Entassés dans des wagons à bestiaux, les prisonniers ignorent le sort qui les attend. A la promiscuité et l’obscurité s’ajoute l’angoisse de l’inconnu. Après trois jours et trois nuits d’enfer, le train atteint sa destination finale, Auschwitz, au sud de la Pologne. Nous sommes le 23 janvier 1944 au petit matin.
« Les personnes plus âgées, ainsi que les familles comportant des enfants devaient monter dans des véhicules, « pour leur épargner la fatigue de la marche » nous disait-on. Nous avons rapidement compris qu’on ne pouvait rien espérer de bon des Allemands. Ces pauvres gens avaient été envoyés directement dans les chambres à gaz », racontera-t-elle plus tard. Ses 19 ans et sa bonne forme physique lui permettent d’échapper à la chambre à gaz et d’être dirigée sur le camp des femmes de Birkenau où elle est affectée à un Kommando de travail extérieur, après avoir subi les étapes du long et humiliant processus d’enregistrement.
Devenue un simple numéro (74853), Arlette endure pendant plusieurs mois un calvaire absolu. Elle décrit les appels dans le froid glacé, les longues journées d’un travail inutile et éprouvant, la faim permanente, l’amaigrissement, la peur de partir à la chambre à gaz dès la prochaine sélection
Elle doit sa survie à la chance, dit-elle, mais aussi à l’amitié. Elle a connu Denise pendant sa détention à Clermont-Ferrand ; elles sont parties ensemble à Drancy ; elles étaient ensemble dans le wagon qui les conduisit à Auschwitz ; elles parvinrent à ne pas se séparer et à partager le même block. Dans les conditions terribles qui sont les leurs, l’amitié est fondamentale. Un autre facteur explique sa survie : c’est l’intervention inespérée d’un déporté juif de Salonique, Jacques Stroumsa, ingénieur affecté à l’usine d’armement. La protection de son responsable allemand, ulcéré par le meurtre de masse qui se déroulait sous ses yeux, avait valu à Jacques Stroumsa une place particulière qui lui laisse la possibilité de faire venir dans l’usine d’armement où il travaille des prisonniers choisis. C’est ainsi qu’Arlette Lévy devient ouvrière en atelier, une tâche moins pénible physiquement que les travaux extérieurs. Elle n’a pas compris sur le moment le processus qui lui a permis cette faveur. Elle n’a découvert le nom de son sauveur que 50 ans plus tard, alors qu’elle regardait à la télévision, les cérémonies commémoratives de la libération d’Auschwitz. Elle a pu le contacter assez rapidement (il habitait en Israël), parler avec lui, et l’inviter au Danemark où ils se retrouvèrent avec Denise lors de l’anniversaire de la libération d’Auschwitz.
Un peu reconstituée dans ce poste plus abrité, elle doit affronter deux marches de la mort entre Auschwitz, qu’elle quitte avec Denise dans le froid glacial du 18 janvier 1945, et Ravensbrück qu’elles atteignent à la fin du mois de février, après 600 kilomètres parcourus à pied ou dans des wagons non chauffés. Après Ravensbrück elles gagnent le camp de Malchow où leur parviennent les premiers colis de la Croix-Rouge. Arlette se précipite sur la nourriture, engloutit divers aliments et est gravement malade. C’est ensuite le déchirement de la séparation avec Denise, évacuée sur Bergen-Belsen, début avril. Arlette est de retour à Paris à la fin du mois de mai 1945. Des 1153 juifs du convoi 66 entre Drancy et Auschwitz, seuls 47 ont survécu.
Arlette Lévy-Andersen, militante de la de mémoire
Elle a l’immense joie de retrouver sa famille, puis son amie Denise. « J’ai mangé, mangé le jour et même deux fois la nuit ». Elle veut vivre, mener une vie normale et heureuse, elle ne parle pas de l’horreur d’Auschwitz, elle ne veut pas en parler, et d’ailleurs on ne lui demande pas de le faire. Elle fait sa rentrée à la Sorbonne. Durant l’été 1946, elle part six semaines au Danemark avec un groupe de jeune, grâce au soutien financier de l’Alliance française. Elle fait la connaissance d’Ole Andersen, qui fait des études d’anglais lui aussi, à l’université de Copenhague.
Dans le courant de l’été 1951, cinq ans après leur première rencontre, Ole et Arlette se marient à Paris et, peu après, Arlette part vivre au Danemark. Le couple s’installe à Fredericia (Jutland) où Ole est professeur au lycée. Arlette apprend la langue, devient mère de deux enfants et obtient un poste de professeur de français au lycée. Jamais elle ne parle de sa déportation ; elle s’efforce même de dissimuler le tatouage visible sur son avant-bras. Une fois seulement au milieu des années 1970, elle accepte de répondre aux questions de ces élèves sur ce sujet. Elle constate qu’ils sont émus et intéressés. Elle constate aussi qu’elle n’est pas insensible à cet échange. Mais c’est un événement bien précis qui va décider à prendre la parole pour témoigner : les déclarations de Jean-Marie Le Pen.
Le 13 septembre 1987, invité au Grand Jury RTL-Le Monde, Jean-Marie Le Pen est interrogé sur la contestation par des négationnistes de l’utilisation par les nazis des chambres à gaz homicides. Il répond alors : « Je n’ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c’est un point de détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Ces déclarations ont heurtent violemment Arlette : « Pour d’aucuns, Auschwitz n’existe pas ; un homme politique d’extrême droite en France, Jean-Marie Le Pen, a déclaré que ce n’était qu’un détail. Et peut-être la raison la plus importante de mon engagement tient au fait que j’étais parmi les plus jeunes (déportés à Auschwitz) qui sont revenus en 1945 : le temps faisant son œuvre, aucun témoin de cette époque bientôt ne sera encore vivant. C’est pourquoi, j’ai commencé à raconter mon histoire ».
Le 14 mars 1990, elle donne une première conférence à Fredericia. Il lui a fallu convoquer ses souvenirs et reconstituer la chronologie de son histoire. Avec cet effort, les cauchemars qu’elle avait connus et qui avaient disparus, reviennent hanter ses nuits. 150 personnes sont venues l’écouter. Désormais elle ne se taira plus. Son activité de conférencière occupe une place croissante de sa vie, surtout après qu’elle ait pris sa retraite en 1994. En 1996, elle a déjà à son actif 32 conférences, pour l’essentiel dans des établissements scolaires. Son rythme s’accroît par la suite. Rien que pendant l’année 2008, elle donnent 65 conférences et maintient une moyenne de 50 rencontres organisées par an. En 2015, elle donne dernière conférence devant les élèves du lycée d’Odder : c’est sa 426ème. Près de 100 000 personnes, des jeunes pour la plus grande part, l’ont entendue.
Devoir de mémoire et travail de mémoire
Pour Thomas Kvist Kristiansen, le film documentaire qu’il a réalisé et le présent livre, portent désormais le message qu’Arlette ne peut plus délivrer. Ce livre et ce film sont donc des éléments du travail de mémoire qu’il réalise ainsi, bien qu’il parle de devoir de mémoire. Sans vouloir jouer sur les mots, il convient de faire la différence. Le devoir de mémoire est la plupart du temps une injonction adressée de manière péremptoire aux générations qui n’ont pas vécu la guerre, aux enseignants en particulier, injonction qui vise à obliger toute une société à rester éternellement les yeux rivés sur un passé tragique. C’est oublier que le rappel d’un événement n’empêche pas qu’il se reproduise, ni même que les victimes ne se transforment en bourreau. L’expression de « travail de mémoire » est due au philosophe Paul Ricœur ; elle s’inspire de la pratique analytique et rappelle celle du « travail de deuil » inventée par Freud. Le travail de mémoire est un effort critique, réflexif et interprétatif : il permet d’extraire des souvenirs traumatisants leur valeur exemplaire ; comme le travail de deuil, il réconcilie le passé avec le présent et l’historien y prend toute sa place. C’est un travail dialectique de la mémoire et de l’histoire. Arlette Levy-Andersen avait vécu les événements, elle pouvait se remémorer, et quand elle participait à des cérémonies, elle se situait effectivement dans le cadre de ce qu’elle pouvait considérer comme son devoir de mémoire. Thomas Kvist Kristiansen par ses recherches, l’écriture d’un texte en collaboration avec des historiens, se situe dans le cadre d’un travail de mémoire.
Le film a été projeté à Clermont-Ferrand, encore récemment à l’occasion des cérémonies du 80ème anniversaire de la rafle, en présence de Thomas Kvist Kristiansen. Il a participé au colloque universitaire qui s’est déroulé en novembre 2023 à Clermont-Ferrand puis à Strasbourg, où il a parlé avec beaucoup de chaleur et de justesse d’Arlette et de son engagement pour faire vivre le souvenir et croître la connaissance de la déportation et du projet nazi de génocide. L’histoire d’Arlette Lévy-Andersen est devenue, dans le processus commémoratif de la rafle, « un témoignage pivot ». Les conférences d’Arlette Lévy-Andersen, le film et le livre de Thomas Kvist Kristiansen sont des éléments importants de la transmission de la mémoire de la Shoah et de l’histoire d’Auschwitz.