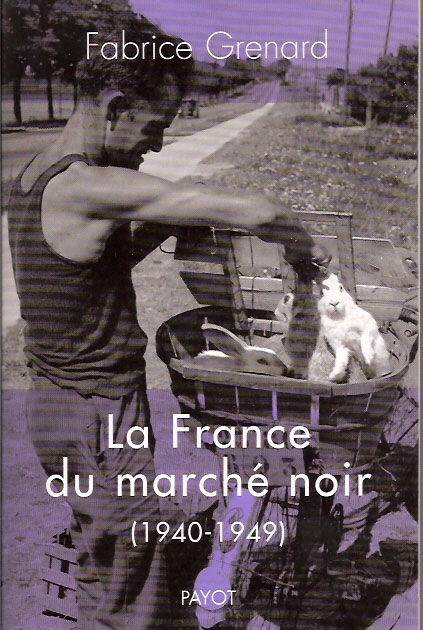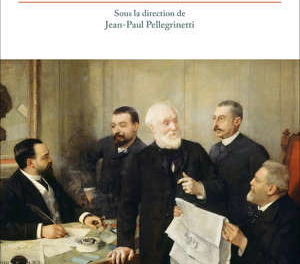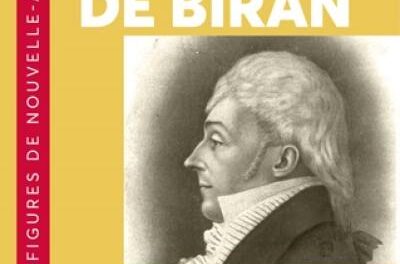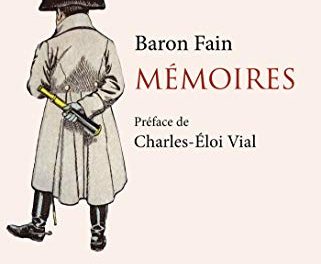Agrégé d’histoire, Fabrice Grenard a soutenu en décembre 2004 une thèse de doctorat qu’il avait conduite sous la direction de Jean-Pierre Azéma. Ce livre en propose une version réduite plus accessible au grand public. C’est la première histoire globale du marché noir en France. La majeure partie des sources est constituée par les fonds conservés au centre des archives économiques et financières, notamment ceux du Contrôle économique.
L’ouvrage est composé de dix chapitres regroupés en quatre parties chronologiques que viennent compléter 18 pages de notes, quelques annexes, un index et un fort utile index thématique (avec des entrées telles que : Beurre, Charbon, Chaussures, Viande, mais aussi Abattage clandestin, Police économique, ou encore Côte d’Azur, Caisse d’Epargne et même… Fouquet’s.). La composition est remarquablement structurée, titres, sous-titres, introductions et transitions mettent en évidence les idées directrices, permettant de suivre aisément et agréablement la pensée de l’auteur.
Le temps des mercantis (1940-1941)
C’est au cours de l’automne 1940 que l’expression de marché noir s’imposa pour désigner l’ensemble des infractions à la législation économique. Il semble que son origine soit allemande et qu’elle date de la Première Guerre mondiale. Le phénomène prit une véritable ampleur quand se mirent en place le rationnement et les services chargés de faire respecter la réglementation économique (fixation de prix maxima aux producteurs et aux commerçants, contingentement des matières premières, rationnement des denrées délivrées aux consommateurs). Alors s’organisèrent et se structurèrent les premiers réseaux de commerce clandestin. A leur tête se trouvaient des trafiquants que la presse de l’époque stigmatisa sous le nom de « mercantis », reprenant une expression utilisée au cours de la Première Guerre mondiale pour dénoncer les profiteurs. Les trafics portèrent sur les denrées alimentaires, les cartes de rationnement, les matières premières et les produits industriels.
A la fin de 1940, le marché noir devint l’une des grandes préoccupations de la société française, alimentant les conversations et canalisant les ressentiments. Il devint un prétexte aux dénonciations les plus diverses : le commerçant, le paysan, le Juif surtout. Le phénomène fut quasi unanimement condamné, à l’exception des quelques privilégiés qui en profitèrent pour échapper aux restrictions. La presse multiplia les campagnes contre les profiteurs du marché noir. Les opposants à Vichy (collaborationnistes et résistants) exploitèrent le phénomène pour démontrer l’échec de la Révolution nationale.
Constatant que ces critiques portaient dans les classes populaires, Vichy fit de la répression du marché noir l’une de ses priorités, multipliant déclarations fracassantes et mesures spectaculaires tout en renforçant les moyens et les pouvoirs des divers services répressifs (Contrôle des prix, Contrôle mobile du ravitaillement, Police économique) et en créant de nouvelles sanctions et de nouvelles juridictions. Dans son discours du 12 août 1941 Pétain promit de prendre des mesures d’exception contre « le scandale des fortunes bâties sur la misère générale ».
Les Allemands contribuèrent à encourager le marché noir en constituant des « bureaux d’achat » qui leur permirent grâce à un mark surévalué de piller la France. L’auteur établit alors la distinction entre le marché noir (motivé par l’argent, il fait intervenir un trafiquant qui achète au producteur et revend à un prix très élevé), le marché gris (motivé par la recherche de compléments alimentaires il met en contact direct le consommateur et le producteur qui lui vend à un prix inférieur à celui du marché noir mais supérieur à celui du prix autorisé) et le marché brun (vente aux Allemands par des trafiquants qui utilisent des intermédiaires nombreux). C’est dans le cadre de ce marché brun que s’édifièrent les fortunes les plus colossales par des auxiliaires français recrutés parmi les affairistes et les trafiquants (comme la fameuse bande de la rue Lauriston réunie autour de Lafont ou celle de Joseph Joanovici, le « chiffonnier milliardaire »).
Un double processus de généralisation et de « démocratisation » (automne 1941-1943)
Les restrictions ne cessèrent de s’aggraver et le recours aux transactions parallèles devint inéluctable. Cette situation fit sauter le « verrou psychologique » qui avait pu empêcher une grande partie des Français de participer au marché noir. L’auteur décrit un double processus de généralisation et de « démocratisation » (terme qui caractérise la participation de toute la société au marché noir) qui fit entrer « tout un peuple en marge de la légalité ».
En amont, au niveau de l’offre, le marché noir cessa d’être l’apanage de catégories plus ou moins douteuses. Les paysans retrouvèrent les vieux réflexes de résistance à l’État et cherchèrent à livrer le poins possible aux services du Ravitaillement. En aval, au niveau de la demande, la situation des consommateurs devint insupportable en ville (le rationnement officiel permettait d’acquérir 1300 à 1500 calories par jour pour un adulte ; cette ration tombe à 1100 calories fin 1941). Alors se constituèrent de nouvelles filières par l’établissement de liens directs entre producteurs et consommateurs : ce fut le triomphe du marché gris. Des milliers de citadins à bicyclettes investirent les campagnes proches des grandes villes en fin de semaine. La SNCF vit apparaître un nouveau type de voyageur : celui « qui partait le matin avec une ou deux valises vides et qui revenait le soir croulant sous le poids de ses bagages ». Vichy autorisa en octobre 1941 l’expédition d’une quantité limitée de denrées du producteur au consommateur au moyen de « colis familiaux » ; l’initiative reçut un vif succès et les tricheries sur la composition et le poids des colis furent fréquentes. L’auteur estime que « ces différentes formes d’approvisionnement parallèle ont permis d’améliorer la situation des Français sous l’Occupation en comblant quelque peu les insuffisances du ravitaillement officiel ». Il montre aussi que « le marché noir connut un processus de généralisation (…) dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie ».
Face à cette situation, face aux nombreuses critiques émises sur une répression accusée de s’acharner contre les petits délinquants, le gouvernement de Vichy « qui avait largement échoué dans sa tentative de discipliner l’ensemble du corps social » fut obligé d’assouplir sa position et se rallia à l’idée que les petits trafics ne devaient pas être mis sur le même plan que les gros. Il s’ensuivit une réforme de la législation de la répression du marché noir (loi du 15 mars 1942 qui mit en place une répression différenciée) ainsi qu’une restructuration des organes de contrôle chargés de le combattre (création de la Direction générale du contrôle économique et suppression du contrôle mobile, très impopulaire).
Dans le chapitre qui termine la seconde partie l’auteur dresse un bilan du marché noir au cœur de l’Occupation et détruit certaines idées reçues. Il montre que le marché noir porta sur 10 à 20% de la production agricole, proportion qu’il faut doubler si l’on ajoute le marché gris : « ce qui permet de nuancer quelque peu l’image de l’agriculteur profiteur et confirme que les paysans produisaient d’abord pour leur consommation personnelle. Dans bien des cas, la part du marché amical apparaît également supérieure à celle du marché noir, ce qui sous-entend que l’on a pu d’abord faire preuve de solidarité ». Il montre encore que l’on pouvait trouver absolument tout au marché noir : chaussures, vêtements, pneus, quincaillerie, bois, cuirs, articles de sport, etc.
Le marché noir, enjeux patriotique (printemps-été 1943-été 1944)
Au cours des deux dernières années de l’Occupation, la perception du marché noir connut de nouvelles modifications. A la légitimation économique qui s’était manifestée en 1941-1942 et avait conduit Vichy à faire preuve de tolérance à l’égard des petits trafics s’ajoutait désormais un processus de légitimation patriotique : les infractions à la réglementation économique étaient désormais présentées comme des actes de sabotage.
Plusieurs facteurs ont contribué à répandre cette image du « marché noir patriotique » à partir de 1943. Le premier est sans aucun doute le changement radical de la stratégie allemande d’exploitation économique de la France. L’occupant privilégia désormais les prélèvements légaux sur les formes de pillage ; en conséquence il ferma ses bureaux d’achat, arrêta les trafiquants du marché brun ou les transforma en agents de ses activités de police et de renseignement (c’est alors que la bande de la rue Lauriston passa sous la tutelle de la Gestapo). Dans ces conditions Vichy collabora désormais avec les Allemands à la répression du marché noir, ce qui ne fit qu’aggraver l’impopularité des organes de contrôle auxquels se joignit d’ailleurs la Milice.
La Résistance contribua fortement à répandre l’idée du caractère « patriotique » du marché noir en en faisant un thème essentiel afin d’entraver la politique de prélèvement de l’occupant. En légitimant la dissimulation et les transactions clandestines, la Résistance cherche aussi à gagner à sa cause le milieu paysan, qui, « tout en ayant déjà pris certaines distances à l’égard de Vichy, n’en restait pas moins assez indifférent, voir réticent à l’égard de la Résistance et de son action ». La question du ravitaillement des maquis devint alors un enjeu de propagande essentiel entre Vichy et la Résistance. Pour Vichy, il s’agissait de banditisme et de marché noir. Pour la Résistance, au contraire, toute aide alimentaire apportée aux maquisards était un acte de solidarité. Mais la résistance dut imposer des règles strictes, refuser les trafics et lutter contre le banditisme.
Après la Libération : un phénomène persistant et durable (été 1944-fin 1949)
Après la Libération la question du marché noir provoqua de grosses frustrations auprès des Français. La demande sociale fut très forte pour que tous les profiteurs de l’Occupation soient sévèrement sanctionnés. Or les déceptions furent nombreuses et l’idée que les trafiquants avaient été trop complaisamment condamnés fut largement répandue. La volonté d’épuration fut cependant réelle comme le montre la création des comités départementaux de confiscation des profits illicites ; mais les enquêtes furent longues et difficiles et la sanction se limita souvent à un redressement fiscal. L’auteur montre bien l’inefficacité de l’échange des billets de juin 1945 : en choisissant la procédure proposée par René Pléven contre celle voulue par Pierre Mendès France, de Gaulle en fit une véritable « amnistie monétaire » et permit le blanchiment de la quasi-totalité des profits du marché noir.
Les difficultés de ravitaillement persistèrent et s’aggravèrent. La ration de pain tomba en août 1947 à son plus bas niveau depuis son instauration en 1940. « Dans ces conditions, le marché noir continue lui aussi de prospérer, faisant toujours la fortune d’une petite minorité, tandis que la majorité des Français continue d’y recourir ». Il devint également une question politique de premier plan pour tous les gouvernements qui se succédèrent après la Libération, comme en témoigne la valse des ministres du Ravitaillement.
Il fallut attendre 1948, la reprise de la production agricole, celle de la production industrielle, l’arrivée de l’aide du plan Marshall, pour que la situation économique s’améliore vraiment. La carte de pain disparut le 1er novembre 1948 et les dernières restrictions furent levées début 1949 (automobiles et pneus). En décembre 1949 L’Aurore pouvait titrer « Adieu -enfin- au ministère du Ravitaillement ». Adieu aussi au marché noir.
Le phénomène du marché noir fut particulièrement important : plus d’un million de procès verbaux furent établis entre 1940 et 1944, constituant de loin la forme de délinquance la plus répandue au cours de la période. Malgré son caractère clandestin et mystérieux, il fit partie du quotidien de nombreux Français qui y participèrent, soit comme acheteurs, soit comme vendeurs.
Le Marché noir : une place essentielle dans la mémoire collective des français
S’il occupe une place essentielle dans la mémoire collective, il la doit pour beaucoup aux stéréotypes qui y ont été enracinés par le succès du livre de Jean Dutourd Au Bon Beurre, scènes de la vie sous l’Occupation (1952) et par celui du film de Claude Autan-Lara, La Traversée de Paris (1956). Mais il n’avait encore jamais fait l’objet d’une véritable étude historique. Cette lacune est désormais comblée et nous disposons d’un ouvrage solide et passionnant dont il faut recommander la lecture et l’acquisition par les CDI de nos établissements.