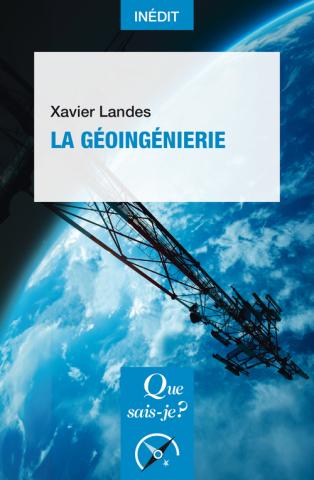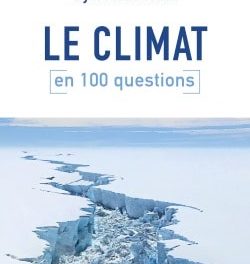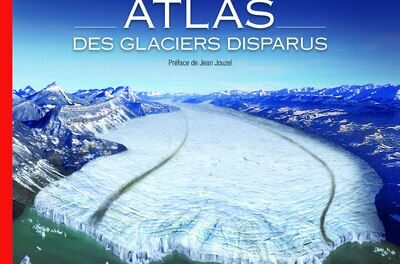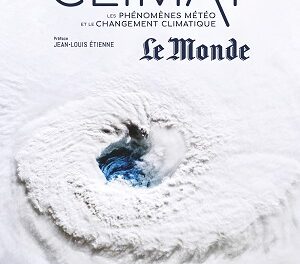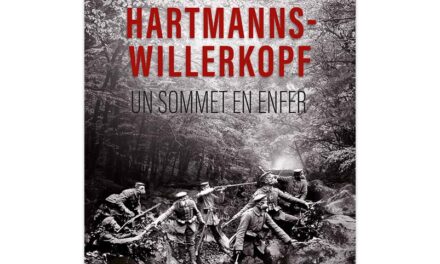A l’heure de l’Anthropocène, face à la hausse de C02 qui ne semble pas forcément contrôlable, des pistes de solutions techniques s’imaginent avec, malgré tout, peu de visibilité dans le débat public et la sphère politique. C’est pour tâcher de pallier ce manque que Xavier Landes, professeur associé à la Stockholm School of Economics de Riga et professeur invité à Sciences Po Lille, a entrepris une synthèse dans la célèbre collection « Que sais-je ? » en cinq chapitres.
Les ingénieries du climat
Le premier chapitre traite des « ingénieries du climat ». Trois critères sont retenus : il faut qu’il y ait intentionnalité de modification, il faut une certaine ampleur des moyens, il faut que l’objectif soit bien celui de la neutralisation du changement climatique (pas forcément revenir à l’ère préindustrielle mais tenter de rester à + 2°, voire + 1,5°). Si l’usage des énergies fossiles n’a pas été choisi dans le but de modifier le climat, son maintien est une décision intentionnelle. Il y a responsabilité juridique et morale.
Le terme « ingénierie du climat » ou « intervention climatique » est préférable à celui de « géoingénierie » qui apparait trop global et trop contrôlant. La démarche prend deux grandes directions : la baisse de la concentration en gaz à effet de serre et le réfléchissement d’une partie du rayonnement solaire.
L’extraction du dioxyde de carbone
Le second chapitre se concentre sur les émissions de CO2, son captage mais aussi sa séquestration. La durée de stockage peut être courte (cas des forêts) ou longues (aquifères profonds). Il faut compter l’énergie fossile nécessaire à l’installation de cette technologie (transport notamment). Ajoutons que le CO2 n’est pas le gaz le plus répandu ni celui qui a le forçage radiatif le plus fort.
Les interventions terrestres peuvent consister à travailler par la foresterie (reforestation, afforestation, interruption de la déforestation). Il y a là une technique mature, vue comme « naturelle » par le grand public, peu coûteuse, préservant la biodiversité et produisant de la biomasse. Mais, en vieillissant, les arbres seront amenés à rejeter du CO2 et donc à produire l’effet inverse recherché. Le potentiel global n’est pas si énorme.
Elles peuvent aussi avoir une action sur les sols : restreindre le labour est une piste mais il faut une pédagogie envers les agriculteurs et ne pas fragiliser les sols. Le biochar (pyrolyse de la biomasse) donne un charbon stable, libérant peu de carbone mais laisse subsister des incertitudes sur la vie organique des sols : il est donc moins intéressant que la restriction du labour.
La météorisation augmentée terrestre permet d’accélérer la désagrégation des silicates (normalement cela prend des millions d’années). Outre la capture, cette technique réduit l’érosion et l’acidité des terres tout en renforçant le rendement. Mais il y a besoin de lourdes infrastructures industrielles et un risque de pollution des sols.
Les interventions marines évoquent, elles aussi, la météorisation marine augmentée : c’est l’équivalent terrestre qui nécessite également des infrastructures portuaires avec un potentiel incertain et un risque de perturbation de la faune et la flore.
La fertilisation des océans agirait comme une pompe biologique avec pour but de stimuler les microorganismes (phytoplancton) qui extraient le CO2 au travers de la photosynthèse. Là aussi : incertitude, coût et action limitée.
Les interventions industrielles tournent autour de la capture et séquestration du carbone. Il est question de filtrer la fumée dès leur origine d’échappement et les stocker quelque part pour un million d’années. La technique est mature mais il y a un risque de prolonger l’industrie fossile en générant un secteur lucratif et, in fine, produire toujours plus de fumée.
Il y a aussi la possibilité de convertir les résidus de l’industrie forestière et des cultures énergétiques pour produire de l’électricité ou de la chaleur : une technologie mature mais qui nécessitera de l’espace pour se développer et qui pourra créer des conflits dans les pays les plus pauvres.
On peut parler aussi de capture directe dans l’air, incertaine et toujours dépendante de la production de carbone.
La mitigation conventionnelle doit être abordée puisqu’elle constitue la possibilité de ne plus libérer de CO2 : conservation de l’énergie (absence d’usage), efficience énergétique (usage moindre pour une même fonction), décarbonation (recours à des sources non fossiles). C’est cela la mitigation conventionnelle.
L’extraction du CO2, c’est la capture du CO2 déjà présent. Des trajectoires a priori identiques peuvent cacher des choix industriels et technologiques très différents. Le coût est à supporter sur plusieurs générations : surtout les générations actuelles ou plutôt celles d’après ? De plus, il faudra des règles juridiques très fortes pour encadrer cela. Un bon tableau, page 47, permet de se repérer dans les différentes options possibles.
La gestion du rayonnement solaire
La gestion du rayonnement solaire stimule l’albédo local ou global. Pour bloquer ou renverser l’accroissement du forçage en restreignant l’énergie solaire entrante, il faut augmenter la réflexivité des surfaces. C’est une technologie d’attente puisque l’on traite le symptôme. Ainsi, enduire les murs de couleur claire aura un impact limité (sur les ilots de chaleur par exemple).
On parle aussi d’introduction de plantes à albédo élevé mais cela apparait controversé en raison d’un risque de déstabilisation des écosystèmes locaux.
Au niveau de la troposphère, on peut évoquer l’éclaircissement des nuages marins à savoir renvoyer des particules (de l’eau de mer) en altitude pour dynamiser la formation des nuages. C’est ici une technique embryonnaire mais qui peut être rapidement stoppée si jamais emballement il y avait. L’amincissement des cirrus dans le but de les faire baisser d’altitude à l’aide de la dispersion de particules (de l’iodure de bismuth a priori non polluant) depuis des avions est également embryonnaire.
Sur la stratosphère, peut-il y avoir dissémination à haute altitude en se plaçant au-dessus des avions commerciaux ? Le coût semble raisonnable, la technologie relativement réversible mais il y a un risque de toxicité des produits injectés et une grande variabilité régionale sans compter la perturbation de la lumière et donc de la photosynthèse. L’image négative aux yeux du grand public empêche les essais sur le terrain.
Dans l’espace, l’idée de mettre en orbite une sorte de voile atténuateur aurait le meilleur effet mais il y a incertitude sur le choix de la bonne altitude et sur les vents qui rendraient l’objet instable sans compter la pollution générée par les fusées chargées d’y aller (à moins de le placer sur la lune ?).
Craintes, risques et incertitudes
La perception globale de ces tentatives est globalement négative. La recherche et la gouvernance sur le sujet sont balbutiantes. Le projet se voit qualifié parfois de « prométhéen », démesuré et désobéissant.
Mais en quoi la foresterie ou l’éclaircissement des surfaces urbaines seraient davantage acceptables que l’urbanisation elle-même ou l’agriculture ?
Le fait est aussi que ces technosolutions pourraient réduire le sentiment d’urgence et les actions à mener à la base (baisse du CO2) ou, au contraire, le fait de voir ces technologies comme anxiogènes permettrait de s’engager dans une mitigation ambitieuse.
Il y a un risque de « pente glissante » et une nécessité de stratégies de sorties lors de points d’étapes bien ciblés si cela était nécessaire.
Sans compter le problème de la dépendance au carbone pour faire fonctionner ces technologies, celui de la dépendance au déploiement et celui du « choc d’interruption » (voir encadré pp 57-58).
Il y a également la crainte d’une capture par les technocrates (peu de régulation juridique pour le moment), la sphère privée dans une optique de rentabilité (notamment via l’accaparement des brevets), la sphère militaire, l’impérialisme (les pays du « Nord ») avec une possible confiscation du débat sur la hausse des températures et des précipitations au détriment des courants marins par exemple qui affectent les pays les plus pauvres.
Les conséquences pourraient-elles être pire que de ne rien faire ?
Justice et gouvernance
La justice peut être vue comme (re)distributive. Les effets sont disparates : comment équilibrer les gagnants et les autres ? Tout est question de proportion et de zones d’action…d’autant que les effets peuvent se faire sentir ailleurs…
A première vue, les pays les moins riches souffriront davantage, outre des conséquences, du fait de leur moindres capacités d’adaptation.
La justice est aussi procédurale : il faut garder un processus démocratique, essayer d’avoir une meilleure représentativité des acteurs (là, les chercheurs du « Nord » dominent) et se renforcer face aux possibles oppositions sociales.
La justice doit être vue comme intergénérationnelle. Les générations futures ne devraient pas à avoir à gérer l’initiation du processus. Les précédentes (finalement les actuelles) se dédouanent de la question.
Enfin sur l’éthique, il y a une sous-estimation de l’importance morale de l’impact humain sur l’environnement. On sous-estime aussi l’utilité économique des services rendus par les écosystèmes (pollinisation par les abeilles par exemple).
La gouvernance est fragile, elle se fait donc « par défaut », elle est menée par les chercheurs mais il manque le concours d’institutions vues comme légitimes.
Conclusion
Ce petit « Que sais-je ? » s’avère une véritable synthèse tout à fait claire sur un sujet qui n’est quasiment jamais abordé dans les écrits récents sur le changement climatique. Il apparait bienvenu sur la scène des productions actuelles sur l’anthropocène. L’auteur présente sans ambiguïté ni parti pris les différentes options. La limite éditoriale de ce format touche aux figures qui sont, à l’exception de quelques tableaux, absentes de l’ouvrage. Charge à nous, géographes, de visualiser tout cela en schémas, cartes et autres représentations qui nous permettront de faire passer la question dans nos enseignements.