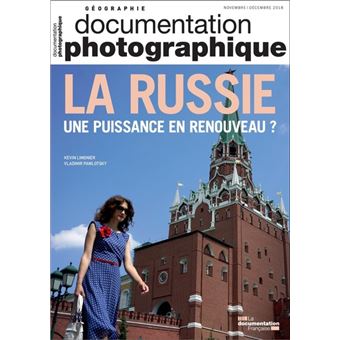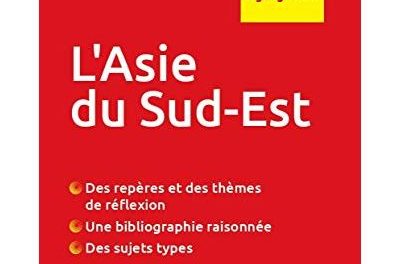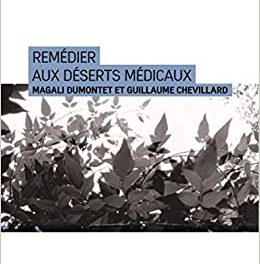Ce numéro de la Documentation photographique vise à faire connaître d’un large public les travaux récents sur la Russie contemporaine. Dès le titre, l’accent est mis sur les questions géopolitiques, comme avec le précédent numéro paru en 2005 (« La Russie entre deux mondes »). Le constat initial est clair : « les espoirs d’un arrimage de la Russie à l’Europe et de l’adoption des règles de la démocratie libérale ont été déçus ». Le « césarisme patriotique » (p. 11) vers lequel évolue le régime russe aujourd’hui a de quoi préoccuper, surtout lorsqu’il confine au nationalisme et à un « conservatisme » qu’on pourrait qualifier d’ultra, compatible avec l’extrême-droite européenne et états-unienne. Quelle est l’étendue de la puissance russe, définie comme sa capacité à agir et à influencer à l’extérieur, mais aussi à contrôler son territoire ? Il serait vain de vouloir résumer une telle synthèse : voici un aperçu, parfois critique, de ses principaux éclairages.
Stabilité économique de la Russie
La stabilité économique est le premier point : la rente des hydrocarbures (pétrole plus que gaz) a permis à l’État russe de sortir le pays de la catastrophe sociale des années 1990, mais en creusant considérablement les inégalités, à des niveaux bien plus élevés qu’en Europe de l’Est et même qu’en Chine voire aux États-Unis (voir les travaux collectifs sur ce sujet par une équipe internationale, dont l’économiste français Thomas Piketty). L’opposition entre Moscou (25% du PIB pour 11% de la population) et le reste du pays est illustrée par le cas des salaires moyens : on gagnerait 73 000 roubles par mois à Moscou (environ 1000 euros) contre 20 000 (250 euros) à Ivanovo. Le tableau de la province profonde, cet « océan de pauvreté » dans lequel surnagent quelques centres urbains extrêmement riches, accrédite l’idée d’une Russie très contrastée. Ici manque une référence aux travaux de la sociologue Carine Clément. Surtout, la prospérité des années 2000 a laissé place à une récession rampante dès 2009 : le sursaut patriotico-nationaliste des années 2010 semble une réponse politique à cette crise, plutôt que la conséquence des sanctions décidées par les démocraties à l’encontre des oligarques proches du Kremlin après l’annexion illégale de la Crimée. Parallèlement, les réussites économiques des années 2000 et 2010 concernent des secteurs limités : nucléaire civil, armement, céréaliculture (une erreur ici : la production du blé en 1990 pour la Russie n’était pas de 119 millions de tonnes mais de la moitié).
Le politique est lié à l’économique de façon particulière en Russie
Le politique est lié à l’économique de façon particulière en Russie. Certes, la seconde guerre de Tchétchénie (1999-2009) et la « verticalisation » du pouvoir (via le contrôle des gouverneurs de régions) ont contribué à la consolidation du pouvoir de Vladimir Poutine. Pour autant, la corruption n’a pas diminué par rapport à l’ère Eltsine, elle a été « recentralisée », et, pourrait-on ajouter, les réseaux de clientèles réorganisés depuis le Kremlin. L’affaire Ioukos est vue à juste titre comme l’« acte de naissance du ‘poutinisme’ », avec sa mobilisation de l’appareil judiciaire au profit du pouvoir, puis le recours aux « institutions de force » (ex-KGB surtout). Une nouvelle étape a suivi l’échec du « printemps russe », à l’hiver 2011-2012, marqué par des manifestations de rue très suivies, mais limitées à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C’est alors qu’a émergé l’opposant Alexeï Navalny, dont le travail de lanceur d’alerte anti-corruption (un phénomène qui touche le sommet de l’État et pas seulement des chefs régionaux ou locaux comme dans le film Leviathan) aurait mérité un plus long développement, à la lumière des travaux de Gilles Favarel-Garrigues. La société civile en Russie, notion dont Françoise Daucé a montré l’ambiguïté, dispose bien d’un « vecteur de contestation » (p. 40) avec l’écologie, mais celui-ci est limité : nombre d’activistes sont harcelé.e.s, victimes de pressions physiques et morales, y compris administratives et judiciaires, dont la législation de 2012 sur les associations bénéficiant de financements étrangers (renforcée en 2019 par une loi qui permet de désigner comme « agents étrangers » des individus, de nationalité russe ou étrangère, travaillant pour des médias extérieurs à la Russie). Quant à la position officielle a priori progressiste en matière de lutte contre le réchauffement climatique, elle est peu suivie d’effets, comme l’a confirmé le rapprochement entre Russie, Etats-Unis, Arabie saoudite et Koweït lors de la COP 24 (2018). On mettra aussi des bémols à l’appréciation du pays comme « très ouvert en matière religieuse », vu les persécutions récentes à l’encontre de minorités comme les Tatars de Crimée au motif de la lutte contre le « terrorisme » ; la promotion d’un « islam pro-Poutine » (p. 36) est par contre une réalité. On peut parler d’« allégeance des élites au parti du pouvoir » (p. 35) pour certaines entités comme la Tchétchénie, vu les soupçons de fraudes électorales, de violations des droits de l’homme et d’assassinats politiques (les journalistes Anna Politkovskaïa et Natalia Estemirova en 2006 et en 2009, l’opposant Boris Nemtsov en 2015) qui pèsent sur ses dirigeants.
La puissance militaire Russe
L’analyse consacrée à la puissance militaire russe met l’accent sur le décalage entre la communication autour des exercices militaires et les provocations à l’égard des pays voisins (« guerre hybride ») et la capacité réelle des forces armées, malgré l’intervention réussie en Syrie depuis 2015, sans oublier la guerre éclair en Géorgie en 2008, au nom de la défense de la minorité ossète, et l’appui décisif des troupes russes aux séparatistes du Donbass depuis 2014. C’est un des traits de la propagande des médias contrôlés par le pouvoir, y compris à l’étranger – le fameux soft power russe : elle renoue avec une forme de militarisme qui rappelle l’héritage stalino-brejnévien. Ici, la force de frappe de Moscou dans la « cyberguerre » est présentée comme relevant d’une exagération de la part de certains États et analystes – pourtant, outre les attaques concrètes relevées contre des administrations et des médias occidentaux, l’action des « fermes à trolls » commence à être étudiée, et le piratage des emails du parti démocrate en 2016 semble avoir été le fait de hackers téléguidés depuis le Kremlin. A propos de relations internationales, la mention de la « promesse faite par l’OTAN de ne pas s’élargir » lors de l’effondrement de l’URSS pose question : il s’agissait de simples échanges de vues entre les présidents Gorbatchev et Bush, puis Clinton et Eltsine, non sans ambiguïté des deux côtés. De même, dire que la guerre civile au Donbass est le résultat de l’hostilité envers Moscou du nouveau gouvernement ukrainien mis en place après la révolution de Maïdan (p. 16) ou que celle-ci a « conduit elle-même […] au rattachement de la Crimée » (p. 54) est simpliste. C’est oublier les deux interventions militaires russes de 2014 et l’instrumentalisation des russophones sur ces territoires, qui inquiète d’autres pays de l’ex-URSS que Moscou continue de façon symptomatique à appeler « l’étranger proche ».
Une remarque s’impose à propos de la bibliographie : plutôt que plusieurs films et romans (genre auquel n’appartient pas l’essai percutant La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch), n’aurait-il pas mieux valu indiquer des films documentaires*, podcasts de radio et webdocumentaires** ? Ils témoignent de la capacité de la société à réagir, y compris hors des grands médias, face aux formes parfois brutales de la puissance de l’État.
* On pense à celui de Manon Loizeau, Tchétchénie, une guerre sans traces (2014) et à celui de Bryan Fogel Icarus (2017) sur le système du dopage en Russie, ou encore, en Russie, à ceux de Konstantin Davydkin et Maria Muskevich Volunteers. Playing with Fire (2015, sur la lutte contre les incendies de forêts menée par des volontaires de Greenpeace) et Grassroots (2018) sur les mobilisations environnementales en Russie.
** Par exemple The Sochi Project d’Arnold van Bruggen et Rob Hornstra (2014), http://www.thesochiproject.org