Nous connaissions déjà Béatrix Pau, 
Notre collègue revient sur cette période en dépassant le stade de la monographie pour choisir un thème résolument original et largement inédit, celui de la « démobilisation des corps ». Comment, deux ou trois années après la fin des combats, des familles mais aussi les services de l’État civil des armées ont-ils pu organiser cette grande « migration funèbre» permettant cette translation des sépultures sans aucun précédent dans l’histoire ?

C’est à une histoire singulière que nous convie Béatrix, celle de la « gestion de la mort », qui devient à la fois une affaire d’État, plutôt une affaire de l’État, mais en même temps qui nous amène à rentrer dans l’intimité de centaines de milliers de familles éprouvées.
Pour ces hommes et femmes du début du XXe siècle, cette mort au combat, ou des suites de blessures dans un hôpital de campagne apparaît comme une rupture fondamentale dans leur conception du décès d’un être cher et de ce qui l’entoure. Les rites mortuaires sont ainsi remis en cause, brutalement. L’annonce de la mort commence par un courrier lapidaire dont sont exclus les lieux et les circonstances, l’incertitude parfois lorsqu’une disparition est mentionnée, et en tout état de cause, l’absence du corps qui empêche de commencer ce que l’on appelle aujourd’hui « le travail de deuil ».
La mort génère des rites, des gestes culturels et cultuels qui permettent aux vivants de se séparer des défunts, tout en perpétuant leur mémoire. Le deuil se déroule en quatre temps, l’oblation dont le rite majeur est la toilette mortuaire, la séparation, les rites d’intégration et enfin la commémoration, dont le premier temps est celui du banquet funéraire.
La mort de masse, 500 tués par jour à Verdun pendant plus de 10 mois, la destruction des corps par les armes modernes, rendent impossible l’organisation de ces quatre temps du deuil. Les corps déchiquetés, inhumés à proximité du champ de bataille, sous quelques pelletées de terre, les bouleversements de sépultures, les corps entassés, du moins au début dans des fosses communes, tout cela vient se rajouter à la douleur des familles qui prennent de plein fouet le choc de ces disparitions.
Comme on le sait les décès ont été particulièrement nombreux pendant les premiers mois de la guerre, et très vite, les armées ont pris des dispositions, édicté des règlements, pour gérer la mort. Ces mesures réglementaires se heurtent au désir de ces familles qui, privées de leurs rituels traditionnels, souhaite à tout le moins que le disparu puisse reposer dans le caveau familial. À ces pieux désirs, s’oppose le principe de réalité, celui de l’identification de corps broyés, les questions d’effectifs pour procéder aux exhumations, les préoccupations sanitaires, les difficultés d’approvisionnement en bois et en métal pour confectionner les cercueils.
Le travail de Béatrix Pau est très largement dépendant de ses sources qui sont, pour des raisons de proximité géographique, d’origine méridionales, d’une zone éloignée des combats, ce qui complique évidemment la tâche des familles qui souhaitent se réapproprier le fils, le mari, dont elles ont fait don à la patrie. Les services de l’État leur attribuent d’ailleurs, assez rapidement, la gratuité de leur transport, en troisième classe vers le lieu où se trouve la sépulture provisoire. Lorsque celle-ci se trouve en zone militaire, le général Joffre a d’ailleurs interdit toute exhumation des corps, à la fois pour des raisons sanitaires et logistiques, mais aussi pour éviter aux soldats restés vivants de voir trop souvent passer, avant de monter au front, des convois funéraires.
Cacher les morts
Pendant cette guerre que l’on s’obstine à croire courte, l’argument des autorités civiles et militaires et de considérer qu’il faudra attendre la fin des hostilités pour que les familles puissent récupérer les corps. Le grand quartier général se prépara accordé, après-guerre cette restitution des corps, même s’il sait, d’ores et déjà, qu’il fera tout pour en dissuader les familles. Lorsque les autorités civiles sont saisies de demandes d’exhumation, les réponses sont parfois évasives et renvoient vers « la levée du veto de l’autorité militaire ».
Pour les familles qui peuvent, pendant la guerre, ou très peu de temps après, parvenir à récupérer les dépouilles de leurs proches, la dépense n’a rien d’anodin surtout lorsque les distances entre la sépulture provisoire et le caveau familial sont importantes. La location d’un véhicule, le transport ferroviaire, l’hébergement sur place pendant l’exhumation, tout cela représente pour les familles de lourdes dépenses. Les ménages les plus modestes ne peuvent y consentir, et bien souvent, notamment après la guerre, lorsqu’elles ont pu avoir la certitude du lieu précis d’inhumation, elles doivent recourir aux services d’associations comme le souvenir français, ou de simples particuliers, pour que la tombe soit entretenue.
L’absence du corps entraîne le développement de rituels de substitution, comme la présence, dans la salle à manger familiale du portrait du défunt, le plus souvent en uniforme. Ses décorations, ses brevets militaires, les objets d’artisanat des tranchées, quelques carnets, deviennent alors de véritables reliques que l’on se transmet de génération en génération. La mission du centenaire a permis de rassembler des centaines de milliers de documents de ce type.
Le disparu devient alors une sorte d’icône qui permet au cercle de famille, mais aussi aux proches et aux amis qui y sont admis, de rappeler l’étendue du sacrifice qui a été consenti.
Mais la mort, les obsèques, peuvent aussi devenir des affaires d’État, y compris en temps de guerre, et dans le cas que Béatrix rappelle, en contradiction flagrante avec l’ interdiction absolue d’exhumer et de transporter des corps dans la zone des armées, mesures prises en novembre 1914. Parmi les victimes des premiers mois de guerre, on trouve aussi des volontaires italiens, –le pays a proclamé sa neutralité au début des hostilités –, que l’on appelle les Garibaldiens.
Les garibaldiens en Argonne
Ces combattants ont pu resurgir de l’anonymat à l’occasion de l’hommage rendu par la France à son dernier poilu, Lazare Ponticelli qui a servi au début de la guerre dans cette unité de la légion étrangère. Parmi ces soldats, engagés sur le front de l’Argonne, deux des petits-fils de Giuseppe Garibaldi, Bruno et Constante, morts au combat, respectivement le 26 décembre 1914 et le 5 décembre 1915. Pour des raisons diplomatiques, liée à l’action des services français, agissant pour que l’Italie entre en guerre aux côtés des alliés, la mesure d’interdiction absolue d’exhumation des corps est levée, les dépouilles sont transportées de l’autre côté des Alpes et les 6 et 12 janvier 19115 Bruno et Constante sont enterrées à Rome, après un hommage national. Les plus hautes autorités civiles ont adressé leurs condoléances officielles au gouvernement italien et une large publicité a pu être mise en œuvre autour de ces deux victimes, rappelant ainsi les liens étroits, entre les deux sœurs latines qui se retrouvent côte à côte dans les combats à partir de mars 1915.
De l’interdiction à la restitution
Pendant la guerre des cimetières militaires avaient été réalisés, souvent dans les zones de combat, avec des sépultures, parfois isolées, parfois regroupées.
À la fin de l’année 1918 projet de loi proroge l’interdiction de transporter, par voie ferrée ou par route des corps de militaires ou marins français, alliés ou ennemis, tuer l’ennemi décédé au cours de la guerre, pendant une période de trois années à compter du 1er janvier 1919. Ce projet encourage la poursuite du nettoyage des champs de bataille et la création ou le réaménagement des cimetières militaires. Les sépultures du temps de guerre subissent en effet les épreuves du temps, elles sont souvent détruites lorsque les travaux agricoles peuvent reprendre, les sangliers dispersent les ossements, et les procédés d’identification, comme les plaques militaires, les cocardes, les bouteilles avec des papiers portant l’identité du défunt, finissent par disparaître. Au terme de vifs débats, qui oppose notamment Paul Doumer et Louis Barthou, le principe de l’égalité devant la mort est ainsi réaffirmé. Parmi les arguments qui sont avancés, Paul Doumer mentionne l’action d’entrepreneurs peu scrupuleux qui réclament des sommes considérables aux familles qui souhaitent le retour de leurs défunts dans les caveaux familiaux. Le général de Castelnau qui a d’ailleurs perdu trois de ses fils au combat tient à ce que la fraternité d’armes se perpétue post-mortem et que les victimes reposent ensemble sur les lieux de leur sacrifice.
L’argument économique pèse également dans cette mesure d’interdiction, en considérant que la charge pour l’État serait trop élevée et que la priorité doit être donnée à la reconstruction du pays.
Des violations de sépultures au ballet mortuaire
Dans le chapitre cinq de son ouvrage Béatrix montre que les familles, insensibles à ces arguments, vont pour beaucoup d’entre elles se livrer, pendant la période 1919 – 1920, à des opérations clandestines d’exhumation. De véritables « entrepreneurs de la mort », se mettent au service des familles pour leur restituer, moyennant finances, les restes de leurs disparus. Ces actes sont parfois commis au mépris de toutes les règles d’hygiène, notamment pour des morts, victimes de maladies contagieuses, et dans les corps ne pouvaient être exhumés avant un délai de trois ans.
Si les pratiques de ces mercantis sont condamnées par l’opinion publique, les exhumations clandestines sont souvent pratiquées avec l’approbation tacite des populations locales qui se gardent bien de prévenir les autorités. Ces exhumations clandestines sont commises aussi bien dans les cimetières communaux ou des militaires ont été enterrés que dans les cimetières militaires eux-mêmes, le plus souvent laissé sans aucune surveillance. Les personnes qui se livrent à ces pratiques encourent pourtant les rigueurs de la loi, et notamment l’article 360 du code pénal qui punit quiconque est reconnu coupable de violation de tombeau ou de sépulture. Dans l’exemple qui est cité, le tribunal de Brest condamne une mère versée 200 Fr. d’amende pour avoir exhumé et transporté clandestinement le corps de son fils.
Au-delà de ces initiatives individuelles mais dans le nombre apparaît significatif, un mouvement d’opinion se fait jour, dès la fin de l’année 1919, en faveur de la restitution. Plusieurs députés interviennent, sans doute sous la pression de leurs administrés, en faveur de ce mouvement.
Parmi les questions qui sont également évoquées, se pose également le problème des soldats alliés, notamment américains, le gouvernement de Wilson ayant fait la promesse publique que tous les corps seraient rapatriés à la demande des familles. Cela représente un effectif de 6000 victimes, mais cela apparaît comme choquant pour une partie de l’opinion publique française qui constate une inégalité de traitement.
C’est la raison pour laquelle, bien avant la fin du délai de trois ans après l’armistice, en novembre 1921, la loi de finances du 31 juillet 1920, accorde par l’article 36, aux familles qui en feront la demande, le droit de transférer, aux frais de l’État, la dépouille de leur mort. Cette proposition de loi est approuvée par André Maginot, ministre des pensions, en charge du service de sépulture, ainsi que par le ministre des travaux publics. Un crédit de 10 millions de francs et votés pour assurer le transport des corps, tandis que le service de l’État civil de l’organisation des sépultures militaires obtient un crédit de 60 millions. Le transfert des corps prévoit les opérations d’exhumation, la mise en bière hermétique, et la réinhumation ainsi que le transport collectif. Seuls les militaires inhumés dans les cimetières de guerre obtiennent la concession perpétuelle.
Cette mesure qui apparaît comme égalitaire démocratique connaît quand même quelques limitent, la possibilité d’exprimer une demande de restitution exclut les collatéraux, frères et sœurs, et autres parents, en étant strictement réservée aux veuves, ascendants et descendants.
Des souvenirs s’effacent
À partir de la fin de l’année 1920, la France connaît un véritable ballet mortuaire, dont Béatrix Pau évoque plusieurs cas, notamment l’organisation du retour au pays, la mise en place d’un culte local pour les défunts morts au combat, même si avec cette restitution, le soldat est redevenu un civil, qui repose pour l’éternité aux côtés des siens. Peu à peu, sur les caveaux familiaux, les photographies pâlissent, et ces fiers guerriers retombent dans l’anonymat. En réalité, sur le monument aux morts de la plupart des communes de France, leurs noms restent gravés pour l’éternité, et le souvenir de ce sacrifice collectif se substitue peu à peu à la tragédie familiale. Le portrait du grand-père, de l’arrière-grand-père, rejoint le grenier, se retrouve parfois dans une brocante, tandis que les décorations et autres carnets se retrouvent enfouis dans ces boîtes de souvenirs dont on finit par oublier l’existence.
Reste l’évocation de ces corps, meurtris, déchiquetés, parfois objets de querelles familiales favorisant des haines inexpiables, et des services de l’État qui ont dû, dans ces années de l’après-guerre, « gérer des morts », pour répondre aux besoins de catharsis des vivants.
Au-delà de la description rigoureuse de ce processus, Béatrix Pau nous raconte une belle leçon de vie. Rien d’épique pourtant dans ce récit, et pourtant l’évocation de cette humanité meurtrie par la disparition de ses forces vives fauchées en pleine jeunesse délivre quelque part un message optimiste.



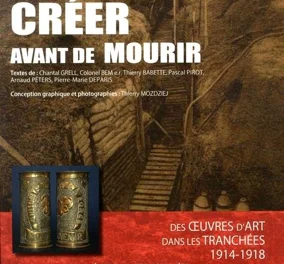

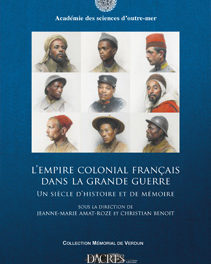










Bonjour.
Merci pour la somme d’information.
Munier Jean Claude, Président de l’association REF55, les radioamateurs de la Meuse.
Nous avons commémoré le Centenaire de 14/18 sur le secteur de Verdun 55100.
Vous pouvez voir sur notre site: ref55.r-e-f.org nos différentes activations de mémoire cités à la radio.
Pour ce 11 novembre 2020, se sera notre 100ème activation.
Une curiosité lors de notre première activation au château Raymond Poincaré à Sampigny la visite d’un pigeon voyageur faire du morse sur un clavier d’ordinateur sur You tube: ref55cw
Je vais consulter le livre: A l’Est la guerre sans fin.
Car il y a eu des suites après le 11 novembre, si vous avez des orientation, merci de m’en faire prendre connaissance.
Bonne fin de journée.
Jean Claude