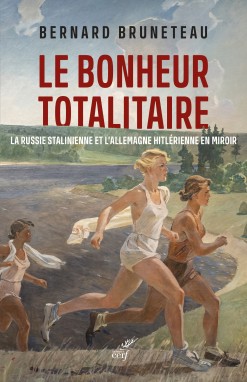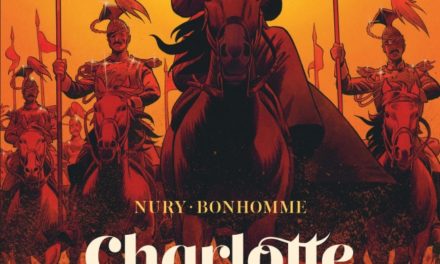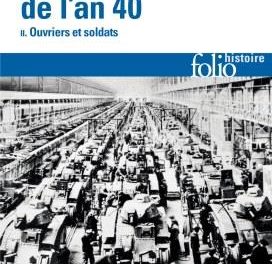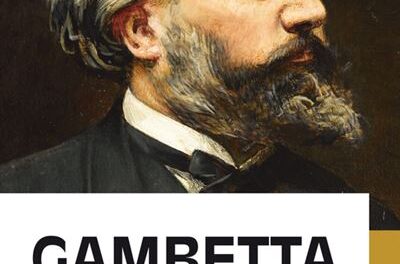Comment associer terreur et bonheur ? Bernard BruneteauHistorien des idées, professeur émérite de science politique à l’université de Rennes-I, Bernard Bruneteau est spécialiste des totalitarismes et a publié notamment Les totalitarismes (A. Colin, 2014), Génocides- Usages et mésusages d’un concept (CNRS, 2019) et L’Âge totalitaire – Idées reçues sur le totalitarisme (Le Cavalier Bleu, 2017). s’intéresse dans cet ouvrage à « l’injonction du bonheur comme technique disciplinaire » et non plus uniquement à l’étude du totalitarisme par le seul prisme de la terreur, comme l’ont fait de très nombreux historiens (notamment depuis l’incontournable « Origines du totalitarisme » d’H. Arendt). Si les régimes totalitaires sont indissociables de l’usage de la terreur, ils ne peuvent toutefois exister sans la mobilisation « d’une large base sociale éprise de reconnaissance », chez qui la promesse de l’appartenance à une communauté égalitaire (la « Volksgemeinschaft » en Allemagne), d’une mission modernisatrice, de sécurité et de protection a suscité une forte adhésion. L’auteur rassemble dans cette étude le régime stalinien et le Troisième Reich qui professent tous deux une vision du monde eschatologique, face à des sociétés en quête de sens et de retour à l’ordre.
Promettre – dans l’attente du Millenium
Sont ici rassemblées les deux idéologies dans leur rapport à la modernité démocratique libérale « qui promet depuis le XIXe s. une égalité des conditions« . Leur critique de cette dernière diffère mais on y retrouve une même affirmation de religion politique, promettant aux masses un avenir assuré et forcément meilleur. L’auteur convoque aussi bien Hannah Arendt que John Meynard Keynes ou encore Raymond Aron dans cette explication (Keynes voyant « en Lénine un autre Mahomet« ) où les références communes à la religion abondent en effet (cérémonies et rites, idolâtrie de l’Etat incarné dans un Chef infaillible et tout-puissant, rédemption, purification…). A l’instar des religions, les idéologies des régimes totalitaires veulent « donner aux hommes une clé de compréhension de l’histoire, du temps présent et de l’avenir en prescrivant un remède définitif au mal qui ronge la société« . Paradoxalement, leurs adeptes se réclament de projets laïques voire antireligieux et font parfois revivre le paganisme (dans le cas du nationalisme) au service d’un « mythe de la régénération« . L’homme moderne sera chargé de rebâtir sur les ruines de l’ancien monde (la Première Guerre mondiale jouant un rôle majeur dans cet effondrement), accomplissant ainsi une prophétie millénariste. Bernard Bruneteau distingue cependant la nostalgie du paradis perdu (inhérente au nazisme) du paradis futur promis par le communisme. Les nombreuses recherches menées par l’auteur vont puiser aux sources idéologiques des régimes totalitaires (philosophes de la fin du XIXè et du début du XXè siècles, historiens contemporains des événements ou plus récents) afin d’étayer cette comparaison entre nazisme et communisme. Age d’or passé ou futur sont ainsi les deux faces des idéaux millénaristes à l’oeuvre dans l’Entre-Deux-Guerres mais reposant sur des socles plus anciens datant principalement du XIXe siècle (nationalisme völkisch et figure emblématique de Wagner pour les nazis, marxisme pour les communistes). Selon Bernard Bruneteau, quatre grands moments structurent ces récits : « révélation du mal (aliénation capitaliste/chaos racial), dualisme eschatologique (classe ou race élue / ennemi éternel, capitaliste ou Juif), transition apocalyptique (guerre impérialiste, révolution libératrice / délitement de la nation, messie sauveur), millénium imminent (société communiste sans classe et sans Etat / communauté du peuple égalitaire et fraternelle) « . Etonnamment, le rejet de la modernité et la vénération du passé (forcément glorieux) s’accompagnent d’une fascination pour certaines formes de modernismes (industrialisation, nouvelles techniques) et l’idée d’une nouvelle civilisation à bâtir par les tenants du nazisme comme du communisme.
Promouvoir – les bénéficiaires du totalitarisme en acte
« L’inclusion est allée de pair avec l’exclusion » : la persécution de groupes d’individus s’est accompagnée de la mobilisation consciente d’une partie de la population, dans le communisme comme dans le nazisme, à qui de nouvelles opportunités ont été offertes. L’historienne autrichienne Lucie Vargas (Rosa Stern) identifie dès 1937 trois piliers du régime nazi (transposables au communisme selon Bernard Bruneteau) : le « noyau des premiers fanatiques, casés puis relativement marginalisés dans l’administration et le parti » ; le « cercle des nouveaux fanatiques promus par les organisations satellites » et enfin « les spécialistes« , à qui le régime « confie les tâches d’organisation » (L. Vargas, « La genèse du national-socialisme. Notes d’histoire sociale », Annales d’histoire économique et sociale, nov. 1937). L’auteur identifie ces derniers comme « une nouvelle classe » qui saisit sa chance d’obtenir du régime une ascension sociale et des avantages (notamment matériels mais également symboliques), et ce aussi bien en URSS que sous le Troisième Reich. La promotion éclair d’un Nikolaï Iejov (ouvrier à 11 ans, devenu chef du NKVD en 1937 après une « carrière météoritique » puis exécuté en 1940 sur ordre de Staline) n’est toutefois pas représentative du destin de la vague de promus des années 1930 et « l’enracinement du pouvoir bolchévique ne s’explique pas seulement par la machine totalitaire terroriste mais par la création d’une nouvelle classe de bénéficiaires voyant dans le régime stalinien son propre Etat » (Merle Fainsod, Smolensk à l’heure de Staline, Fayard, 1967).
L’explosion des effectifs du NSDAP (de 130 000 membres en 1929 à 5,4 millions en 1939) suit la même logique. L’embauche en grand nombre de fonctionnaires et de cadres territoriaux pour encadrer les différents organismes nouvellement créés (aide sociale, organisations de jeunesse, service du travail etc…) est une immense opportunité pour « les petits employés du privé ou petits fonctionnaires publics« , qui adhèrent en masse au parti nazi dès 1933. Autre personnage central de la propagande totalitaire : l’ingénieur, idéalisé et capable de réaliser l’impossible (avec des machines dignes d’un scénario de science-fiction). La seule différence réside dans la très faible proportion d’ingénieurs qualifiés dont dispose l’URSS à ses débuts, contrairement à l’Allemagne qui a connu une très forte et précoce industrialisation. Il faut donc former massivement cette nouvelle élite, celle qui mettra en œuvre les fameux « plans ». Leonid Brejnev, pour ne citer que lui, débute sa carrière comme ouvrier métallurgiste avant de devenir ingénieur en 1935 grâce à la formation proposée par le régime. C’est cette génération qui occupe les postes stratégiques trente ans plus tard, après avoir profité de la discrimination positive et aussi des grandes purges. Tous ne connaissent pas un sort aussi heureux (Andreï Tupolev a conçu ses avions, rappelle Bernard Bruneteau, dans un bureau d’études-prison). La même place d’honneur est accordée aux ingénieurs du Troisième Reich, en majorité plutôt favorables au nouveau régime et à la modernité qu’il propose. Des « martyrs » du putsch de 1923 aux plus grands noms de l’industrie des années 1930 (Ferdinand Porsche ou Werner von Braun pour ne citer qu’eux), ils sont 266 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et le régime les « voit comme l’un des instruments majeurs de la cohésion du Volk au moment où est lancé, en 1936, le Plan de quatre ans préparatoire à la guerre« .
En comparaison, les ouvriers, censés être au cœur de l’appareil soviétique, ne sont que des « bénéficiaires relatifs« . L’immense effort d’industrialisation a entraîné une augmentation gigantesque des effectifs (20 millions en 1940) mais les conditions de vie et de travail sont mauvaises voire catastrophiques et entraînent parfois des mouvements de résistance (ouverte comme lors de la grève dans les usines textiles de la région d’Ivanovo en 1932, ou passive par négligence volontaire, absentéisme…). Toutefois, la promotion d’ouvriers « plus égaux que d’autres » car mieux placés dans la hiérarchie sociale est un fondement du pouvoir stalinien. Les « travailleurs de choc » (udarniki) des grands ensembles industriels comme Magnitogorsk bénéficient même de privilèges non négligeables (gratifications symboliques, meilleure alimentation malgré le rationnement…) et annoncent l’avènement du stakhanovisme à partir de 1935. En Allemagne, la classe ouvrière n’est tout d’abord pas un pilier du régime nazi. La répression de toutes les organisations et syndicats communistes permet d’encadrer plus étroitement les ouvriers, au moment où le Reich a besoin de mobiliser une très importante main d’oeuvre pour ses grands travaux. La durée de la journée de travail excède souvent les huit heures autrefois réglementaires et la pression fiscale s’accentue. Toutefois, il ne faut pas, selon Bernard Bruneteau, négliger les efforts faits par le Troisième Reich pour faire adhérer la classe ouvrière aux valeurs du régime (voir l’ouvrage de David Schoenbaum, Hitler’s Social Revolution, 1966) : la « bataille du travail » permet de résorber totalement le chômage en 1937, le « concours de l’entreprise modèle » en 1936 incite les propriétaires d’usines à améliorer le confort de leurs ouvriers au quotidien (meilleur éclairage, cantines, douches, terrains de sport, jardins fleuris…). L’organisation Kraft durch Freude ouvre à la classe ouvrière des loisirs jusqu’alors « bourgeois » : voyages touristiques, activités sportives et même croisières! « Bénéficiaire net du régime en 1939, le ‘soldat du travail’ pouvait donc se transformer en soldat tout court » conclut Bernard Bruneteau.
Les deux autres catégories mises en avant par les régimes totalitaires sont la jeunesse et les femmes. La première est essentielle à l’idéologie totalitaire et à la construction du monde nouveau. Dès octobre 1918, le « Komsomol » rassemble quelques dizaines de milliers de jeunes entre 14 et 23 ans. Ils sont 6 millions en 1932, et puisent largement chez les « Jeunes Pionniers » (10-14 ans) fondés en 1924. Au début des années 1930, les attributions de l’organisation sont multiples (participer aux travaux des champs dans le cadre des kolkhozes, lutter contre l’analphabétisme, organiser des compétitions sportives…) et visent à encadrer la population et diffuser l’idéologie marxiste-léniniste. L’autonomie et la reconnaissance qui leur sont accordées donnent des ailes à ces jeunes idéalistes, dorénavant pris au sérieux par les adultes. Ce modèle est admiré par certains Allemands, dont Klaus Mehnert, germano-russe né en 1906, membre de l’aile gauche du parti nazi et se considérant comme « national-bolchévique », auteur du livre-enquête La jeunesse en Russie soviétique en 1932. Cette même année, la Hitler Jugend encore balbutiante ne réunit « que » cent mille jeunes, mais elle voit ses effectifs exploser les années suivantes (jusqu’à 8,7 millions en 1939, date à laquelle elle devient obligatoire). Elle prend le pas sur les autres groupes préexistants (confessionnels ou politiques) et rencontre aussi le succès auprès de la jeunesse car elle prône l’autonomie, le courage physique, l’anti-intellectualisme mais aussi la mixité (900 jeunes filles du BDM tombèrent enceintes lors du congrès de Nuremberg de 1936 !). De très jeunes gens accèdent à des responsabilités à l’échelle locale, voire régionale (plus rarement nationale) et pour ces petits chefs d’équipe issus – pour la moitié d’entre eux – des classes populaires, la reconnaissance et le prestige sont d’importants aiguillons. Enfin, les femmes font l’objet d’un « apparent chassé-croisé idéologique » en Allemagne et en URSS. L’émancipation révolutionnaire dans cette dernière à partir de 1917 (droit de vote, mariage civil et divorce par consentement mutuel en 1918, instauration du 8 mars comme journée internationale de la femme en 1921, droit à l’avortement en 1920 et à la contraception en 1923) est brutalement interrompue par la réaction stalinienne des années 1930 et la femme rétablie dans son statut de mère au foyer réduite au silence : le divorce devient plus contraignant, l’avortement est interdit en 1936, le respect de la famille et par extension du Parti comme grande famille (avec Staline comme père de famille suprême) est mis en avant. Toutefois, ces dernières lois répondent aussi aux aspirations de nombreuses ouvrières et paysannes, qui souhaitent entre autres que les hommes prennent le mariage davantage au sérieux et que le montant des pensions alimentaires soit augmenté. La multiplication des divorces et la chute du taux de natalité sont également problématiques pour l’Etat, qui doit dans le même temps recruter massivement des ouvriers pour répondre à ses besoins de modernisation. Il ne s’agit toutefois pas d’un total retour en arrière dans la mesure où les femmes entrent massivement dans l’industrie et les services (42% de la population active en 1937) et peuvent faire carrière même si l’égalité homme-femme prônée par le régime n’est pas entièrement effective. Les cas de promotion sont abondement utilisés par la propagande (l’actrice Ladynina ou encore la sculptrice Vera Moukhina, chargée de réaliser l’immense statue du couple ouvrier-kolkhozienne pour le pavillon soviétique de l’exposition universelle de Paris en 1937). Le sport, l’aéronautique (le vol de 24h non stop entre Moscou et l’Extrême-Orient par Marina Raskova en 1938) et plus encore la guerre (800 000 femmes se portent volontaires pour le front à partir de l’été 1941) montrent l’évolution du rôle de la femme en Union soviétique. A l’inverse, la femme allemande a longtemps été vue comme une victime ayant subi le régime nazi « à la mysoginie fondamentale » (Rita Thalmann, Être femme sous le IIIe Reich, 1981). A partir des années 1980, les recherches historiographiques montrent pourtant que « l’immense majorité des femmes allemandes exprimèrent le désir de participer au régime, qu’elles travaillèrent dans ses structures volontairement et en conscience » (12 millions de femmes dans les diverses organisations du Troisième Reich en 1939). L’aide aux femmes seules, la formation en économie domestique, l’instauration d’un jour férié pour la Fête des mères ne sont pas les seuls avantages proposés. Intégrer les structures nazies du BDM (Bund Deutscher Mädel : Ligue des jeunes filles allemandes de 10 à 18 ans, soit 4 millions d’adolescentes), de la NS-Frauenschaft (2 millions de membres) ou de la section féminine du Front du Travail (qui supervise 7 millions de femmes salariées) offre des perspectives de promotion et de visibilité. Les besoins croissants en main d’œuvre font également davantage entrer les femmes dans l’industrie (de 1,2 million en 1933 à 1,85 million en 1939) et le tertiaire (y compris dans la répression avec la Gestapo ou dans la mise en œuvre des politiques eugénistes d’hygiène raciale et d’euthanasie).
Protéger – un Welfare totalitaire ?
Le peu d’efficacité des démocraties libérales face à la crise des années 1930 fait paraître aux yeux des contemporains les régimes totalitaires comme « promoteurs d’une attention sociale susceptible de favoriser une conscience communautaire« . L’historiographie actuelle est divisée sur ce thème et la « dictature au service du peuple » brillamment présentée par Götz Aly (Comment Hitler a acheté les Allemands, 2005) a été critiquée. Bernard Bruneteau justifie la comparaison entre les deux régimes car « le totalitarisme, quelle qu’en soit la version, doit inscrire à son agenda politique des formes d’intervention étatiques prenant en charge des fonctions de solidarité entre les individus ‘égaux’, c’est-à-dire ceux de bonne origine sociale ou raciale« .
Une communauté imaginée, débarrassée des individus ne correspondant pas au modèle communiste ou nazi, doit pouvoir s’épanouir une fois le régime installé. Le Peuple d’URSS peut donc profiter d’une « vie meilleure » dans les années 1930, à l’image du film « Le Bonheur » d’Alexandre Medvekhine (1935) décrivant « le cheminement d’un moujik vers le bonheur collectif en transposant le dramatique épisode de la collectivisation dans un univers irréel de conte populaire« . L’Exposition agricole de 1939 à Moscou met en scène les réussites soviétiques, n’hésitant pas à instrumentaliser l’intégration des différentes nationalités (à condition qu’elles « servent la construction du socialisme« ), se posant ainsi en chantre de l’antiracisme. La communauté juive est dans un premier temps plutôt favorable aux bolcheviks car bénéficie d’opportunités de promotion sociale jusqu’alors impossibles (la situation changera ensuite). Dans les textes, l’Etat social soviétique est extrêmement novateur (la Constitution de 1936 accorde le droit au travail et au repos, les assurance vieillesse, maladie et chômage, ainsi que le droit à l’instruction). Dans les faits, cela profite à une partie seulement de la population (les fameux promus des années 1930) et contribue à exclure davantage les catégories sociales les plus faibles, mais « la réalité perçue l’emporte sur la réalité réelle ». L’enthousiasme de la société allemande pour le nouveau régime porteur de promesses est également noté par les contemporains (y compris Lloyd George, lors de son voyage en Allemagne en 1936) mais ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’historiographie commence à l’admettre (comme pour le rôle actif des femmes dans le nazisme). La « Communauté du peuple » (Volksgemeinschaft) « s’inscrit dans la réalité par des pratiques sociales qui incitent à participer au régime et qui donc, in fine, poussent à accepter un système d’inclusion et d’exclusion ». Les fêtes et cérémonies dont raffolent les régimes totalitaires ont également pour but de souder la communauté, grand-messes dont le public est à la fois spectateur et acteur (par les chants, incantations et slogans). Le langage lui-même est porteur de cohésion, comme l’a analysé Victor Klemperer (LTI- la langue du IIIe Reich, 1946), notamment par l’emploi massif des termes « socialisme », « travailleur » ou « soldat ». « Le but de ces diverses politiques est de modifier non pas tant les inégalités sociales ou culturelles effectives que l’image que l’individu se fait de lui-même et de sa place dans la société », conclut Bernard Bruneteau.
En « récompense », celui qui s’intègre dans ce cadre idéal se voit offrir une multitude d’insignes et de gratifications (170 millions d’insignes sont produits durant l’année 1938-39 en Allemagne !) même si « le concept de ‘société de consommation’ est à priori antagoniste du projet totalitaire ». Pénurie et rationnement en URSS font mauvais ménage avec la vision de la société idéale projetée par la propagande et pour lutter contre la spéculation, le Second Plan (1933-37) « multiplie par trois les investissements consacrés au secteur des biens de consommation ». Mais cette fois encore, c’est au bénéfice de la nouvelle classe de promus, en gratification pour leur loyauté ! Pourtant, cela n’était pas forcément vécu comme inégalité criante et pouvait même symboliser l’avant-garde de ce que serait la société idéale pour tous. L’Allemagne nazie qui veut financer « les canons et le beurre » admire ouvertement le modèle américain (Deuxième Livre d’Hitler, manuscrit écrit en 1928, suite non publiée de Mein Kampf), dont elle développe les deux produits-phares : la voiture (Volkswagen) et la radio (Volksempfänger) à grand renfort de publicité. La radio devient le moyen de diffusion massive de la propagande (quasiment toutes les familles possèdent un poste à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, contre 4 millions de postes pour 66 millions d’habitants en 1933). La Coccinelle connaît un succès bien moindre puisque l’usine inachevée au moment de la guerre est reconvertie pour la production d’armement et aucune voiture n’a pu être livrée aux 270 000 souscripteurs (à 95% issus des classes moyennes, les ouvriers ne pouvant payer le crédit de 5 RM par semaine).
Le dernier aspect du chapitre revient sur la joie totalitaire (en partie évoquée plus haut), abondamment relatée par les journalistes et voyageurs qui visitent les deux régions. Le tourisme et le sport se développent (pas question de bronzer idiot) : camps modèles d’alpinisme en URSS (ouverts, ici encore, essentiellement aux jeunes cadres promus du régime), tourisme allemand mémoriel (sur les traces du Führer) ou plus classique (y compris hors des frontières, principalement en Italie et au Danemark et même…en URSS !). Massif et à destination des classes populaires, le tourisme strictement encadré de la KDF (Kraft durch Freude) connaît également un grand succès (45 millions de séjours organisés entre 1933 et 1939) mais les chercheurs ont montré que ce sont une fois encore les classes moyennes qui ont le plus profité des croisières, soirées et concerts proposés. Cette joie partagée (Freude) permet également le renforcement de la Volksgemeinschaft. La station balnéaire construite sur l’île de Rügen à partir de 1936, devait être la plus grande du monde (20 000 plaisanciers) à des prix imbattables, pour faire bénéficier davantage les ouvriers de loisirs autrefois bourgeois, mais la guerre interrompt le chantier. Les autres loisirs comme le cinéma sont également primordiaux et les populations des deux régimes plébiscitent les comédies musicales (dont les chiffres d’entrées battent des records au détriment des films de propagande !) et les films sentimentaux, symboles peut-être encore de cette « joie totalitaire » même si ce type de cinéma a « une évidente fonction de camouflage politique« .
Fasciner – les horizons de l’utopie
Les régimes totalitaires « se légitiment par le mouvement et la révolution permanente », contre toute « routinisation mortifère », et programment ce que Bernard Bruneteau nomme « un activisme prométhéen », même s’il prend une forme différente dans l’URSS stalinienne et dans l’Allemagne nazie. Ces utopies s’inscrivent dans le cadre du Millenium promis (voir partie I). L’architecture nouvelle doit jouer un rôle de premier plan dans la construction de la ville idéale (qui parfois peut devenir une absence de ville, quand l’habitat se disperse le long des voies de communication grâce aux progrès techniques, selon la conception des « disurbanistes » soviétiques). La réaction stalinienne marque ici encore la fin des projets et revient à la ville monumentale classique (projet du gigantesque Palais des Soviets débuté en 1937 mais interrompu par la guerre puis démantelé), et ses constructions profitent une fois encore principalement à l’élite de la nomenklatura (à l’exception du métro, dont les luxueuses stations sont surnommées « le palais souterrain » à partir de 1935) et de nombreux projets n’aboutissent pas. Les villes nouvelles industrielles (Magnitogorsk) doivent incarner l’utopie de la ville socialiste parfaite et ne se soucient pas des conséquences environnementales désastreuses (« Le paysage est un géant enchaîné avec des clous d’usine », Louis Aragon Hourra l’Oural, 1934). A l’inverse, « l’utopie nazie est intensément verte » (mais les moyens pour l’atteindre sont, eux, intensément modernes, mécaniques et techniques !). Les images du nationalisme romantique du XIXe siècle sont reprises pour vanter les vertus de la campagne et du retour aux sources. Le programme de « Reich sans villes » (Blut und Boden) repose sur trois volets : améliorer le bien-être des habitants des campagnes (soirées de villages au son de musiques traditionnelles anti-jazz ; travaux d’embellissement, construction de terrains de sport…) ; installations de colonies en milieu rural (80 000 familles bénéficieront d’un « habitat rustique avec jardin couplé à une installation de petit élevage ») ; développement de cités-jardins (« pépinières de la vie allemande », loin des grandes villes). C’est le Heimat (pays, terroir) qu’il faut protéger avant tout, en directe continuité avec les théories de Wilhelm Henrich Riehl (Land und Leute, 1854). Dès 1933 sont votées des lois de protection animale, de protection des forêts (1934) et plus généralement de protection d’espace reconnus comme écologiquement importants. Toutefois, les dérogations se multiplient, l’industrialisation et la marche à la guerre prenant le pas sur les considérations environnementales. Les historiens ne s’accordent pas tous sur les liens entre nazisme et écologie, mais pour Bernard Bruneteau, il s’agit d’un faux débat, l’écologie étant « sujette à interprétation en fonction des contenus possibles, qu’ils soient libertaire, marxiste ou réactionnaire ».
Dans ce cadre, l’homme nouveau est par excellence « l’habitant de l’utopie » (Michel Heller, La Machine et les rouages. La formation de l’homme soviétique, 1985). L’idée n’est pas nouvelle (les Lumières, la Révolution française ou encore les communautés type phalanstère) mais revêt désormais un caractère de surhomme, éminemment martial, et affranchi des idées et contraintes de l’ancien monde. L’« Homo sovieticus » (Alexandre Zinoviev, 1983) est construit par édification à travers quatre modèles de héros : celui du travail (Stakhanov), celui du parti (souvent martyr de la cause), celui du sport (par exemple l’aviateur Valerii Chkatov, qui vole au-dessus du Pôle Nord) et enfin le héros patriotique (Alexandre Nevski, dans le film d’Eisenstein). La construction de l’homme nouveau dans l’Allemagne nazie s’est faite à l’opposé par sélection. Longtemps vu par les historiens comme la vague « résurrection de modèles anciens » (légionnaire romain, chevalier teutonique), l’homme nouveau est aujourd’hui perçu comme au cœur des idéologies fasciste et nazie, entre rupture avec un passé décadent et retour à un âge d’or glorieux. Le thème de l’homme nouveau est davantage exploité par Mussolini (Hitler utilisant peu le terme), mais on retrouve un modèle d’individu dans la société du Troisième Reich : le guerrier (sous toutes ses formes), but ultime des politiques sanitaire hygiénistes et eugénistes. Impossible de ne pas évoquer les statues d’Arno Breker ou le corps triomphant des athlètes filmés par Leni Riefenstahl en 1936. La science doit permettre d’obtenir le nouveau Volk entièrement pur (un tiers seulement des Allemands appartiendrait à la « bonne souche raciale » !). Dès 1933, une série de lois met ce programme en œuvre (stérilisation des personnes atteintes de maladie héréditaire, lois de Nuremberg « pour la protection du sang allemand » en 1935, fichage des citoyens pour attribuer des « certificats de santé génétique »…), jusqu’à la persécution systématique de tous les individus ne correspondant pas à l’objectif fixé (asociaux, homosexuels, Juifs, Tziganes…). Toujours au nom de la santé, les nazis lancent les premières grandes campagnes hygiénistes contre le tabac, l’alcool, le pain blanc ou encore l’amiante. La médecine du Troisième Reich est la première à établir le rapport entre le cancer du poumon et la consommation de tabac ! Les deux tiers des médecins allemands appartiennent à (au moins) une grande organisation nazie et applaudissent les résultats de cette politique hygiéniste (y compris dans ses aspects les plus brutaux).
Enfin, « l’Eden de l’Est » qui clôture l’ouvrage est commun aux deux régimes totalitaires. En URSS, c’est la Sibérie, terre des possibles, à la fois sauvage et libre, à domestiquer par la force. Des milliers de volontaires du Komsomol partent en 1932 créer une ville sur les rives de l’Amour (le chantier sera catastrophique), des milliers de juifs partent à la frontière chinoise pour y cultiver les terres (projet initialement prévu en Crimée), à grand renfort de propagande sur le « désir juif de fonder une patrie », en contradiction avec la politique antisémite de l’Allemagne nazie au même moment. C’est également dans les contrées inhospitalières de l’Est que sont envoyés les indésirables (koulaks, saboteurs, marginaux…), selon un plan rationnel (mais une pratique déconnectée de la réalité : l’île de Nazino est inhabitable et une grande partie des déportés y meurt en 1933). Le goulag doit permettre de « refondre » l’âme des déviants par le travail. Entre 1930 et 1953, 15 millions de personnes travaillent dans 146 camps (et des milliers d’annexes), à une époque où l’URSS a besoin d’une très importante main d’œuvre pour « pallier la déficience technologique ». La logique économique l’emporte sur l’idéologie. Pour l’Allemagne nazie, l’Est doit être conquis pour répondre aux besoins du Lebensraum (théorie développée dans Mein Kampf), mais sans passer désormais par la germanisation des populations (comme sous Bismarck) : « il s’agit désormais de germaniser le sol », dans des régions où l’influence allemande se faisait autrefois ressentir. Historiens, sociologues, économistes, géographes et juristes mènent les recherches au sein de l’Ostforschung et vont finalement légitimer « la solution du nettoyage ethnique » par leurs travaux de classification des populations. Dans ce lieu neuf (qui sera vidé de ses habitants) s’ouvrira alors un immense terrain d’expérimentations, à réaménager selon les principes du géographe Walter Christaller (ancien membre du SPD rallié au régime) autour des lieux centraux (il soutient sa thèse sur les villes allemandes du sud en 1933). Les projets sont multiples mais n’aboutissent pas en raison de multiples difficultés de réalisation (les populations allemandes sont peu enclines à aller s’installer à l’Est, malgré la propagande intense autour de l’extension du Lebensraum) et surtout du tournant de la guerre en 1942.
Dans ce livre passionnant, Bernard Bruneteau offre un nouveau regard sur les sociétés totalitaires et sur les régimes qui les ont créées/transformées/manipulées, s’intégrant dans le courant historiographique apparu depuis les années 2000 pour lequel le communisme (ici stalinien) et le nazisme n’ont pas pour seul point commun la terreur. La très grande richesse des sources et les nombreuses citations en font un livre-référence à lire absolument !
En complément : le très intéressant podcast « Ils ont vécu heureux sous des régimes totalitaires » (RCF, le 21/06/2022), interviews croisées de Bernard Bruneteau et d’Alexis Lacroix (historien des idées, producteur sur France Culture professeur de lettres modernes à l’Université catholique de Lille, auteur de La République assassinée – Weimar 1922, Ed. du Cerf, 2022).