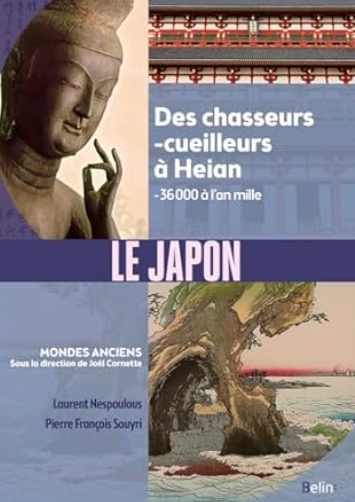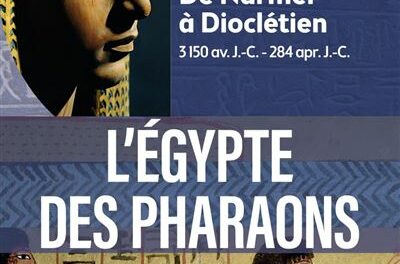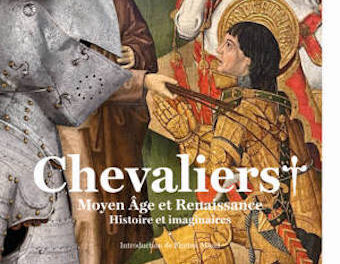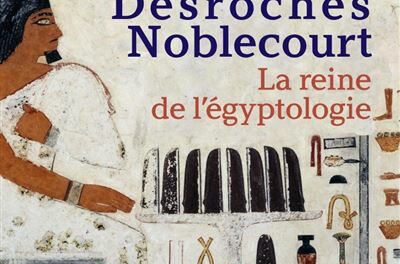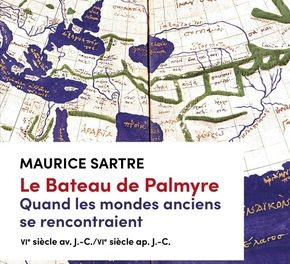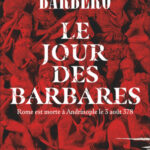Découvrir le Japon ancien à travers l’histoire et l’archéologie
Le Japon ancien ne disposait pas encore de synthèse en français abordant l’ensemble de l’archipel de la préhistoire jusqu’au début du Moyen-Age. C’est désormais le cas avec ce manuel dans l’excellente collection « Mondes Anciens » de Belin.
Cet épais volume de plus de 500 pages relate l’histoire de l’archipel et les contacts avec ses voisins depuis -36 000 (premières traces de chasseurs-cueilleurs) jusqu’au Xe siècle, date à laquelle le pouvoir central s’affaiblit au profit d’un réseau d’intermédiaires, notamment constitués par les samouraïs.
L’écriture a été confié à l’archéologue Laurent Nespoulous et à l’historien François-Xavier Souyri, dont la « Nouvelle histoire du Japon » (2009) est toujours une référence. En s’appuyant sur les fouilles archéologiques, l’étude des objets retrouvés, et l’analyse des sources écrites contemporaines ou postérieures, l’objectif des auteurs est « d’offrir un éclairage sur la nature et le fonctionnement des sociétés anciennes dans leur évolution à travers les âges » (page 7). Le pari est réussi.
Du Paléolithique des chasseurs-cueilleurs jusqu’à l’émergence des samouraïs
Le livre commence par les routes empruntées par les premiers chasseurs-cueilleurs vers -36000. Les gisements d’obsidienne sont exploités comme sur les falaises de l’île de Kozu au large d’Izu. Selon les auteurs, les premiers découvreurs de l’archipel seraient arrivés à ce moment-là sur des embarcations depuis la péninsule coréenne. Prisée en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, cette roche volcanique est façonnable pour en faire des outils précieux et se « révèle indispensable aux activités de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, à savoir la chasse, la pèche et toute l’industrie de transformation de certaines ressources comme le travail des peaux, de l’os ou du bois » (page 30). Vers -28000, les populations dans le département de Tochigi occupe un habitat sous la forme d’un anneau.
De -14 000 jusqu’au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, la longue période Jomon se caractérise par le développement de la chasse et les premières interventions sur les espèces locales, notamment via l’horticulture. Les sociétés commencent à stocker des denrées et sont capables de mobiliser de nombreux individus pour édifier des habitats et des lieux de culte. De nombreuses reproductions en couleur des poteries permettent d’en étudier les différences (décoration ou non, travail de la laque) au cours du temps.
Les poteries du début de la période Yayoi, vers -900, deviennent moins exubérante. Très vite, les grands habitats groupés dans les plaines disparaissent et la métallurgie du bronze et du fer se développe. Les turbulences économiques s’estompent peu à peu à la faveur d’une réorganisation des échanges et permettent la réalisation de vastes tombes, les kofun, à partir de 250. Encore aujourd’hui, de nombreuses tombes de cette période sont exclues des fouilles archéologiques par l’agence du Palais impérial. C’est le cas du kofun de Daisenryo, le plus grand jamais édifié, datant du Ve siècle et situé dans le département d’Osaka.
Une richesse iconographique inégalée en langue française
De nombreuses cartes en couleur sont inédites : par exemple, le plan du complexe palatial de Naniwa (vers 650) précède une carte présentant les sources d’impôts au VIIe siècle. Parmi les plus imposants du Yayoi récent, le site de Muki-Banda dans la préfecture de Tottori présente ainsi le passage de l’habitat de plaine vers des habitats en hauteur.
Les étudiants désirant étudier le littoral chinois ou la péninsule coréenne trouveront également d’habiles mises au point sur les liens entre l’archipel et les pouvoirs voisins. Par exemple, la bataille de Paeksonggang de 663 est l’objet d’une double-page complète et d’une carte dédiée. Située à proximité de la côte occidentale de la Corée du Sud actuelle, elle oppose la flotte du Yamato en provenance du Japon à celle formée par la Chine des Tang et les troupes coréennes du royaume de Silla. Cette défaite marque la fin de la politique interventionniste japonaise du Yamato dans la péninsule.
L’un des points forts de l’ouvrage est également de s’intéresser aux marges de l’archipel japonais, à savoir la culture aïnue sur l’île septentrionale de Hokkaido et les traces de l’occupation de l’archipel tropical des Ryukyu. La poterie, l’habitat, les fourrures et la porcelaine de ces deux extrémités de l’archipel sont à l’honneur dans le dernier chapitre.
Les professeurs de spécialité HGGSP pourront mobiliser les pages sur la « révolution néolithique » pour le thème sur l’environnement mais aussi les enjeux mémoriaux autour de l’interdiction de fouiller les kofun (tombes en forme de serrure) qui appartiennent à la maison impériale en classe de terminale. Présente dans les dernières pages de l’ouvrage, une chronologie synthétise le découpage du temps « dans le Japon d’autrefois » (page 495), ce qui peut constituer le point de départ d’un exercice dans le chapitre introductif d’histoire en classe de Seconde.
En conclusion, cette somme inédite sur le Japon ancien s’avère à la fois très dense, dépaysante et habilement illustrée par de nombreux documents et traductions inédites.
Pour aller plus loin :